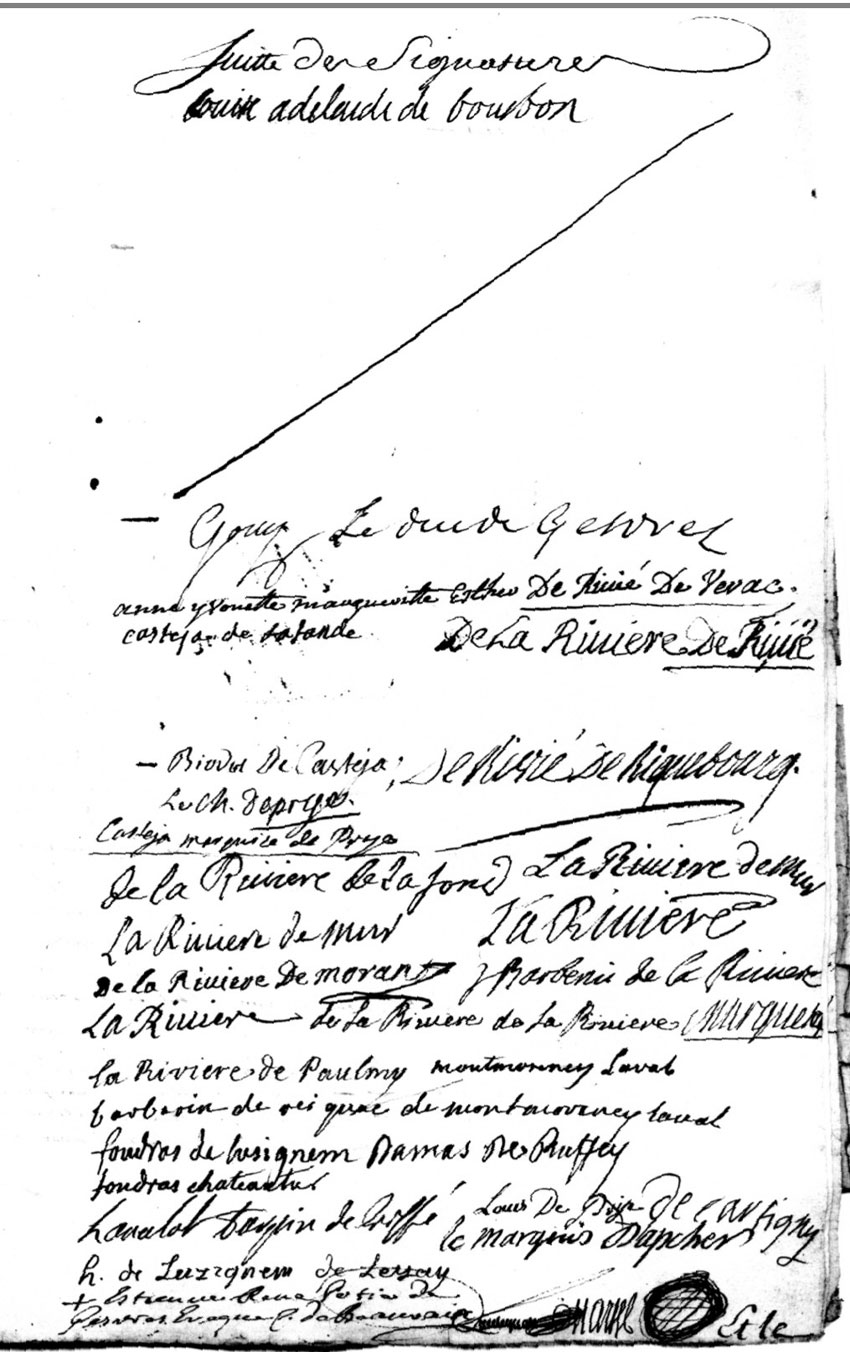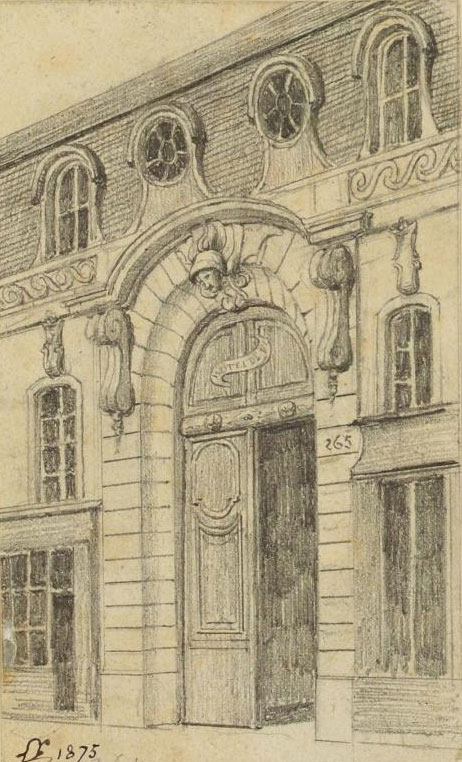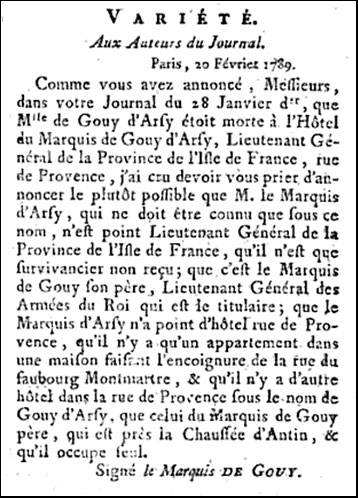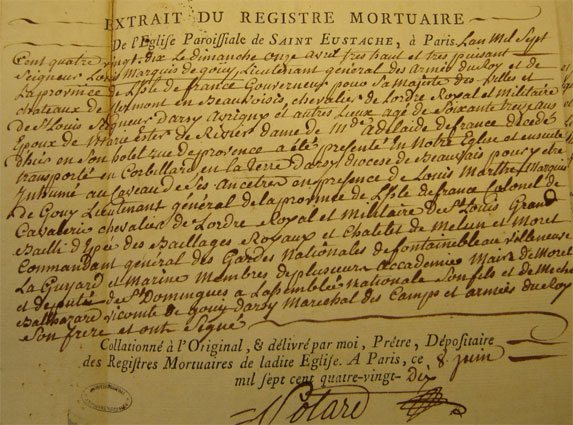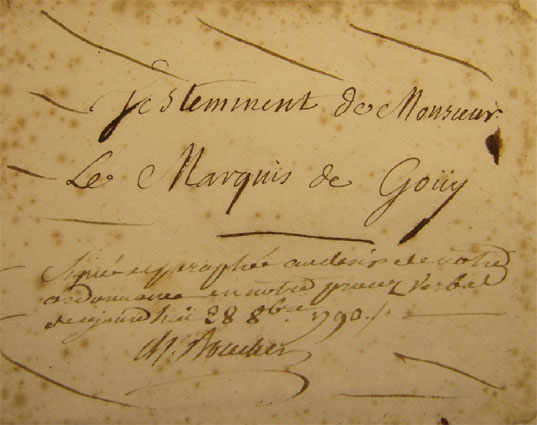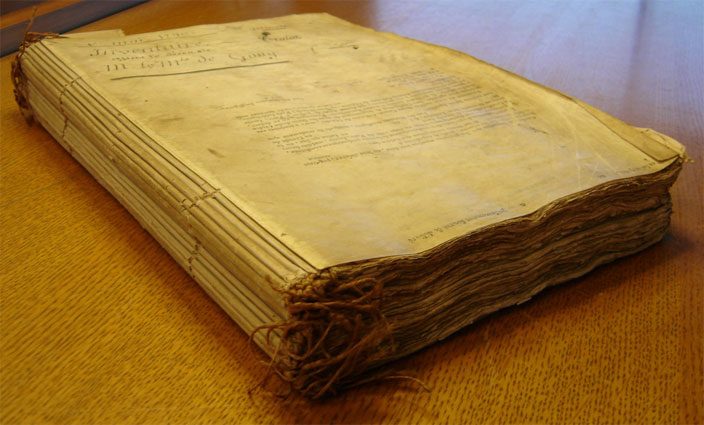Louis, marquis de Gouy d'Arsy
1717-1790
Lieutenant général des armées du Roi
lieutenant-général au gouvernement de l'Ile de France pour le département du Vexin-Français
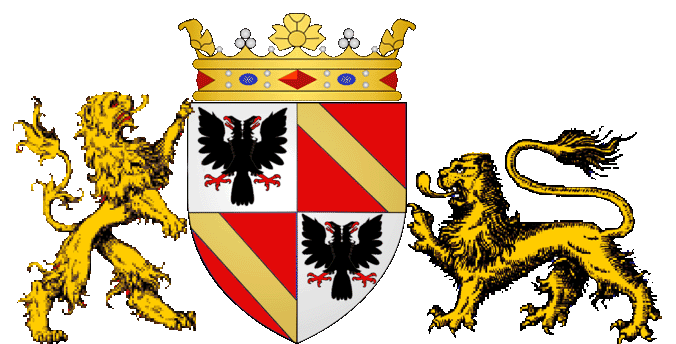
Armoiries de la famille de Gouy d'Arsy

Bouton de livrée des Gouy d'Arsy (31 mm),
en l'occurence de Jean, marquis de Gouy d'Arcy, fabriqué vers 1900
Né le 18 février 1717 à Paris, Louis de Gouy fut baptisé le 27 dans la chapelle du château des Tuileries. Il eut pour parrain
le roi Louis XV âgé de 7 ans, et pour marraine la duchesse du
Maine, Anne Louise Bénédicte de Bourbon-Condé. A cette
occasion, raconte le marquis Dangeau, le Roi « envoya une belle bague à Madame
D'arsy. » Louis léguera cette bague à sa bru Hux de Bayeux.
Cette marque d'estime de la part du souverain montre que la famille de Gouy
était proche de la famille royale. N'oublions pas que la grand-mère du
baptisé, Jeanne-Françoise de Salomon, née de Biaudos de Castéja, dite
Madame de La Lande, avait élevé le Roi quand elle était sous-gouvernante des
enfants de France, et que celui-ci l'aimait comme une mère.


Louis XV à 7 ans et la duchesse du Maine, parrain et marraine de Louis
Son père était Michel-Jean de Gouy, chevalier, marquis d'Arsy, Seigneur d'Arsy, de Pleumel, de Dammarest, de Dandulle, d'Avrigny, de Favieref, de Troussancourt et autres lieux,
chevalier de Saint-Louis, maréchal
de camp et gouverneur de Béziers, gentilhomme de la manche du roi et
écuyer en quartier de la dauphine, ce qui lui valait de loger au château de
Versailles. Sa mère était Françoise-Mélanie de Salomon, dame de Poulard et de La Lande, fille de la sous-gouvernante du Roi.

Françoise-Mélanie, mère de Louis (
voir ici)
Louis débuta sa carrière militaire comme mousquetaire, obtint ensuite une compagnie
dans le régiment de Saint-Aignan Cavalerie (25 mars 1734) et la commanda lors des guerres de succession de Pologne (1733-1738), étant en Allemagne, la même année à l'attaque des
lignes d'Etlingen (5 mai) et au siège de Philippsbourg (12 juin-18 juillet) , à la bataille de Clausen le 20 octobre 1735, puis des guerres de succession d'Autriche, étant
en Bohème (République Tchèque actuelle) au siège de Prague qui débuta en novembre 1741, au combat de Sahay le 24 mai 1742, au ravitaillement de Frawemberg à la même époque,
à la défense et à la retraite de
Prague de juin à décembre 1742.
Rentré en France avec l'armée en février 1743, il est promu colonel commandant le
régiment de Gâtinais-infanterie par commission du 6 mars 1743 et est employé en Italie, étant à la tête de son régiment
à l'attaque
du village et du château de Pont (novembre), et l'année suivante (1744) à la bataille du château de Demont (9 avril),
à l'attaque des retranchements de Nice, de Villefranca (Villefranche-sur-mer, 20 avril) et du fort du mont Alban (Montalban, 21 avril),
aux sièges de Casteldelfino (Château-Dauphin, 19 juillet),
et à la bataille de la Madona-del-Olmo (près du château de Cony, 30 septembre), sur les frontières du Piemont en 1745, à la bataille
du Tidone le 10 août 1746 (sur sa campagne d'Italie en 1745-1746,
voir
ici).
En 1744, Louis avait vendu à Jean-Jacques Denis, dont le père avait géré les
propriétés des Salomon, la seigneurie de Poulard, héritée des demoiselles de
Salomon, tantes de sa mère. Sur l'acte de vente Louis est qualifié «
Haut et
puissant seigneur Louis, marquis de Goüy, colonel du régiment du Gastinois, demeurant à
Paris, au vieux Louvre, chez Mme la marquise de Lalande, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois.
»

Régiment du Gastinais
Le 12 août 1746, la mort du chevalier de Tessé lui permet de racheter le régiment de
la Reine-infanterie pour un prix réduit qui était
le prix du régiment du Gâtinais dont le Roi disposait purement et simplement.
Ce régiment servait aussi en Italie et continua d'y servir jusqu'à la paix.
« Les nouvelles que je reçois du chevalier de Tessé ne me permettent plus, Monsieur, de conter
qu'il revienne de son .. Permettez moy de vous demander la grâce de supplier le roy
d'accorder à mes enfants le prix du Régiment de la Reine. Les raisons qui m'autorisent à
cette demande sont qu'il a été déjà perdu pour eux à la mort de leur père, ils ont peu de
biens à présent.
Signé : Gouy d'Arsy »
« Versailles le 12 août 1746
Le roy accorde le régiment de la Reine, vacant par la mort du chevalier de Tessé à M de
Gouy, colonel du Régiment de Gastinois et Sa Majesté réduit de 30000 livres le prix du
Régiment de la Reine. »

Régiment d'infanterie de la Reine, créé en 1661,
composé de 2 bataillons (de 12 compagnies de 40 soldats et 1 compagnie de 45 grenadiers), soit 1050 hommes.
Son père décède le 1er mars 1747 et Louis devient ainsi marquis d'Arsy et seigneur d'Arsy, Avrigny, Cartigny (son grand-père était titré marquis de Cartigny),
Troussencourt, Francastel et autres terres situées en Picardie.
Peu avant, le 12 janvier, le Conseil du prince de Condé avait décidé de lui demander communication des titres concernant
les fiefs qui lui appartenaient au jour de son décès, comme héritier de M. d'Arsy, son père. que comme donataire de Louis de Gouy, son oncle, abbé de Klingenmunster.
Reçu
chevalier de Saint-Louis le 16 mars 1747, il se distingue à l'affaire de l'Assiette
(et non pas à Fontenoy comme cela est écrit dans plusieurs généalogies
imprimées, dont celle de Woelmont de Brumagne).
La bataille de l'Assiette (19 juillet 1747) est un épisode de la guerre de succession
d'Autriche qui opposa les troupes franco-espagnoles (les galispans) aux troupes
austro-piémontaises. Louis XV déjà tenté d'entrer dans le Piémont, au siège de Coni et aux batailles de la Madonne de l'Olmo ou de Bassignana,
mais sans succès. En 1747, il ordonne donc d'en finir avec le roi Charles-Emmanuel III de Savoie
et mande une armée forte de 150 régiments d'infanterie, 75 escadrons de cavalerie et deux brigades d'artillerie, sous le commandement
du chevalier de Belle-Isle, lieutenant-général des armées du roi de France, et du marquis de las Minas, son homologue espagnol.
Louis commandait les 2 bataillons du régiment de la Reine qui
faisaient partie des 9 bataillons constituant la colonne de gauche sous le
commandement du comte de Mailly. La disposition d'ailleurs de sa colonne était la suivante :
Une avant-garde composée de douze compagnies de grenadiers; une compagnie de mineurs,et douze
piquets. Elle était aux ordres de M. de Gouy, colonel de la Reine (récit du comte de Mailly).
Louis est blessé au cours de la bataille :
« M. de Gouy a très bien servi ; il eut les deux cuisses percées à la malheureuse affaire de M.
le chevalier de Belle-Isle, et nous l'avons vu longtemps ici avec des béquilles, digne de
compassion ; il espérait dans cette occasion de nouvelles marques de la bonté du Roi, mais
il n'eut rien alors. »

Col de l'Assiette, vallée de Suze, 2587 m.
7 bataillons savoyard et piémontais mettent en déroute 39 bataillons de français et d'Espagnols qui voulaient s'emparer de Turin
Le chevalier de Belle-Isle y perdit la vie
Brigadier depuis le 11 septembre 1747, Louis épouse le 18 février 1749 Anne Yvonnette Esther de Rivié de
Riquebourg, fille d'Etienne Rivié, seigneur châtelain de
Marines et de Ricquebourg, baron de Chars, grand maître des eaux et forêts
de l'Ile de France, récemment décédé, et de Marguerite de la Rivière de
Plœuc. Elle était veuve sans enfant de César de Saint-Georges, chevalier,
comte de Vérac, premier cornette des chevau-légers de la garde du Roi,
brigadier de ses armées. Louis de Gouy avait un nom prestigieux et une
carrière déjà bien remplie, sa femme avait une fortune toute récente, quoique par acte du 31 mars, les jeunes mariés renoncent
à une succession grevée de dettes et la laisse à Monsieur de Ricquebourg, frère de la mariée.
Le contrat avait été conclu deux jours avant
devant Martel et son confrère, notaires à Paris, signé et cautionné par la
famille royale qui témoignait par là, une fois encore, la grande estime dans
laquelle elle tenait la famille de Gouy.
La mariée apportait en dot la seigneurie de Liancourt près de Chaumont dans
le Vexin, deux maisons situées rue du croissant à Paris (qui seront vendues
en 1755), des rentes sur les aides et gabelles, des deniers comptants et du
mobilier pour 60 000 livres tournoi, le douaire sur la maison de Vérac et les droits sur la succession de son père, mort
le 9 octobre 1748. Le total de son apport était de 569 000 livres. Le
marié apportait à son épouse ses terres en Picardie, héritées de son père
décédé, son régiment et la place de dame pour accompagner Mesdames, dont la
fonction était d'assurer auprès de leurs maitresses la présence constante de
nobles dames, sans autre devoir spécifique. Cet emploi était une grâce du
Roi, accordée à Madame de La Lande, quand elle s'était retirée
de son service à la cour ; il était destiné « à la femme qu'épouserait son petit-fils »
et lui apportait 4 000 livres par an.
C'est ainsi que le 16 février 1752 elle se trouva dans un des carrosses du Roi
qui composaient le convoi funèbre conduisant à l'abbaye royale de Saint-
Denis le corps de Madame Henriette. Elle s'y trouvait en compagnie de ses
parentes la marquise et la comtesse de La Rivière et la dame de Paulmy,
également au service de Mesdames.
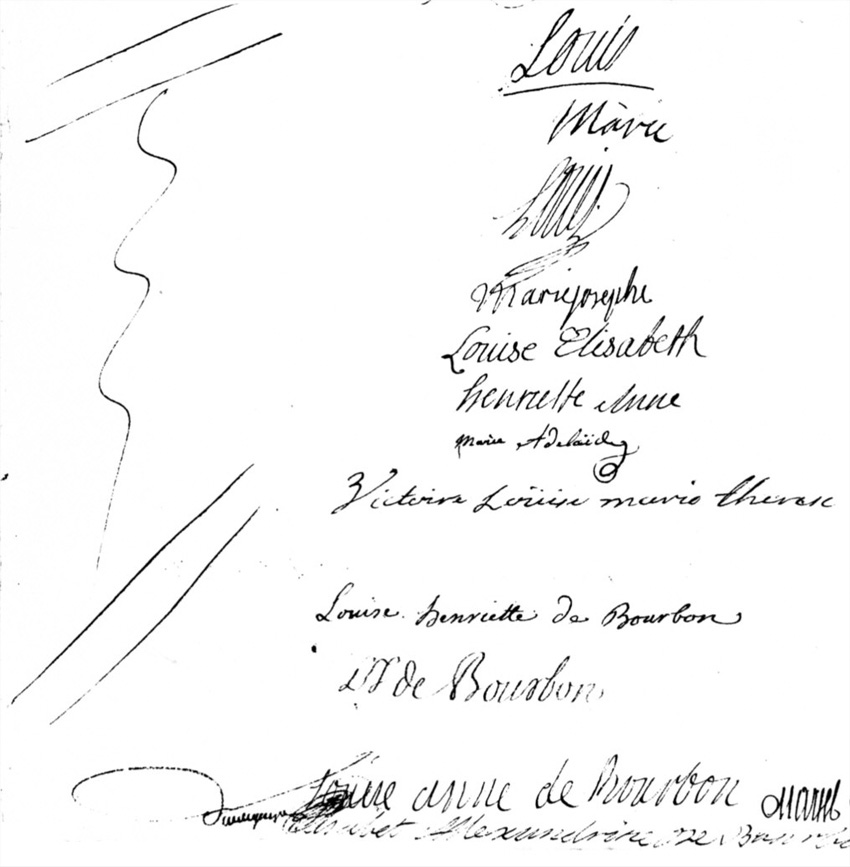
,
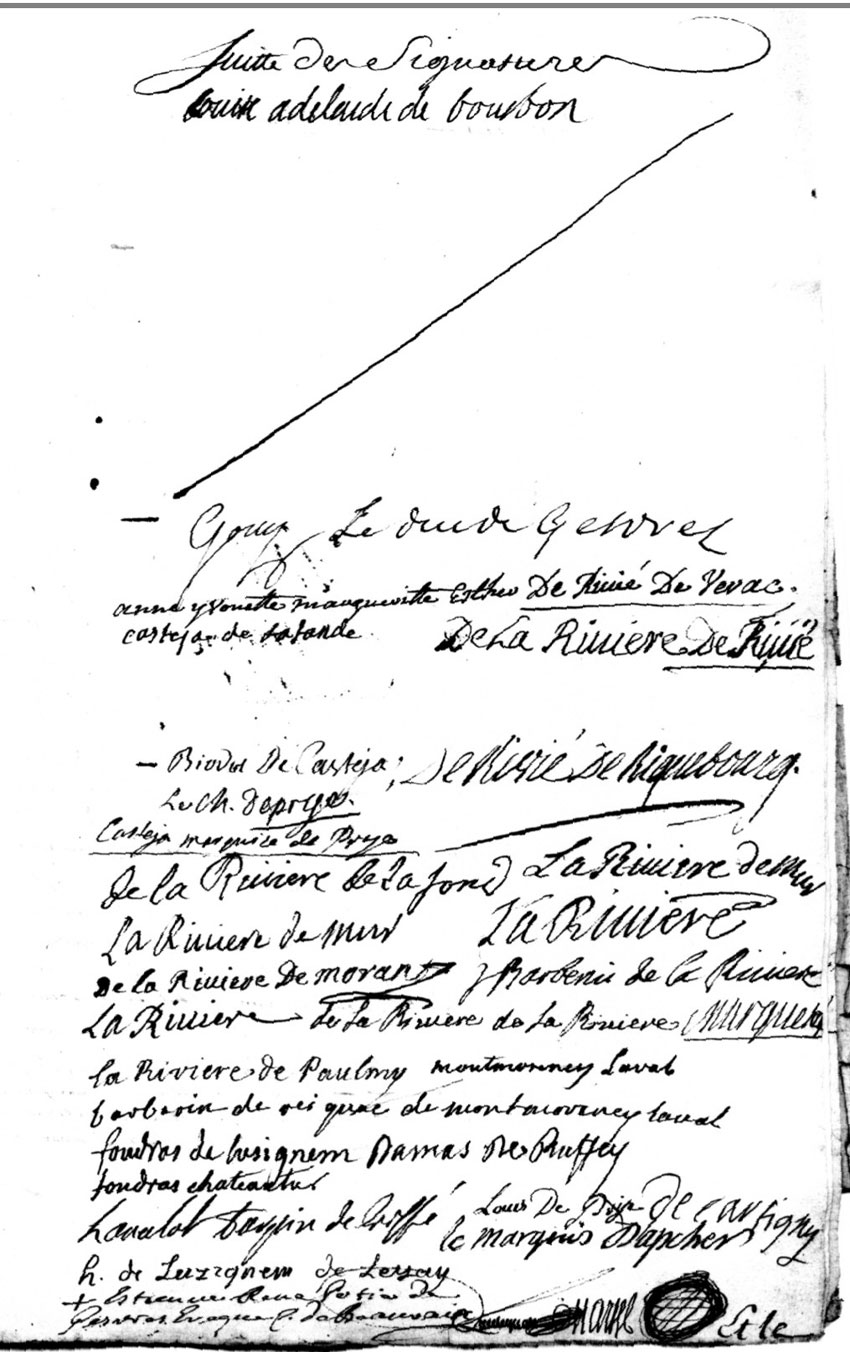
Signatures au bas du contrat de mariage
On note sur la première page les signatures de leur Majestés, de Monseigneur le Dauphin et
Madame la Dauphine, de Madame Infante, de Mesdames de France et des Princes et Princesses du
sang, à Versailles au château du Louvres, à savoir de Louis XV, Marie Leszcynska, le dauphin Louis, sa
femme Marie Josèphe de Saxe, les aînées Elisabeth et Henriette (jumelles), Madame Adélaïde,
Madame Victoire, Louise Henriette de Bourbon (duchesse d'Orléans), Louis de Bourbon (comte de
Clermont), Louise Anne de Bourbon (Mademoiselle de Charolais), Alexandrine de Bourbon
(Mademoiselle de Gex) et Louise Adélaïde de Bourbon (Mademoiselle de La Roche sur Yon)
et sur la seconde page celles « des seigneur et dame futurs épous, et les
seigneurs et dames leurs parents et amis, à Paris en la demeure de la ditte Dame future
épouse ». On remarquera en bonne place la signature de François Potier, 3e duc de
Gesvres, gouverneur de Paris et les signatures de Madame de Lalande (Castéja de
Lalande), du couple Prie (Le chev de Prye + Castéja marquise de Prye)

Armoiries d'alliance Gouy d'Arsy - Rivié
sur la couverture d'un livre d'Anne Yvonette de Rivié
A son mariage les biens de la demoiselle de Rivié s'élevaient à quelque 24 000
livres de rente. Mais avec l'extérieur de l'opulence, il s'en fallait bien que les affaires de
cette maison fussent en règle et le marquis de Gouy eut le désagrément, trois
semaines après son mariage, de voir tous les biens de sa femme saisis pour
les dettes de son beau-père.
Louis, qui avait fait les campagnes d'Allemagne, de Bohème et d'Italie à
la tête des régiments de Gâtinais et de la Reine-Infanterie, semble s'être
assagit peu après son mariage pour assurer sa postérité. Officier général,
animé du désir de s'avancer, il était obligé par conséquent de paraître dans le
monde, à la cour, dans ses garnisons, tenant table à son régiment. On le
retrouvera en 1757 à Dieppe où le 1er bataillon de son régiment est cantonné (le second étant au Québec). Quand
ses devoirs l'appelaient à Paris, il était logé au Louvre dans l'appartement de sa grand-mère, pour lequel le roi lui
donna en 1745 un brevet de survivance en sa faveur.
Neuf mois après la cérémonie du mariage, le 11 novembre 1749, une fille
naquit au Vieux-Louvre à Paris. Marie Louise Henriette
Monique fut ondoyée
le jour même à Saint-Germain l'Auxerrois, et baptisée le 22 décembre suivant
dans la chapelle du roi à Versailles, François-Armand de Rohan, cardinal de
Soubise, grand aumônier de France officiant. Elle eut pour parrain le
dauphin Louis et pour marraine sa sœur Henriette de France (sur Monique,
voir ici).
Vint ensuite Louis-Marthe, qui naquit au même endroit, le 15 juillet 1753 et
fut ondoyé le même jour à Saint-Germain l'Auxerrois. Il fut baptisé le 28
juillet suivant par le prince de Rohan, grand aumônier de France, dans la
chapelle du château de Compiègne, avec le Dauphin Louis pour parrain, et
Louise Élisabeth de France, duchesse de Parme pour marraine (sur Louis-Marthe,
voir ici).
Quelques mois après cette naissance, le 25 octobre 1753, le frère de la
marquise de Gouy, Charles de Rivié de Ricquebourg, dit
Monsieur de
Ricquebourg, alors capitaine au régiment des dragons de la Reine, domicilié à
Paris, rue du Gros-Chenet, meurt à 24 ans au château d'Ennery près de
Pontoise. Certains disent qu'il fut tué en duel, d'autres qu'il mourut de la
petite vérole. Mort sans enfants, et seul héritier de la fortune des Rivié, il
laissait à sa sœur une succession considérable, d'environ 1 200 000 livres,
mais chargée de plus de 600 000 livres de dettes que Louis de Gouy parvint à
éteindre en vendant de ses propres biens et de ceux de sa femme.
Louis devient alors le maître de toutes les seigneuries réunies
par
Thomas Rivié au sein de la baronnie de Ressons, en Picardie et de la
baronnie de Chars, dans le Vexin français. En plus du château d'Arsy, il se
trouvait donc posséder ceux de Marines, Ricquebourg et La Neuville(-sur-
Ressons), mais celui de Marines semble avoir eu sa préférence car on sait
qu'il y habita longtemps puisque, de 1758 à 1786, le marquis « présida toutes les
assemblées hebdomadaires du bureau de direction de l'Hôtel-Dieu de Chars, dont les procès
verbaux portent tous sa signature, et quoiqu'habitant Marines, il parait qu'il venait tous
les dimanches à la messe de Chars. Comme il était en procès avec les oratoriens de
Marines, on raconte qu'il faisait un détour chaque fois qu'il allait à la messe, pour passer
en grand équipage devant leur couvent et les narguer. »
Un troisième enfant, François, naquit le 9 novembre 1755 à Paris et fut
baptisé le 17 juillet suivant en la chapelle du château de Compiègne, tenu sur
les fonts par le Dauphin Louis et par Madame Adélaïde, ses parrain et
marraine.
Deux autres enfants naquirent mais durent mourir en bas-âge car on ne
connait aucun détail les concernant.
Une lettre au ministre de la guerre, datée de Calais
le 26 mai 1758, nous montre cependant combien Louis n'était pas au mieux
de sa forme physique à cette époque, en partie, sans doute, des suites de ses
blessures reçues au col de l'Assiette dix ans plus tôt:
« J'ai l'honneur de vous mander que j'étais arrivé à Calais très incommodé du voiage de
Paris. La quantité de pierres et de graviers que j'ai rendus depuis que je suis icy, me
persuade de plus en plus qu'il est impossible que je fasse la campagne dans l'état ou je suis,
ne pouvant soutenir la moindre fatigue. J'ai éprouvé aussi que je ne pouvais être deux
heures à cheval sans ressentir de violentes douleurs causées par ma néphrétique. Aussi
j'espère, Monseigneur, que vous ne me refuserez pas un congé pour aller prendre les eaux de
Forges qui m'avaient été ordonnées par le médecin qui m'a donné les remèdes que j'ai pris
l'été dernier et presque tout l'hiver puisque les eaux de Passi [Passy] que j'ai pris n'ont pas
été assez fortes et que l'effet de ces remèdes n'a pas été aussi prompt et aussi salutaire que je
l'aurais désiré. C'est l'unique ressource qui me reste, plaignez moy, Monseigneur, de
l'obligation où je suis par mes infirmités de demander un congé dans ce moment, et ne me
refusez pas cette grâce que je vous demande avec instance.
J'ai l'honneur d'être avec respect, Monseigneur, votre très humble été très obéissant
serviteur. » (
voir ici)
Louis souffrit ainsi pendant les dix-huit mois qui précédèrent une opération
de la taille qu'il subit en 1761. Sa promotion au grade de maréchal des camps le 17 février 1759 rend vacant le régiment de la Reine que le Roi donne
au marquis de Crussol d'Amboise. Louis ne fut pas employé depuis.
Sa belle-mère, née Agathe de la Rivière, mourut le 31 décembre 1762
dans une maison qu'elle louait aux jésuites rue Cassette à Paris, laissant
sa fille, pour unique héritière. Dans un codicille écrit six
ans plus tôt elle rendait ainsi justice à son gendre :
« Par mon testament du 8 août
1750, je chargeais ma fille de mon exécution testamentaire. Aujourd'hui j'y joins mon cher
gendre, regardant ma fille et lui ne faisant qu'un. De plus l'amitié de M. de Gouy pour
moi, la droiture de sa façon de penser en tout, l'engagerait à lever toutes les fautes
d'ignorance que je peux avoir faites, tant dans mon testament que dans ce présent codicille.
Ses sentiments pour moi m'assurent qu'il lui suffira de voir que l'un et l'autre sont écrits de
ma main, pour remplir tout ce qu'ils contiennent l'un et l'autre. Je l'en supplie, et sa bonne
façon de penser à mon égard ne me permet pas d'en douter, puisqu'il a toujours été occupé à
aller au devant de tout ce qui pouvait me faire plaisir ; mon amitié pour lui méritait la
sienne, puisqu'il n'y en a jamais eu de si parfaite. Je l'en assure ici, et que j'emporte en
mourant la satisfaction que j'ai de voir l'amitié pleine d'union avec laquelle il vit avec mon
enfant. Quoiqu'elle en soit assurément digne par la sienne pour lui, il est toujours bien
satisfaisant à une mère tendre de voir ses enfants penser en tout point comme ils le doivent.
Je les conjure l'un et l'autre de se souvenir de leur vieille maman qui meurt très satisfaite de
les voir heureux. Elle désire qu'ils continuent d'y vivre et que leurs enfants augmentent leur
bonheur ; comme ils sont très bien nés, j'ai lieu d'espérer que cela sera. »
Le 17 février 1763, le marquis de Gouy prêtait serment entre les mains du
Roi pour la lieutenance générale du gouvernement de l'Ile de France au
département du Vexin Français (Gazette de France du 4 mars). Son rôle était
de commander sous les ordres du Gouverneur général de l'Ile de France (le duc de Tresmes jusqu'en 1766 puis le duc de Gesvres, son fils) dans le district du Vexin français (Pontoise, Magny, Chars) et de commander en chef en l'absence du gouverneur.
Mais à cette époque la charge était devenue purement honorifique
et le titulaire résidait à la cour et se contentait de toucher ses revenus. Les gouvernements et lieutenances générales des provinces étaient
données à la haute noblesse et aux officiers généraux.
En 1767 le marquis de Gouy se détermine à prendre un hôtel à Paris,
appelé hôtel de Vic, situé rue Saint-Martin, vis-à-vis celle de Montmorency,
dans lequel la marquise put emménager le 29 novembre. Ce logement, disait-il,
lui revenait à plus de douze mille livres, à cause du Suisse, et de l'augmentation
de bois, de chandelle et d'huile de lampe.
La marquise y avait
trois femmes de chambre, un cocher et deux laquais. Parmi son personnel le marquis avait un secrétaire, un valet de chambre, un cuisinier, un cocher, un laquais, un frotteur et un suisse. La marquise avait
une voiture et deux chevaux, et le marquis quatre voitures et douze chevaux.
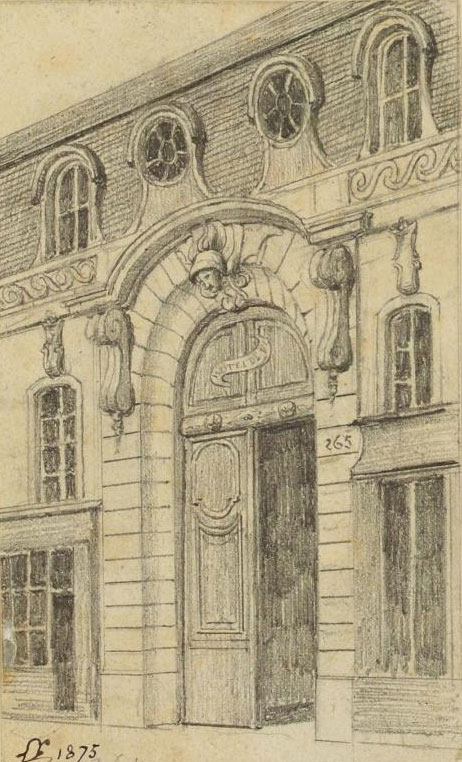
L'hôtel de Vic fut démoli en 1885
Monique épousa le comte des Salles le 18 février 1769. Le 10 mai ses deux frères allèrent à Vaugirard, qui n'était encore
qu'un village de banlieue, pour se préparer à l'inoculation contre la petite
vérole. Louis avait vendu l'appartement du Louvre, et en attendant qu'il fût en état de les recevoir, Monique et son mari logeaient dans la maison du marquis. La mère
imprudente avait été embrasser ses fils attaqués d'un poison, qui, pour être
volontaire, n'en était pas moins dangereux dans la communication. Au retour elle ne
changea point d'habits et vit sa fille sans précaution. Quand il l'apprit, le
marquis, dont la mère était elle-même morte, à 26 ans, de la petite vérole
qu'elle avait prise de lui, qui a vu une partie de la famille de sa femme
détruite par ce venin, se mit en colère et s'écria dans sa détresse : vous avez
risqué d'empoisonner votre fille ! Et la crainte de rapporter dans sa maison l'air de
la maladie, lui fit renouveler l'interdiction faite à la marquise d'aller rendre
visite à ses enfants : « Je le crois bien, Madame, lui dit-il, que vous n'irez point voir
vos enfants. Si vous étiez assez hardie pour y mettre les pieds, je vous déclare que vous ne
rentreriez pas dans ma maison, et si vous y envoyiez quelqu'un de vos gens, celui qui s'y
serait présenté s'en trouverait mal, car je le tuerais sur la place. » Cette violente
altercation, pourtant bien compréhensible et qui le fera plus tard qualifier de
coléreux, se produisit à une époque où les relations entre
le marquis et la marquise étaient loin d'être au beau fixe !
Déjà au début de l'année 1769 le marquis et la marquise
de Gouy avaient eu une violente altercation dans leur demeure parisienne : la
marquise voulut, ce soir là, entre minuit et une heure, quitter la maison,
faisant atteler son carrosse. Le marquis voulut l'en empêcher et la marquise
l'aurait alors fait pirouetter dans la chambre avec violence. Il fallut le secours d'un
ami commun qu'on avait envoyé chercher, malgré l'heure indue, pour
ramener le calme et convaincre la marquise de renoncer à ses projets. Depuis
ce jour-là, le marquis cessa de voir sa femme pour éviter des scènes et ils vécurent
chacun de leur côté, lui ayant renoncé à recevoir et elle recevant encore
quelques amis et parents à souper assez souvent.
Un certain temps s'écoula dans ce modus vivendi jusqu'à un nouvel esclandre
survenu le 6 janvier 1771 : ce jour là, la marquise recevait quelques invités,
mais le marquis avait défendu à son suisse de laisser entrer les carrosses dans
la cour après neuf heures du soir car lorsqu'ils repartaient dans la nuit, cela
faisait force bruit et troublait son sommeil, sa chambre étant au rez-de-chaussée
sur la cour. Ayant voulu passer outre, la marquise avait ordonné au
suisse de laisser entrer les carrosses. De ce jour, le conflit conjugal ne connut
plus de cesse...
Le marquis convoqua un commissaire du châtelet le lendemain et lui rendit
plainte contre la marquise. Témoin de la rédaction de cette pièce, la marquise
s'empara de l'officier public qui l'a reçue et lui dicta à son tour une autre en
réponse. « On croit qu'elle va se justifier de toutes les imputations dont elle vient de se
voir accablée, mais pas du tout ! Il n'est question de rien qui ait rapport à tout ce qui est
paru depuis . »
Louis partit alors six mois sur ses terres picardes. Peu après, au mois de
novembre 1771, la marquise se retira au couvent des Dames de l'Immaculée
Conception, dit des Récollets, rue du Bac à Paris. De là, elle engagea une
procédure en séparation contre son mari, afin de recouvrer la jouissance de
ses biens. Elle en appela même, par une lettre, au Roi en personne.
On fit imprimer de part et d'autre des mémoires en vue du procès que la
marquise intenta à son mari : mémoires acharnés de sa part, et très modérés
de la part du marquis, soucieux de préserver le renom de son illustre famille.
Il y évoquait une révolution étrange survenue dans l'âme de la marquise ou
encore la disposition de son corps altérant celle de son esprit, chez une
femme qui était déjà sujette auparavant à une grande mélancolie.
Ce procès se déroula à l'époque de la fin du bras de fer entre Louis XV et les
Parlements. On sait que pour mettre un terme à la guerre ouverte menée par
ces derniers au pouvoir royal, le chancelier Maupeou, créateur des
institutions judiciaires modernes, réalisa cette année 1771 un spectaculaire
coup de force pour reprendre en main le pouvoir judiciaire. Une justice
prompte, gratuite et rapprochée du justiciable, la vénalité de tous les offices
abolie, le domaine du juge à jamais séparé du domaine législatif, étaient des
idées qui naissaient à peine lorsque Maupeou les jeta d'un coup dans la
réalité. Sa réforme fut vivement combattue par les Princes du sang et certains
philosophes, mais elle fut soutenue par Voltaire qui, depuis l'affaire Calas,
détestait les parlements, et puissamment servie par l'avocat Nicolas-Henri
Linguet qui l'avait souhaitée et inspirée, et qui allait donner la vie au nouveau
Parlement par ses brillantes plaidoiries.
C'est avec l'affaire du marquis de Gouy que l'avocat Linguet fit ses débuts à la barre.
Cette affaire de séparation de corps au XVIIIe siècle, dans le grand monde de
la cour, est fort curieuse par elle-même, mais elle a aussi l'avantage de
montrer mieux que toute autre les qualités de Linguet. La marquise
était, quant à elle, défendue par Maitre Gerbier, « un des plus grands orateurs que
la France ait produits », surnommé l'Aigle du barreau.
Linguet gagna la cause du marquis et le Parlement rejeta la demande en
séparation de corps et de biens par sentence du 22 février 1772.
Après cela la marquise cessa d'habiter avec son mari et celui-ci lui
donna un hôtel rue Cassette, loué 4 000 livres. Elle y avait huit domestiques,
une voiture et des chevaux.
Le 9 mai 1775, le marquis acheta une maison rue de la Chaussée d'Antin, la seconde à droite après la rue de Provence, bâtiment, cour, jardin
et autre dépendances, et un terrain situé derrière le dit jardin, joignant le
maison du comte de Bezon, moyennant 88 000 livres, ainsi que le mobilier
garnissant la dite maison, pour 4 000 livres. Un autre description de l'époque situe cet hôtel rue de Provence, entre la rue de la Chaussée-d'Antin et les écuries d'Orléans. C'est dans cet hôtel qu'il
décéda quinze ans plus tard, en laissant l'usufruit à sa fille Monique et la
propriété à sa petite-fille Aurore.
Prétendant avoir éprouvé depuis des mauvais traitements de la part de son
mari, la marquise forma une nouvelle demande en séparation, laquelle fut
encore déclarée non recevable par une sentence du Châtelet du 29 février
1776, confirmé par un arrêt du 3 mars 1777. Le 24 avril suivant Louis achetait 14 toises
(à peu près 28 m) de terrain autour de son hôtel.
Le 23 mai 1778 Louis fait aveu et dénombrement du fief de Dampmarest.
Il est promu lieutenant général le 1er mars 1780. Son fils Louis-Marthe épouse le 12 juin suivant une "créole" de Saint-Domingue, la riche Amable Hux de Bayeux.
Veuve depuis 8 ans, sa fille Monique épouse le 26 février 1787 le comte Barthélemy O'Mahony.
A l'occasion de l'annonce du décès de sa petite-fille, Louis juge bon de faire une mise au point dans le Journal de Paris du 20 février 1789 :
il est le marquis de Gouy et son fils est le marquis d'Arsy.
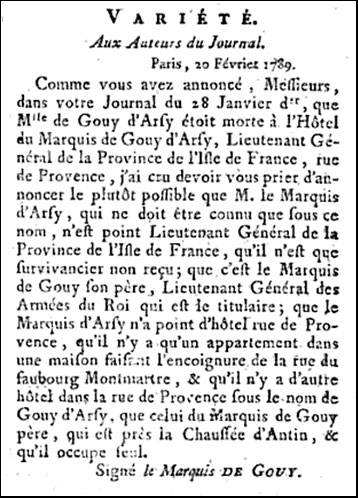
Il siége à l'Assemblée générale
des Trois-ordres du bailliage de Clermont-en-Beauvaisis, dont il est
gouverneur, qui se tint le 9 mars 1789. Le 11 mars eut lieu une délibération relative à un "combat de fief" entre le prince de Condé et le marquis de Gouy (archives du château de Chantilly).
Dans l'acte du 20 avril 1789 donnant à Barthélemy O'Mahony le tutorat de sa belle fille Aurore des Salles, Louis est qualifié
Très haut et très puissant seigneur Louis, marquis de Gouy, lieutenant général des armées
du Roi et de la province de l'Isle de France au département du Vexin français, comandant
pour Sa Majesté des ville et château de Clermont en Beauvaisis, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, baron de Chars et de Ressons, seigneur d'Arsy, Avrigny,
Ricquebourg, la Neufville, haut et bas Matz, Marine, Santeuil, Fremencourt (Frémécourt),
Brignacourt (Brignancourt), Bréançon, le Ruel, le Rosnel, Gerocourt, Senecourt, Liancourt, et demeurant
en son hôtel de Paris rue de la chaussée d'Antin, paroisse Saint-Eustache, grand-père
paternel.
Louis s'éteignit avant sa femme, à l'âge de soixante treize
ans, le 10 avril 1790, dans son hôtel de la rue de la Chaussée d'Antin à Paris,
libérant ainsi la dame de Rivié, son épouse, du joug dont elle essayait de se
défaire depuis plus de vingt ans. Cette mort épargna au marquis deux
choses : d'une part les pires excès de la Révolution qui devaient emporter
son fils et d'autre part le divorce que les lois de la République naissante
n'allaient pas tarder à autoriser et que sa femme n'aurait pas manqué de
demander. Il laissait 4 petits-enfants : Aurore des Salles (11 ans), Ange-Emmanuel (8 ans) et Athanase (5 ans) de Gouy d'Arsy, Arsène O'Mahony (3 ans).
De ses arrière-grands-parents Gouy d'Arsy, Paul O'Mahony, conservait 2 petites miniatures ovales les représentant et une paire de pistolets d'arçon montés en argent, sans doute détruits dans l'incendie
de son immeuble durant la Commune de Paris.
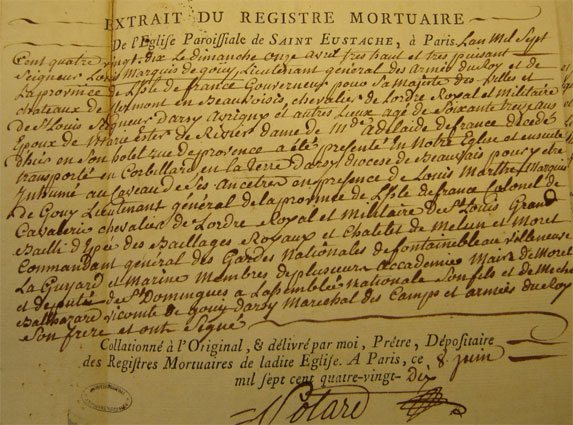
Extrait du registre mortuaire de la paroisse Saint-Eustache de Paris
-cliquer sur l'image pour agrandir-
Louis fut inhumé dans le caveau de ses ancêtres à Arsy, comme cela est
rapporté dans le registre cette commune :
« L'an mil sept cent quatre vingt dix, le lundi douzième jour du mois d'avril, le corps de très
haut et très puissant seigneur messire Louis, marquis de Gouy, lieutenant général des
armées du Roi et de la province de l'Ile de France au département du Vexin français,
gouverneur pour Sa Majesté des ville et château de Clermont-en- Beauvaisis, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur d'Arsy, Avrigny, et autres lieux, âgé
d'environ soixante treize ans, époux de dame Marguerite Antoinette Esther de Rivié,
dame de Madame Adélaïde de France, décédé à Paris en son hôtel rue de la Chaussée
d'Antin, le dix du courant, nous a été apporté de l'église Saint-Eustache, sa paroisse, où il
a été présenté par Messire Joseph de Laleu, docteur en théologie de faculté de Paris, vicaire
de la susdite paroisse, et par Messire Pierre Charles Patard, prêtre receveur des convois de
la dite paroisse, et a été inhumé par nous prêtre curé soussigné au caveau ordinaire des
seigneurs de la paroisse de Saint-Médard d'Arsy-en-Campagne pratiqué sous la chapelle
des dits seigneurs et ayant son entrée sous le pupitre de la dite église, en présence de Charles
Louis de Blainville, secrétaire du dit seigneur, chevalier de Saint Louis, avocat et procureur
au parlement, exécuteur testamentaire du dit défunt, et ayant charge et pouvoir ainsi qu'il
nous l'a déclaré de représenter Louis-Marthe, marquis de Gouy, lieutenant général de la
province de l'Ile de France, colonel de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, grand bailli d'épée des villages royaux et châtelet de Melun et Moret,
commandant général des gardes nationales de Fontainebleau, Villeneuve-la-Guyard et
Marines, membre des académies Royales des Belles Lettres, Sciences et Arts de Richemont
en Virginie, de Marseille, de Châlons et d'Arras, maire de la ville de Moret et député de
Saint-Domingue à l'assemblée nationale, lequel retenu à Paris par des devoirs
indispensables envers la Nation dont il a l'honneur d'être l'un des représentants, n'a pu
dans les circonstances critiques où se trouve la patrie à laquelle il se doit tout entier,
accompagner le corps de Monsieur son père jusqu'à Arsy, mais après avoir assisté à la
présentation à Saint-Eustache de Paris, nous a prié de vouloir bien l'accompagner en son
lieu et place et lui donner cette preuve d'attachement, et ont signé. »
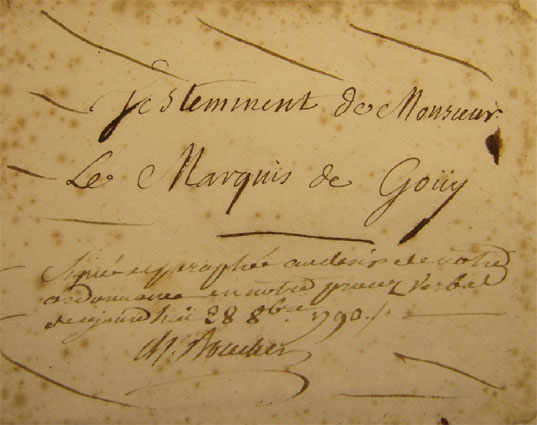
Enveloppe contenant le testament (chez ME Trutat, notaire à Paris)
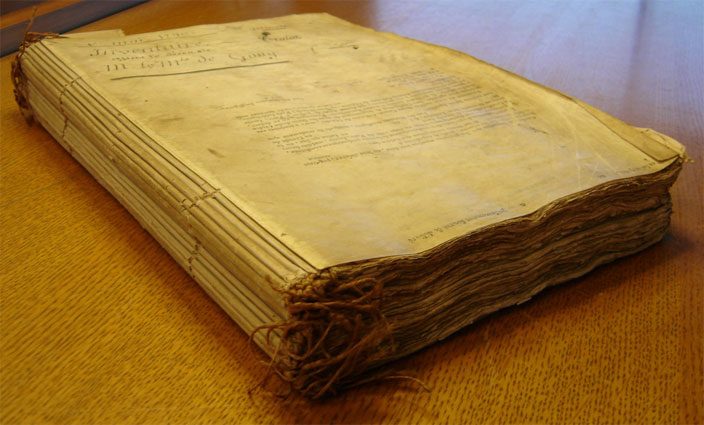
Inventaire après décès du 1er mai 1790 [AN - ET/LVIII/0565]
(SHAT 1 YD 1054)
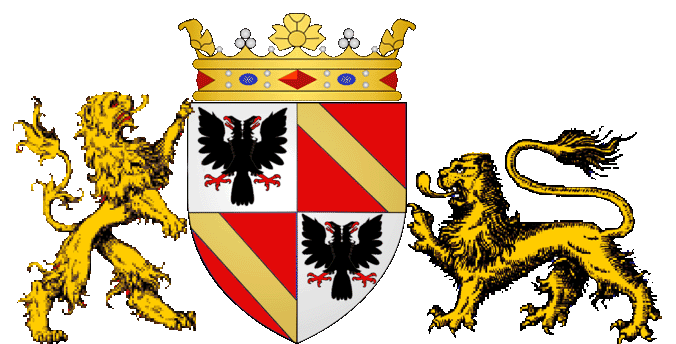
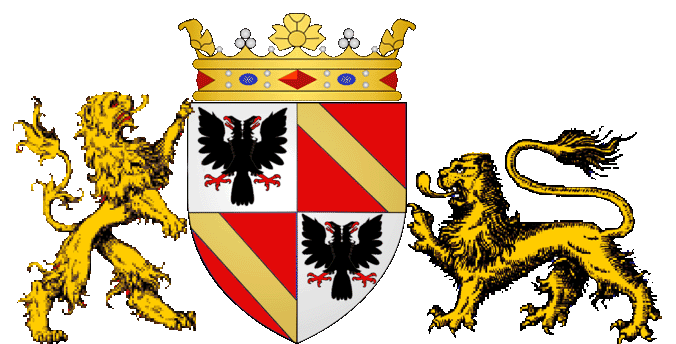






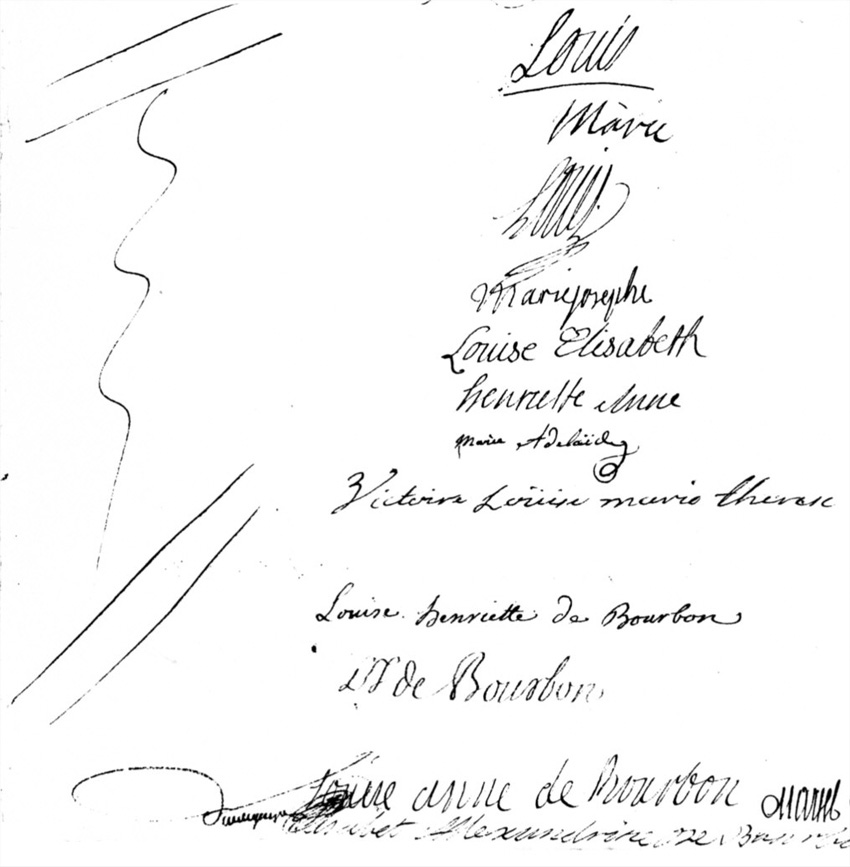 ,
,