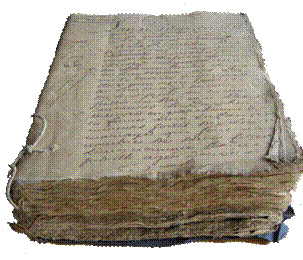Ajout page 425
Famille
Quesnel de la Morinière
Le 31 août 1819, fut fait
et passé au château la Chapelle-Bouëxic (35) le contrat de mariage entre
Zulmée QUESNEL de LA MORINIERE, âgée de 24 ans, demeurant présentement avec ses parents au
dit château, et Charles-Félix d’AMPHERNET,
vicomte de PONTBELLANGER, chef d’escadron, officier de l’ordre
royal de la Légion d’honneur, majeur de trente ans, demeurant à Allaire
(château de Vaudequip). A cette occasion la marquise du Grégo, mère du marié,
abandonnait aux époux, en échange d’une
pension à elle et à sa femme de chambre,
l’usufruit qu’elle s’était réservé sur la terre de Vaudequip et ses
dépendances sises dans les communes d’Allaire et Saint-Jacut, département du
Morbihan. La minute fut signée Zulmée Quesnel de la Morinière, Charles F.
Damphernet, vicomte de Pombellanger, de La Caunelays marquise du Grégo,
Quesnel, L. Dubot du Grego baronne de Bonté, F. Quesnel née Cristi de la
Morinière, Bonté, de Robillart (sous-préfet de l’arrondissement de Redon),
Ropert (chef d’escadron retraité, lieutenant de louveterie), Adelphe Quesnel,
Le Normand et L. Degage, Notaire. (Enregistré à Redon le 3 septembre suivant).
Tous se rendirent ensuite, vers les onze heurs du matin, à la mairie pour
procéder à la célébration de leur mariage projeté entre eux et dont les publications ont été lues et affichées
tant en cette commune qu’en celle d’Allaire. Le dit mariage se fit avec
l’agrément de Sa Majesté Louis
Dix-huitième du Nom, Roi de France et de
Navarre qui signa leur contrat.
|
|
Charles-Félix
a épousé Monique Zulmée Quesnel de la Morinière à la Chapelle-Bouëxic La
maison seigneuriale de la Chapelle du Bouëxic, située en la paroisse de Guignen,
diocèse de Saint-Malo, est un des plus importants de l’arrondissement de
Redon. Il consistait selon l’aveu rendu au Roi en 1680, en un grand corps-de-logis au bout duquel sont orangeries et galeries
avec cour dans laquelle sont les écuries, remises de carosses et mesnageries,
jardin au derrière de la maison, bois de haute futaye, promenoir, étang,
canaux et fontaine au milieu du jardin, le tout en un tenant cerné de
murailles. Ce château, qui avait été édifié par Yves le Bouëxic, est
passé aux mains des Quesnel de la Morinière après 1754. Ils ne le
conservèrent pas longtemps puisqu’il passa aux Menou qui le possédaient en
1874 et l’habitent encore. Le château fut pillé le 19 janvier 1790 par une
bande de 600 personnes environ. On brisa des meubles, des portes, des fenêtres, on commit des
dégâts de toutes sortes, on prit divers objets et de l’argent, mais le fait
capital paraît avoir été l’incendie des papiers seigneuriaux, qui furent
ramassés dans le cabinet du procureur fiscal et brûlés entièrement dans la
cour. |
|
Le château dans lequel eut lieu ce mariage appartenait au
père de la mariée, Jean-Jacques QUESNEL de LA MORINIERE, né à Coutances le 24
avril 1765 de Jacques-Benoit Quesnel, sieur de la Boudière, lieutenant général
criminel au bailliage et siège présidial de Coutances, et de Madeleine Monique
Simon. Il épousa le 31 juillet 1794 Marie Charlotte, fille de Pierre CHRISTY, anobli en 1775, écuyer, sieur de la Morinière, seigneur et
patron de Hauteville-sur-mer, lieutenant particulier civil et criminel au
bailliage et siège présidial de Coutances, et de Charlotte Bonté, tante du
général Bonté, futur époux de Louise du Bot du Grégo.
|
La mariée, qui avait une sœur d’un an son aînée
(Reine-Judith) était orpheline, ayant perdu son père à 11 ans (1786) et sa
mère à 13 ans (1788). Leur tuteur principal avait été Jean Joseph Aimable
Bonté, qui fut premier grand vicaire du diocèse de Coutances après le
Concordat. Leur père leur avait légué de grands biens, si l’on en juge
par l’inventaire après décès ci-contre fait en sa demeure de la rue des Douves
des moines, paroisse Saint-Nicolas de Coutances le 24 août 1786 et dans celle
des Miellettes, paroisse du Pirou, le 31 août suivant [Archives du château du
Grégo aux AD de Vannes]. |
|
Le fief noble de Hauteville qui avait appartenu à
Monseigneur de Longueville, était passé à Pierre-Julien YNOR, conseiller du Roi, maître en sa cour des comptes, aides
et finances de Normandie, qui le transmit à sa fille Marie Perrette, épouse
d’André Christy, grand-père de Marie Charlotte. C’est du reste cette dernière
qui, encore mineure, figura à l’assemblée des trois ordres du grand bailliage
de Coutances le 16 mars 1789, son père étant décédé. André Christy, grand-père de la mariée, fut maire de
Coutances de 1765 à 1770. |
Sieur de la Morinière du chef de son épouse, connétable du
Roi, Jean-Jacques descend d’une famille de magistrats dont le berceau se trouve
dans la paroisse d’Urville-la-Chanoine, devenue section de Regneville. Les
Quesnel habitaient dès le quinzième siècle, et sans doute avant, un petit
village de cette paroisse, appelé le Hamel
du Roi, plus tard déformé en Le Rey.
Les Quesnel, gens aisés, semblent avoir été aux quinzième et seizième siècles
les principaux habitants de ce village. Depuis la seconde moitié du seizième
siècle, ils comptent de nombreux avocats et magistrats à Coutances.
Mais
en 1839, Jean-Jacques Quesnel de
la Morinière se sépara
des terres familiales qu’il possédait tant sur Urville que sur Regneville et
Montmartin, soit dix-huit hectares divisés en 20 lots, dont son grand-père avait
héritées de son frère Jacques Quesnel, curé de la paroisse Saint Nicolas de
Coutances, décédé en 1701.
Mais il possédait par ailleurs
de grands biens, si l’on en juge par
l’inventaire de sa succession et notamment l’actif de la succession de
Jean-Jacques s’élevait à 1.257.450 francs pour les immeubles :
|
1°. 2°. 3°. 4°. 5°. 6°. 7°. 8°. 9°. 10°. 11°. 12°. 13°. 14°. 15°. 16°. 17°. 18°. 19°. |
Hôtel de Coutances et dépendances Maison dite du Puits Sainte-Anne Jardin de Bulsard Maison Laurent Maison Casrouge Maison Goufrey Ferme de la Mare, château et dépendances Ferme du Hurey Ferme de la Closerie située à Cambernon (50) Les Vardes Ferme de la Chape Meslier Ferme de l’Ectot, située à St Denis-le-Vêtu (50) Ferme de la Becquetière, située à Anneville (50) Ferme de la Vilette, près Coutances (50) Ferme Dubois (Saint-Pellerin, Carentan) Ferme de la Romerie Le domaine du Pirou, situé à Pirou (50) La terre du Miellette, située à Montsurvent (50) Pièce dite la Folie, située à Monthuchon (50) |
60.000 2.400 800 4.000 5.500 9.000 150.000 20.000 32.000 13.300 83.000 60.000 104.000 85.000 180.000 100.000 345.000 3.000 450 |
Inventaire
de la succession de M. Quesnel dela Morinière |
Le mobilier s’élevait quant à lui à 422.684 francs.
Le premier sur la liste de l’immobilier est l’ hôtel de Coutances et dépendances. Il s’agit d’une propriété acquise
en 1824, composée d’un hôtel particulier nommé le Poupilel (actuel musée de la ville) et de jardins composant
l’actuel jardin public, qu’il lèguera à la ville de Coutances à sa mort.
Cet hôtel, situé dans l’ancienne
rue des Cohues, appartenait à
Antoine-Charles Le Poupinel qui, ayant acquis un office de secrétaire de Roi
allait être anobli vers 1770, raison qui le força à émigrer en 1791. De retour,
ayant besoin d’argent, il vendit son hôtel en 1803 à François-Louis d’Ouessey.
Par
un état des lieux. dressé le 7 novembre 1792 par Jacques Philippe Charrette,
architecte, demeurant à Coutances, expert nommé par le citoyen administrateur
du District de Coutances pour faire l'estimation des biens nationaux à vendre,
nous en avons une description très précise. (Archives Municipales de
Coutances). Le principal Corps de logis, situé rue des Cohues, percé d'une
entrée avec porte cochère -tel qu’il se présente aujourd'hui- comprenait,
alors, au midi de cette entrée deux remises et un cellier et au nord toujours
de cette entrée une cuisine, office et laverie {sous ces dernières cave et
caveau voûtés). Si l'aile nord, à l'intérieur de la cour, était constituée
comme elle l'est actuellement, d'un vestibule avec escalier à 6 volées
(construit en bois et pavé de "Caur" avec une rampe de fer) et d'une
salle et office, (l’orangerie étant de construction beaucoup plus tardive: fin
19ème siècle) l'aile sud abritait alors une grande écurie voûtée et un escalier
conduisant aux greniers du Corps principal et à un appartement situé au-dessus
de cette écurie, qui était en voie d'aménagement, ne contenant encore aucune
cloison (c'est la famille Ouessey -devenue propriétaire de cet Hôtel en 1803-
qui terminera les travaux et installera une cuisine au rez-de-chaussée dans une
partie de l'écurie). Au bout nord du mur de la cour était un petit pavillon
formant "les lieux d'aisance". Au premier étage du corps principal se
trouvaient une antichambre pavée de carreaux blancs, une grande salle de 30
pieds sur 26 pieds pavée en petits tuilots de terre cuite et ayant 3 croisées
au levant et 3 croisées au couchant (ces dernières étant les seules croisées de
la façade ouest alors que la façade est, sur la rue, en comprenait 8), un
cabinet de compagnie parqueté et une petite chambre avec antichambre. Les
Ouessey changeront quelque peu l'ordonnance de ces pièces et
"parquèteront" l'antichambre et la salle devenues" leur salon).
L'aile Nord comprenait au 1er étage une chambre et 2 cabinets et au second
étage une chambre à coucher avec alcôve, 2 cabinets, garde-robe et 2 mansardes.
Le 14
juillet 1790, Antoine Charles Julien le Poupinel, écuyer, Seigneur de
Quettreville et de la Porte, ancien Capitaine de Cavalerie et Chevalier de
l’Ordre royal et militaire de St-Louis, était nommé commandant des Compagnies
de la Garde Nationale de Quettreville. Pourtant, inquiet sans doute par la
tournure que prenaient les évènements, il devait quitter la France en 1791 et
s’exiler à Coblence, en pays rhénan, lieu de ralliement de la noblesse
française.
Devant le
nombre sans cesse grandissant de ces émigrés, l'Assemblée Constituante vota le
9 novembre 1791 une loi par laquelle
"Tout émigré qui n'était pas rentré le premier janvier 1792,
encourait une peine de mort et la confiscation de ses biens". Antoine le
Poupinel ne rentra pas en France et si ses seigneuries, manoirs et terres de
Quettreville et de la Porte au village St Nicolas de Coutances devenaient propriétés
nationales, il en fut de même pour son Hôtel rue des Cohues (aujourd'hui: rue
Quesnel Morinière) qui aujourd’hui abrite le Musée Municipal et dont les
jardins sont devenus le Jardin Public de Coutances. La ville de Coutances ne le
vendit pas mais y logea sa municipalité de 1793 puis le commandant de la Place
en 1795 et de nouveau sa municipalité en 1801.
Pendant ce temps, le Coup d'État du 18 brumaire An
VIII (9 novembre 1799) par Bonaparte et le Concordat que ce dernier signait le
16 juillet 1801 devaient mettre fin à la guerre civile de la Révolution qui
avait souvent ensanglanté le pays. Antoine Le Poupinel revint de son exil. Il
s'installa è Monthuchon et rentra en possession de son hôtel de Coutances.
Privé de ses revenus il prit la décision de le vendre, ce qui fut fait le 19
pluviôse an XI (8 février 1803). L’acquéreur était Gabriel-François
d’Ouessey. A la mort de celui-ci en 1823,
l’hôtel fut mis en adjudication le 14 juin 1824 et vendu à main levée le 8
octobre de cette même année à Jean-Jacques Quesnel de la Morinière pour la
somme de 20.005 francs, hôtel et jardins compris.
En janvier 1852, la ville apprend qu’il lui lègue
par testament [du 1er janvier 1850 chez M° Bouillon à Coutances] son
hôtel particulier de la rue des Cohues à la condition qu’il soit d’utilité
publique et que les jardins deviennent un parc municipal où seraient cultivées
des plantes médicinales. La municipalité accepta, et, en récompense, attribua
son nom à la rue qu’il habitait, et qui de la rue des Cohues devint la rue
Quesnel-Morinière.
Adèle Sébastien Minel (1789-1869),
officier du génie retraité et aquarelliste, développa les plans du jardin en y
mêlant terrasses à l’italienne, bosquets à l’anglaise, labyrinthe et jets
d’eau. Un obélisque en granit fut érigé en mémoire du donateur Quesnel de La
Morinière. Les travaux d’aménagement sur trois niveaux s’achevèrent en
1855 ; le jardin devint un précurseur et un modèle des jardins du XIXe
siècle, tout en étant contemporain des premiers jardins paysagers parisiens. Le
jardin de Coutances a été inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques en 1992.


L’hôtel Poupinel, côté jardins et côté rue


Le monument élevé dans le jardin des plantes
« à Jean-Jacques Quesnel-Morinière, la ville de Coutances reconnaissante »
« Je
donne et lègue à la ville de Coutances mon hôtel où je demeure avec les
terrains et jardins en dépendant et autres maisons diverses occupées ou non
occupées y attenant avec aussi mes plantes de serre et d’orangerie pots à fleurs
vides et pleins le tout sis à Coutances
rue des cohues tels qu’ils se consistent sans réserve aucune. Je désire
et veux que l’objet de ce legs serve à un établissement d’utilité publique, que
les jardins soient jardins publics, qu’on y cultive et qu’on y trouve plantes
usuelles et médicinales à l’usage gratuit des indigents et surtout que le tout
soit parfaitement tenu et entretenu. »
Ce legs ne
se fit pas sans difficultés si l’on en juge par cette déclaration faite le 17
novembre 1852, aux habitants en général
de la ville de Coutances, dans la personne de Monsieur Brohyes leur maire
à la requête de Madame Monique Zulmé
Quesnel, vivant de son bien, veuve de Monsieur Charles Félix, vicomte d’Amphernet
de Pontbellanger, domiciliée à Rennes et demeurant présentement à Coutances au
lieu de sa résidence rue des Cohues :
« Madame
de Pontbellanger ne saurait consentir à la demande de la ville de Coutances
relativement aux fruits des biens que lui a légués son père, car il en
résulterait pour elle un préjudice qu’elle ne doit supporter ni en droit ni en
équité. En effet si les immeubles légués à la ville de Coutances eussent
produit des fruits, il serait de toute justice de les lui concéder ; si
même ces biens ne fussent restés improductifs que par le fait de Madame de
Pontbellanger, elle pourrait encore, au moins équitablement en être déclarée
responsable, mais lorsque Monsieur Quesnel, testateur, n’avait pas loué les
mêmes biens, lorsqu’une partie a même été laissée dans un état de dégradation
tel qu’il est en quelque sorte impossible d’en tirer parti sans y faire des
réparations extrêmement considérables, lui réclamer des fruits pour des
immeubles qui n’ont pas pu en produire, c’est élever une prétention évidemment inacceptable
pour le passé. Madame de Pontbellanger proteste donc contre cette demande, et
quant à l’avenir, si elle se trouve légalement obligée sous ce rapport envers
la ville, elle déclare que pour n’être pas lésée dans ses intérêts elle louera
immédiatement aux enchères publiques les immeubles légués, en sorte que la
ville pourra ainsi profiter de leurs loyers en exécutant les contrats de louage
qui en aura été consenti.
En
ce qui concerne la délivrance du legs, Madame de Pontbellanger fera observer
que parmi les biens légués, il en est dont la propriété exclusive appartenait
bien au testateur et que quant à ceux-là, elle consent dès à présent la
délivrance, ainsi que des orangers et autres arbustes, plantes et objets
mobiliers compris dans le legs, en autorisant pour ce qui la concerne, la ville
de Coutances à s’en mettre immédiatement en jouissance. Ces biens consistent
dans ceux légués, sous la seule exception de la maison principale avec les
jardins, connus sous le nom de l’hôtel d’Ouessey et ses dépendances ; et
en ce qui touche ces derniers immeubles, elle déclare également être prête à en
consentir la délivrance, pourvu que les autres héritiers de Monsieur et Madame
Quesnel, ses père et mère, passent le même consentement ; mais comme ces
derniers biens constituaient au respect de Monsieur et Madame Quesnel un acquêt
en bourgage [mode de tenure particulier
usité en Normandie pour les maisons des villes et bourgs] que par suite la
requérante et les enfants et représentants de son frère sont fondés à y
exercer, du chef de Madame Quesnel, leur mère, belle-mère et aïeule, des droits
de propriété dont il n’est même pas possible de déterminer présentement l’étendue
puisqu’aucune liquidation n’est encore intervenue, tant au sujet de la
succession de cette dame que relativement à ses droits dans les acquêts en
bourgage, elle ne saurait comme pour les premiers en consentir purement et
simplement la délivrance ; elle doit cependant faire observer qu’elle ne
concevrait pas comment la ville éprouverait à cette occasion un refus de la
part des autres parts intéressés attendu qu’elle déclare consentir à supporter
seule, mais bien entendu jusqu’à concurrence seulement de la quotité de ses
biens dont son père pouvait disposer au préjudice de ses héritiers à réserve, l’exécution
du legs dont il s’agit, obéissant faire raison dans la limite de la même
quotité à la masse successorale de sa mère de l’importance des droits qui
seront reconnus pour la liquidation, lui compéter dans les mêmes immeubles, à
moins donc que les cohéritiers de la requérante ne tiennent à exercer en cette
matière leurs droits dans lesdits biens, cette délivrance ne saurait leur
causer le plus léger préjudice, puisqu’ils seront rendus complètement indemnes
d’abord par la requérante dans les limites ci-dessus, et ensuite par la ville
dont les droits ne sauraient excéder les mêmes limites ; mais si contre
toute attente il en était ainsi, il ne serait plus au pouvoir de Madame de
Pontbellanger de les empêcher d’exercer un droit dont elle les croit bien
propriétaires, etc. »
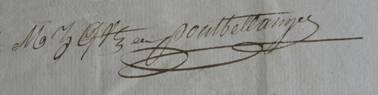
Signature de Zulmé au bas de
cet acte de 1852
En n° 7 sur la liste, se trouve
la ferme de la Mare, château et
dépendances. Le 11 thermidor an IX
(30 juillet 1801), Jean Jacques Quesnel de la Morinière achète à Bernard Hue de
Caligny, pour 52.000 livres, devant maitre Langlois, notaire à Valognes, le
fief de la Mare, « sans aucune
réserve ni retenue, seulement est exceptée la chapelle de la Mare et le terrain
en dépendant, » celle-ci ayant été
saisie comme édifice religieux, et revendue comme bien national. Sur ce nouveau
domaine, son fils fera construire par Émile Guy, en 1841, une importante
propriété, aujourd’hui détruite, appelée le château
de la Mare. Des étages supérieurs de cette grande maison entourée d’un parc
planté d’arbres verts, on découvrait la mer et un vaste horizon. Au décès de
son fils, Jean-Jacques rentra en possession du domaine. Dans son testament daté
du 4 mars 1851, il léguait au Séminaire de
Coutances ses maisons et terres de La Mare, d’une
contenance d’environ 360 vergées, pour en faire une résidence utile et
salubre pour la santé et promenade dudit
séminaire. Mais les héritiers contestèrent et par suite d’un arrangement
le séminaire ne conserva que la ferme de la Guérie.

Le domaine de la Mare
En n° 12 et 13 se trouvent les fermes de la Becquetière (Gesfosses), dont il
reconstruisit en 1834 la pêcherie d’Anneville, et d’Ectot (Saint-Denis-le-Vêty et Saussey), terres situées dans la Manche
dont il fit l’acquisition en 1825.
En n° 17 de la liste, se trouve le bien dont la
valorisation est la plus élevée : la
ferme du Pirou. A la fin du XVIIIè siècle, le château du Pirou, un des plus
anciens de Normandie, cessa d’être habité
noblement et devint une ferme vendue à Huguet de Sémonville qui le revendra à Jean-Jacques Quesnel Morinière, riche
propriétaire de Coutances, qui l’a transmis à ses héritiers.
Dans l’Annuaire du département de
la Manche publié en 1861 par Julien Jules Travers, on peut licre ceci :
« On voyait encore à Pirou, il y a quelques années, un emplacement nommé
la mare du Pirou, qui offrait une étendue de 55 hectares, couverte d’eau. Grâce
à des travaux entrepris avec intelligence, M. Quesnel de la Morinière, à qui
appartenait cette vaste mare, est parvenu à la dessécher et à en livrer le
terrain à l’agriculture. Il a, pour conduire les eaux à la mer, établi un canal
en maçonnerie qui a 1265 mètres de longueur, 70 centimètres de largeur et 1
mètre 40 centimètres de profondeur. L’auteur de ces travaux, si profitables aux
intérêts agricoles, mérite d’être signalé à la reconnaissance publique. »


La ferme du Pirou
Dans son
testament du 4 avril 1851, Jean-Jacques Quesnel-Morinière donne et lègue à titre de préciput et hors part à ma fille Monique
Zulmé, veuve de M. de Ponbellanger, demeurant à Rennes, le tiers de tous les
meubles et immeubles qui m’appartiendront à mon décès. Pour le reste, Zulmé
était héritière pour moitié de la succession de son père et de sa mère, l’autre
moitié étant partagée entre les deux filles de son frère. Elle resta veuve
durant 40 ans, de 1827 à 1867, jouissant de l’usufruit de tous les biens de son
époux, meubles et immeubles, à la charge
de nourrir, élever, entretenir et éduquer leurs enfants [respectivement 7 ans
et 5 ans à la mort de leur père] selon leur rang et fortune et de les doter en
cas de mariage. Dans ce même testament du 19 juillet 1826, le vicomte de
Pontbellanger léguait à son fils Michel Adrien, la terre de Trévarez avec ses
titres, et hors part, la terre de Pontbellanger, pour en jouir après la
cessation de l’usufruit.
Jean-Jacques
était veuf depuis 1826.
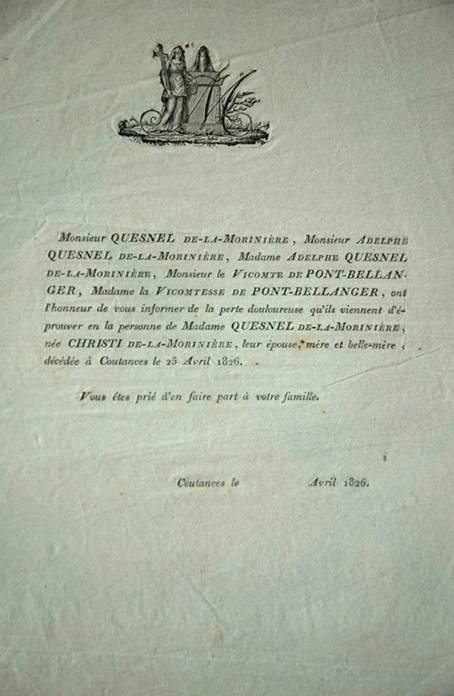
En 1855,
Monique Zulmé Quesnel de la Morinière, vicomtesse de Pontbellanger, touchait 38.785
francs de revenus annuels de ses fermes du Peroney à Coutances (505 francs), du
Four à ban à Servigny (1400 francs), de la Basse cour à Servigny (1094 francs),
de la Morinière ou des Mielettes, Marais et Mielles au Pirou (4.000 francs), de
la Closerie à Cambernon (1500 francs), de Bois à Saint Pellerin (6.400 francs),
de La Villette au Plessis (3.000 francs), de la Becquetière à Anneville (3.000
francs), du Courtil Manbard à Anneville
(135 francs), de La Folie à Monthuchon (15 francs), de la Fosse à Mondin au
Pirou (40 francs + 45 francs), toutes fermes dont les baux se renouvelaient à
la Saint-Michel comme de coutume. A ceci s’joutaient les locations d’herbages
pour 6700 francs, de mielles [nom donné dans la Manche à des plaines de sable
voisines de la mer dont une partie est cultivée] au Pirou (dans les Miellettes)
pour quelques dizaines de francs. De plus elle toucha 570 francs d’arrérages
[versement périodique] de ses rentes et 1641 francs de diverses opérations
(ventes et autres). Les dépenses pour la
même période s’élevant à 33.265 francs, le reliquat net en sa faveur se montait
à 7.731 francs [A titre d’information 1kg de pain valait 32 centimes, 1kg de
pommes de terres 7 centimes, 1l de lait 8,5 centimes, 1 l de vin 1,50 centimes,
1 robe 5 francs, 1 paire de chaussures 6,40 francs. Un vendangeur touchait 1,50
francs par jour plus deux miches de pain d’une livre].
A son
décès deux lots furent constitués et tirés au sort entre le comte de
Pontbellanger et la comtesse de Virel, frère et sœur.
Dans
le 1er lot, échu au comte de Pontbellanger, se trouvent la ferme
dite Le Bois ou Du Bois, la terre ou ferme appelée Les Miellettes, ? de
Mielles, situées sur la commune de Pirou, une ferme dite La Chape Meslier, une
ferme appelée La Clauserie ou Closerie dans la commune de Cambernon, une terre ou
ferme appelée Le Peroney située à Coutances et un certain nombre de rentes.
Dans
le second lot, échu à la comtesse de Virel, se trouvent deux fermes situées
dans la commune de Saint-Fromant, une terre ou ferme nommée La Villette près de
Coutances, une ferme appelée la Becquetière à Anneville, une terre appelée La Basse cour à Servigny , une terre appelée
le Four à ban à Servigny, une terre appelée
la Bergerie à Servigny, un moulin
à eau dit Moulin du four à ban, une ferme appelée la ferme d’Ectot située à St Denis-le-Vêtu, et un certain nombre de
rentes.
Monique Zulmée avait un frère, Adolphe Félicisme
marié le 5 octobre 1825 à Saint-Vigor-le-Grand (14) avec Anne Desmares, d'où descendance d'Annoville et Laforcade.
è retour ç