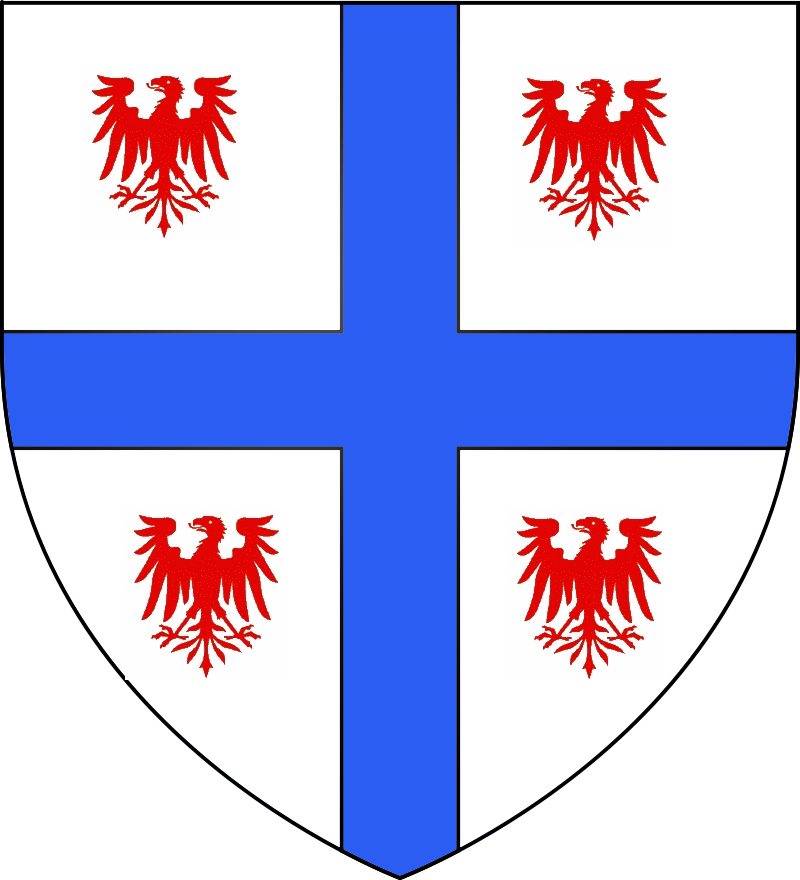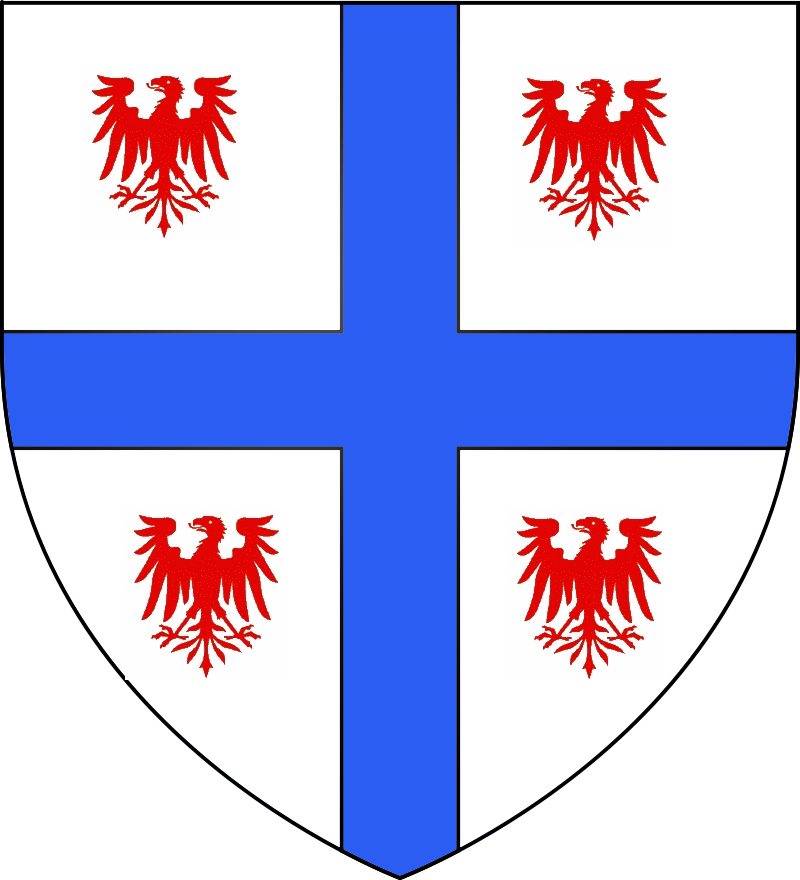Jean de Montagu
Trésorier de France (1388)
Chambellan du roi (1397)
Grand maître de France (1401)
Membre du conseil du roi Charles VI
Aquarelle d'après une pierre en relief et colorée du temps, dans la chapelle du château de Marcoussis (BnF)
Armoiries de la famille de Montagu
Le sire de Montaigu était le fils aîné de Gérard de Montaigu, notaire de Paris anobli par le roi Jean en 1365 et qui était devenu son secrétaire
et trésorier de ses chartes, et de Biette Cassinel, sœur de l'archevêque de Reims.
Il naquit au plus tard en 1349 ou 1350. Cette date, qu'on pourrait croire tout d'abord assez indifférente, ne laisse pas que
d'avoir une certaine importance, car elle répond à un bruit injurieux qui courut lors de la disgrâce du Grand Maître.
On prétendit que sa grande fortune était due à ce qu'il était le fils naturel de Charles V. Or ce roi naquit le 21 janvier 1338
et il résulte d'un contrat d'acquisition de Jean de Montagu que celui-ci était déjà majeur le 31 octobre 1366. On sait de plus qu'il eut pour parrain Jean, depuis Roi de France en 1350, alors que ce prince n'était alors que duc de Normandie. Ainsi Charles V avait au plus 12 ans lors de la naissance du grand maître.
Quoiqu'il en soit, si Jean de Montagu n'est pas le fils de Charles V, on ne peut nier que la beauté de Biette de Cassinel n'ait été pour quelque
chose dans la grande fortune de son mari et de son fils. Il est probable que cette femme fit servir au profit de son ambition
l'amour qu'elle était parvenue à inspirer au dauphin Charles, malgré la différence d'âge qui les séparait. Certains auteurs
disent que celui-ci afficha publiquement cet amour en faisant représenter sur ses armes, suivant la galanterie du temps,
un rébus de Cassinel, qui était un K, un cygne et une aile, faisant référence à Juvenal des Ursins qui écrit pour l'année 1414 :
Le roi et monseigneur le dauphin, après qu'ils eurent été à Notre-Dame de Paris faire leurs offrandes et dévotions, partirent de Paris
et estoit monseigneur le Dauphin joly, et avoit un moult bel estendart, tout battu à or, ou avoit un K, un cygne et une L. La cause estoit,
pourcequ'il y avoit une damoiselle moult belle en l'hostel de la royne, fille de Guillaume Cassinel, laquelle vulgairement
on nommait Cassinelle. Si elle estait belle, elle estait aussi très bonne et en avait la renommée. De laquelle, comme on disait,
ledit seigneur faisoit le passionné, et pource portait-il le dit mot. Mais ils se trompent de personnages : le dauphin est alors Louis, fils de Charles VI, et "la Cassinelle" est Gérarde Cassinel, nièce de Biette, dont on peut supposer que son influence n'est pas étrangère à la réhabilitation de Jean de Montagu.

Jean de Montagu, vidame de Laon, seigneur de Montagu près de Poissy, de Marcoussis, du Bois-Malherbes, de Tournansuye, etc., chevalier,
conseiller et chambellan du Roi et souverain Maître de son Hôtel, fut secrétaire du roi Charles V qui le chérit beaucoup,
ainsi que le roi Charles VI son successeur, duquel il reçut plusieurs gratifications.
Il parut de bonne heure à la cour de Charles V, et
ce prince, soit par amitié pour son père, soit par amour pour sa mère, prit le jeune seigneur en affection, et le favorisa toute
sa vie en le rendant un sujet capable de seconder ses desseins.
Nous trouvons peu de traces de Jean de Montagu sous Charles V. Nous savons seulement que ce prince l'avait choisi pour un de ses secrétaires,
qu'il se servait volontiers de ses conseils, et qu'il l'admettait aux délibérations secrètes de son cabinet.
Sous Charles VI au contraire, nous pouvons suivre annouveau Roi avait en grande affection Jean de Montagu qui, inspiré par sa mère, avait su gagner
la faveur du jeune prince par sa sa souplesse et sa complaisance. Aussi non seulement Charles VI continua Jean dans ses fonctions
de secrétaire, mais il l'emmena partout avec lui dans ses voyages et dans ses guerres.
Ainsi le 27 novembre 1382 lors de la bataille de Rosebecque, Jean de Montagu conbattit aux côtés du Roi, comme le prouvent les lettres du 17 avril 1388 lui assignant une rente à vie sur le Trésor, pour avoir été le seul de ses secrétaires qui s'était trouvé près de lui dans le combat. Ce fut ce même seigneur qui eut la plus grande part dans la détermination que prit Charles de revenir aussitôt à Paris pour châtier le soulèvement des habitants, au lieu d'aller mettre le siège devant Gand. Aussi les Flamands lui offrirent-ils, en reconnaissance, une somme d'argent assez considérable, qu'il accepta avec l'autorisation royale. En 1385 il fut encore du voyage entrepris par Charles VI en Flandre pour la conclusion de la paix de Tournay et le 27 novembre 1386 il reçut du roi une nouvelle somme d'argent pour les grands frais et dépenses qu'il avait faits en l'accompagnant dans ce voyage.
Il fut envoyé en Lombardie avec quelques seigneurs du Conseil au mois d'avril 1386, et le 27 novembre de la même année le Roi le gratifia d'une somme en considération des grands frais et dépenses qu'il avait fait avec lui en son dernier voyage de Flandres. Il lui donna aussi le 24 décembre 1387 les maisons de Massonvilliers et de Franconville près de Chartres et une somme pour acquérir une maison à Paris. Il lui assigna une rente à vie sur le Trésor le 17 avril 1388 en considération de ce qu'il avait été le seul de ses secrétaires qui s'était trouvé près de lui à la bataille de Rosebecque.
Lors du conseil du 1er novembre 1388, Charles VI décida qu'il était temps pour lui de gouvernela France. A l'administration des oncles du Roi succéda donc celle des favoris dont quatre se partagèrent le gouvernement (le Bègue de Vilaines, Bureau, seigneur de la Rivière, Jean le Mercier, seigneur de Noviants, et jean de Montagu) sous l'inspection du connétable de Clisson qui avait su gagner la confiance de Charles VI. Dans le nouveau conseil du roi, Jean de Montagu reçut la surintendance des finances.
Biette vit avec bonheur son fils devenu enfin un des premiers du royaume, et voulant que par la richesse, sinon par la naissance, il put marcher de pair avec les princes mêmes du sang, elle décida les autres membres de la famille à faire, pour ainsi dire, abnégation de leur fortune personnelle afin d'augmenter celle du chef de la maison. Ainsi le 30 novembre 1388, Ferry Cassinel, évêque d'Auxerre, le frère de Biette, donne à Jean de Montagu le châtel maison forte de Marcoussis et la maison du Val d'Aaron en la châtellenie de Montlhéry, donation au reste qui n'était pas purement gratuite, car c'est sans doute en retour de ce don que Ferry fut nommé l'année suivante archevêque de Reims. Vers la même époque, Gérad de Montagu, évêque de Poitiers, cède à son frère la seigneurie de Garigny et dépendances. Enfin, Ferry Cassinel étant mort le 26 mai 1390, et Biette ayant hérité de la seigneurie de Ver, la transporta à son fils et lui ménagea un échange fort avantageux avec Guillaume Cassinel, son autre frère : c'était le vidamé de Laonnais, que Guillaume possédait comme mari d'Isabeau de Châtillon.
Jean de Montagu, de son côté, travaillait à accroitre par lui-même ses possessions. Ainsi le 25 mai 1389, il acquit les terres de Boissy-sous-Saint-Yon et Egly. Les années suivantes il acheta encore les terres de Bonnes, la Roue, Orainville, Châtre etc. Les présents que lui faisait continuellement le Roi suffisaient et au-delà pour payer ces acquisitions.
Les services de Jean de Montagu et ceux des autres ministres nouvellement nommés étaient fort agréables à Charles VI. Ces seigneurs, tout en blâmant vivement la conduite de leurs prédécesseurs, tout en se récriant beaucoup contre les impôts excessifs mis sur le peuple, étaient tombés à peu près dans les mêmes abus ; mais du moins ils avaient eu un très grand mérite, celui de voir que le seul moyen de faire prendre au peuple ses maux en patience, puisqu'ils ne pouvaient pas y apporter remède, c'était de l'amuser par des fêtes brillantes et folles, qui du reste étaient tout à fait du gout du jeune souverain. Dans toutes ces fêtes, le roi se distinguait par une simplicité et une affabilité qui le faisaient admirer du peuple, et qui lui méritèrent le surnom de bien aimé.
La fortune de Montagu ne faisait que croître et chaque jour il devenait plus familier et plus nécessaire au roi et à son frère le duc d'Orléans.
Il accompagna le Roi à Tours et Amiens, faisant alors la fonction de secrétaire. La maladie de ce prince étant survenue en 1392, il fut éloigné pour un temps des affaires, mais le Roi étant revenu en son bon sens, le fit revenir. Mais, retombé pour ainsi dire sous la tutelle de ses deux oncles les ducs de Berry et de Bourgogne, il n'avait plus assez d'autorité ni d'énergie pour braver Philippe le Hardi en rendant des charges importantes à Jean de Montagu. Ce n'était pas cependant que le désir lui en manquât, et pour prouver à Jean que sa faveur n'avait en rien déchu, il le choisit en 1395, pour l'accompagner au voyage qu'il voulait faire à Notre-Dame du Puy en Auvergne. Au mois d'octobre de l'année suivante, il le nomma pour suivre, en qualité de conseiller du Roi, les ducs de Berry, de Bourgogne et d'Orléans, lorsqu'ils allèrent en ambassade vers le pape pour procurer la paix de l'église.
En même temps, Charles VI insinua à son favori de se mettre dans les bonnes grâces des ducs de Berry et d'Orléans, et profitant de la mésentente qui commençait à régner entre Philippe le Hardi et Jean de Berry, il nomma Montagu son chambellan, probablement en 1397, afin de le mettre plus à même de le servir utilement.
En 1398, il fut établi capitaine du château de la Bastille à Paris, à quatre hommes d'armes et six arbalétriers par lettres patentes du dernier jour d'octobre. Il fit montre le 1er décembre de la même année, en qualité de vidame de Laonnois, chevalier banneret, capitaine du chastel de Saint-Antoine de Paris, avec trois écuyers et cinq arbalétriers de sa compagnie. Il y ajoute à ses qualités celle de conseiller et chambellan du Roi. Son sceau est une croix cantonnée de quatre aigles.
Montagu conserva peu de temps ces honneurs militaires qui lui faisaient encore plus d'envieux, pour se livrer tout entier au service intérieur de la maison du roi. Charles VI n'était pas un ingrat et Montagu savait bien ce qu'il faisait en s'attachant exclusivement à sa personne. Aussi voyons-nous les dons du roi s'accumuler, tel le château de Chatelou et de ses dépendances, donné en 1401 pour l'unir à la châtellenie de Marcoussis qu'il avait acquise.
Toutes ces gratifications, données à si peu de distance les unes des autres, jointes aux gages fixes de secrétaire et surintendant, et aux profits énormes qu'il pouvait tirer de cette dernière charge, devait faire de sa maison une des plus opulentes du royaume. Mais ce n'était là que le commencement de sa fortune. Le Roi, par lettres du 4 octobre 1401, le pourvut de la charge de Souverain et Grand Maître de son Hôtel et lui assigna une pension de deux mille quatre cent livres sur ses coffres.
Cependant la rivalité des partis d'Orléans et de Bourgogne augmentait chaque jour. Le 27 avril 1404 Philippe le Hardi mourut et son fils Jean sans peur lui succéda. Outre les murmures qu'excitaient les nouveaux impôts, on se plaignait fort du duc d'Orléans, si bien que le roi assembla en 1405 un conseil extraordinaire des princes du sang, auquel il convia le duc de Bourgogne. Chaque parti levait des troupes et la guerre semblait imminente. Le 24 avril 1405, Montagu fut envoyé vers le duc de Berry pour porter les conditions du duc d'Orléans et le 22 mai vers ce dernier prince pour lui apprendre celles du duc de Bourgogne.
Les négociations trainèrent en longueur, et pour maintenir l'ordre dans Paris pendant ces dissensions, le duc de Berry fut nommé capitaine général des milices bourgeoises et le 5 septembre, Jean de Montagu reçut la garde de la ville, avec cent hommes d'armes, sous le commandement du duc.
Puis, ayant été résolu au Conseil, qu'on enverrait une notable ambassade à la Reine et au duc d'Orléans, qui étaient à Melun, il y accompagna le duc de Bourbon et le comte de Tancarville. Il est permis de croire que Jean de Montagu, par ses remontrances, fut le principal auteur de la détermination de Louis, qui consentit enfin à partager le pouvoir avec le duc de Bourgogne. Dans une entrevue qui eut lieu à Vincennes le 17 octobre, les deux princes se donnèrent l'accolade en signe de réconciliation. Au printemps suivant, pour récompenser le grand maître des services qu'il lui avait rendu dans ces négociations, le duc d'Orléans lui donna, avec l'amiral Pierre de Bréban, la conduite des troupes qu'on envoya au duc de Bar contre le duc de Lorraine.
Mais la réconciliation ne pouvait pas être de longue durée, et le 23 novembre 1407, le duc d'Orléans fut assassiné à Paris et le duc de Bourgogne entra en maître à Paris et pendant un an cette ville fut en proie à tous les malheurs de la guerre civile, le parti du duc de Bourgogne et celui du duc d'Orléans étant tout à tour vainqueurs. Valentine de Milan demanda justice au roi pour l'assassinat de son époux, mais préférant le bien de l'Etat à la juste punition d'un si horrible crime, on jugea plus à propos de ménager quelque accommodement. On donna la conduite de cette affaire à Jean de Montagu. Sachant la haine mortelle que Jean sans peur lui portait, il avait presque désespéré de la réussite de cette affaire qui s'avéra néanmoins un succès au point que le duc de Bourgogne loua hautement l'adresse et la conduite d'un si bon négociateur. Enfin, le neuvième jour de mars 1409, on ouvrit des conférences dans la cathédrale de Chartres, et la paix fut faite.
Pendant ces évènements le grand maître continue d'accroitre sa fortune. Le 12 juin 1404 le duc de Berry lui donna, à vie, l'hôtel du Porc-Epic, qui avait été à Hugues Aubriot, dans la rue de Jouy à Paris. Le 5 février 1404, le grand maître fait acquisition de la seigneurie de Nozoy et di fief de la Ville-du-Bois, acquisition qu'il complètera dans la suite par l'achat de Chouenville, Guillerval et quantité d'autre petits fiefs à l'entour. Enfin, le 14 juillet de la même année, il achète encore les terres de Mauchamp, Vauxilas, Brouillet et autres lieux d'Adam de Sandreuille.
Comprenant parfaitement d'ailleurs que, dans le haut point de faveur et de richesse où il était, ses enfants et ses parents étaient regardés comme les plus grands partis de France, Jean de Montagu n'oublia rien pour leur procurer les plus illustres alliances. Sa fille aînée, Bonne-Elisabeth, épousa en 1398, Jean VI du Moulin, comte de Roucy et de Braine ; sa seconde fille, Jacqueline, se maria en 1399 avec Georges de Craon, échanson de France ; la troisième, Marie, épousa en 1409, David de Briseu, favori du duc de Bourgogne ; enfin la même année, la quatrième, Jeanne, quoiqu'elle n'eut que douze ans, fut fiancée à Jean de Melun, aussi favori du duc de Bourgogne. Enfin il osa jeter les yeux sur la fille du connétable d'Albret, qui n'eut point de honte de la lui accorder pour son fils, quoiqu'elle eut l'honneur d'être issue du sang royal.
Voulant aussi laisser à sa postérité quelques monuments de sa grandeur et de sa piété, il donna à l'église Notre-Dame de Paris une grosse cloche qu'il nomma Jacqueline du nom de sa femme, et à l'église Saint-Paul la grande verrerie qui était sur le grand portail. Enfin il choisit, entre tous les lieux de sa dépendance, celui de Marcoussis comme le plus propre à ses desseins. Il y fit édifier et bâtir en deux ans et demi un des plus beaux châteaux de France, l'église paroissiale dédiée à Saint Vandrille et un superbe monastère où il établit les Célestins.
bâtir en deux ans et demi un des plus beaux châteaux de France, l'église paroissiale dédiée à Saint Vandrille et un superbe monastère où il établit les Célesti
Jean de Montagu était donc parvenu au faite des honneurs et des richesses : il était certain de l'appui du roi et de la faction d'Orléans ; il se croyait réconcilié avec le duc de Bourgogne dont il avait cherché à gagner les principaux favoris en contractant avec eux des alliances. Depuis la paix faite avec Jean sans peur, il était allé en Bourdonnais offrir ses services militaires au duc de Bourbon contre le duc de Savoie, et à son retour il avait reçu une somme de six mille livres en récompense des frais qu'il avait pu faire dans cette guerre.
Le 4 septembre 1409 le roi avait donné mille livres en vaisselle d'argent à Charles de Montagu, fils du grand maître, à l'occasion de son mariage avec la fille du connétable. Tout récemment un des frères de Jean, l'archevêque de Sens, avait été fait président de la cour des comptes, et l'autre, Gérard de Montagu, venait d'être nommé à l'évêché de Paris, l'un des premiers de France. Plus récemment encore, le 22 septembre, Jean avait traité chez lui le roi Charles VI, celui de Navarre, et les ducs de Berry, de Bourbon et de Bourgogne, avec plusieurs autres prélats et seigneurs pour lors à Paris. Mais ce fut ce luxe même déployé dans la réception du roi et des seigneurs qui perdit Jean de Montagu, comme plus tard le luxe déployé par Fouquet devait perdre le surintendant.
Tandis que tout semblait concourir à entretenir la tranquillité dans laquelle vivait alors le grand maître, ordinairement si prudent, l'envie et la haine de ses ennemis ne s'endormait pas : on ne se cachait pas de dire tous les jours de lui que c'était un homme sans lettres et sans mérite ; on raillait sa petite taille et sa barbe clair-semée. D'autres, encore plus animés à sa perte, déchiraient sa réputation auprès du roi de Navarre et du duc de Bourgogne, l'accusaient de trahison, lui imputaient d'avoir procuré la maladie du roi, d'avoir plus que tout autre entretenu le schisme de l'Eglise, d'avoir pillé les finances du roi, enfin d'avoir commis toutes sortes d'infidélités contre son service. Ces deux princes, déjà disposés à sa ruine, n'étaient pas en peine que de gagner l'esprit des autres et ils y travaillèrent si bien que, comme le raconte Michel Pintoin dans sa Chronique du religieux de Saint-Denis contenant le règne de Charles VI de 1380 à 14222 :
" Ils déterminèrent les seigneurs à s'assembler au mois d'octobre, dans l'abbaye de Saint-Victor les Paris, pour délibérer sur les griefs imputés au sire de Montaigu. On s'engagea par serment à garder le plus profond silence sur ce qui serait décidé dans cette conférence, et à n'en rien révéler à personne, pas même aux principaux officiers.
Cependant les amis du sire de Montaigu, soupçonnant ce qui se passait, l'avertirent que les princes, et principalement le duc de Bourgogne, animés contre lui d'une haine implacable, en dépit des promesses qui lui avaient été faites, machinaient quelque complot pour le perdre et avaient juré sa mort. Ils lui conseillaient donc de s'éloigner avec tous ses biens pour échapper à leur vengeance. Mais il ne partagea pas ces craintes et ne fit aucun cas de ces conseils ; il comptait beaucoup trop sur l'amitié du roi, de la reine et du duc de Berri, comme il l'apprit bientôt à ses dépens. Telle est la faiblesse humaine, que nous ignorons toujours ce que nous réserve le lendemain. Le lundi 7 du même mois, comme il retournait seul, selon son habitude, et sans défiance à sa maison de Saint-Victor, il fut tout à coup saisi et fait prisonnier dans la rue par le prévôt de Paris, Pierre des Essarts, et par les sergents armés qui l'accompagnaient. Le prévôt lui dit : Je vous arrête, traite infâme, et, quoiqu'il appelât au Parlement, le fit traîner ignominieusement au petit Châtelet. Là il fut jeté au fond d'un cachot et remis à la garde du sire de Helly, conformément aux ordres du duc de Bourgogne. On emprisonna en même temps l'évêque de Chartres et maître Pierre de l'Esclat, principaux conseillers3 de la reine et du duc de Berri, et plusieurs autres notables personnages.
Deux jours après, le Parlement nomma des commissaires pour examiner l'affaire et pour entendre les dépositions des dénonciateurs et des accusateurs.
Le sire de Montaigu fut interrogé sur les griefs ci-dessus mentionnés et sur d'autres plus graves encore5, et, comme il persistait à tout nier, on résolut de le mettre à la torture pour lui arracher des aveux. Cependant l'évêque de Paris, ses amis et ses parents, qui savaient que le duc de Bourgogne était son plus grand ennemi, allèrent le trouver à plusieurs reprises, se jetèrent à ses pieds et lui demandèrent vainement, dans les termes les plus humbles et avec les plus vives instances, la grâce du sire de Montaigu. Ils adressèrent les mêmes supplications au roi de Navarre, qui se contenta de répondre : Ne craignez rien, on lui fera bonne justice. La reine et le duc de Berri, cédant aux prières de ses amis, avaient aussi intercédé en sa faveur au commencement du procès ; mais leurs démarches ne purent changer sa destinée. Le sire de Montaigu, vaincu par les douleurs de la torture, avoua les crimes qu'on lui imputait et signa de sa main cet aveu. Le Parlement prononça alors contre lui une sentence capitale, et le condamna à subir sa peine dans cette même ville de Paris, qui avait été naguère le théâtre de sa splendeur.
Le 17 de ce mois, le sire de Montaigu fut conduit aux halles à son de trompe et au milieu d'une nombreuse escorte de bourgeois en armes ; il tenait à la main une croix de bois, qu'il baisait souvent pour se fortifier contre la mort, et il donnait tant de témoignages de dévotion, qu'il arracha des larmes même à ceux qui le haïssaient auparavant. Le bourreau le frappa de sa hache, sans donner, suivant l'usage, lecture de la sentence, et lui ayant tranché la tête d'un seul coup, il la mit au bout d'une lance et pendit le corps au gibet de Montfaucon. Les seigneurs de la cour, que les ducs avaient député pour recueillir les dernières paroles du condamné, revinrent mornes et abattus. Comme on leur demandait pourquoi les crimes d'un si puissant personnage n'avaient pas été publiés, ils répondirent qu'il avait déclaré à la multitude, en montrant ses mains disloquées et son bas ventre déchiré, que la violence des tourments lui avait seule arraché des aveux et que le duc d'Orléans et lui n'étaient coupables que d'avoir trop prodigué l'argent du roi.
Les richesses de Jean de Montaigu ne retournèrent pas dans le trésor public. Son argent tomba entre les mains des courtisans, les meubles allèrent au comte de Hainaut, les terres se distribuèrent entre les seigneurs, les plus considérables tombant au dauphin, le château de Marcoussis fut donné au frère de la reine, Louis de Bavière. Le duc de Bourgogne eut la discrétion ou la politesse de ne rien prendre pour lui. ; il s'appliqua à gagner la reine qu'il fallait consoler des malheurs de Montaigu, qui lui avait été fort attaché.
Dès le commencement du mois de décembre 1409, Charles VI étant revenu de sa frénésie, et ayant appris la mort du grand maître, s'en plaignit amèrement au duc de Bourgogne mais fut forcé de laisser impuni le meurtre de son favori. Tant que dura la guerre des Armagnacs et des Bourguignons, et que Paris fut occupé par les partisans de Jean sans peur, Charles VI attendit patiemment.
Ce n'est que trois ans plus tard, après la paix d'Auxerre (14 juillet 1412), que son fils Charles obtint la réhabilitation de sa mémoire. Le mardi 12 septembre 1412, on tint un grand conseil dans lequel, en présence du Roi, assisté du comte de Vertus, des ducs de Bourgogne et de Bourbon, et de plusieurs autres princes et grands seigneurs, le duc de Guyenne, suivant l'ordre de Charles VI, déclara que la mort de Jean de Montagu lui avait fort déplu, et que ça avait été un jugement trop soudain et trop précipité, dicté par la haine et non par la justice. Et, après avoir remis Charles de Montagu dans son office de premier chambellan près de lui et avoir déclaré les confiscations des biens et héritages de Montagu nulles et sans effet, il commanda qu'on alla au gibet dépendre le corps du grand maître, qu'on le réunit à son chef, et qu'on le baillat à ses amis pour le déposer en terre sainte.
En exécution de cet arrêt du grand conseil, prononcé avec tant d'éclat et sans le contredit des parties, le 28 septembre 1412, le prévôt de Paris, avec un prêtre et douze hommes ayant flambeaux et torches allumées, se rendit aux halles de Paris où le bourreau enleva la tête de la lance où elle était fichée. Et pareillement son corps fut ôté du gibet de Montfaucon. Le corps joint avec la tête et enclos dans un cercueil, fut conduit dans l'église Saint-Paul, sa paroisse, où l'on fit ses obsèques avec toute la magnificence possible, et de là au monastère des Célestins de Marcoussis qu'il avait fait bâtir pour remercier du recouvrement par Charles VI de la raison, après la tragique affaire de la forêt du Mans. Un somptueux tombeau fut érigé dans l'église du monastère, et son épitaphe ainsi rédigée : Cy gist noble et puissant seigneur monseigneur en son vivant chevalier, seigneur de de Montagu et de Marcoussis, vidame de Laonnoys, conseiller du roi et grand maistre d'hôtel de France, qui fonda et édifia ce monastère. Lequel, en haine des bons et loyaux services par lui fais au roy et au royaume, fut par les rebelles et les ennemis du roy injustement mis à mort à Paris le dix septième jour d'octobre, veille de Saint-Luc, l'an 1409. Priez Dieu pour luy.
Quant aux biens de Jean de Montagu, ils furent restitués à ses héritiers, à mesure que ses détenteurs moururent, sauf le fief de Montagu, que les dames religieuses de Poissy conservèrent jusqu'au XVIIè siècle et qui fut ensuite réunit à la couronne.

Dessin d'un vitrail (brisé à la Révolution) de l'église de Marcoussis
représentant le donateur, qui en avait reconstruit le cœur.
Jean de Montagu avait épousé Jacqueline, fille d'Etienne de La Grange, président au Parlement de Paris et de Marie du Bois. De cette union naquirent :
- Charles, tué à Arincourt en 1415 ;
- Isabelle, notre ancêtre, mariée à Jean de Pierrepont (tué à Azincourt) puis à Pierre de Bourbon-Préaux ;
- Jacqueline, mariée à Jean de Craon (tué à Azincourt) puis à Jean Malet de Graville ;
- Jeanne, mariée à Jacques de Bourbon-Préaux, frère de Pierre.
Jacqueline de La Grange
Aquarelle d'après une statue en pierre peinte dans le temps, dans la chapelle du château de Marcoussis (BnF)
Sources :
RP Anselme VII page 344 et VI page 377
Michel Pintoin : Chronique du religieux de Saint-Denis contenant le règne de Charles VI de 1380 à 1422, tome 4ème, année 1409, chapitre XIV, pages 267 et suivantes.
Louis Pierre Anquetil : Histoire de France depuis les Gaulois jusqu'à la fin de la monarchie, année 1409 p23 et suivantes.
Honoré Antoine Frégier : Administration de la police de Paris depuis Philippe-Auguste jusqu'aux Etats généraux de 1789, livre second 1350-1567 p 347 et suivantes
Bibliothèque de l'école des Chartes, livre troisième, article de Lucien Merlet, page 250.
Lien de Parenté
Jean de MONTAGU
¦
Isabelle de MONTAGU
¦
Jeanne de PIERREPONT
¦
Aimé von SAARBRÜCKEN
¦
Robert von SAARBRÜCKEN
¦
Guillemette von SAARBRÜCKEN
¦
Robert de LA MARCK
¦
Diane de LA MARCK
¦
Charles-Henri de CLERMONT
¦
Iasbelle de CLERMONT
¦
Françoise de BEAUVAU
¦
Jean-Armand de VOYER de PAULMY
¦
Marie-Françoise de VOYER de PAULMY
¦
Agathe de LA RIVIERE
¦
Yvonnette RIVIE de RICQUEBOURG
¦
Monique de GOUY d'ARSY
¦
Arsène, comte O'MAHONY
¦
Maurice, comte O'MAHONY