|
Fiche N° 0125 |
Auteur D. Barbier |
03/07/2008 |
||
|
Jean de LA VACQUERIE |
Ascendant ¤ Allié ¡ |
|||
Premier Président au Parlement de Paris en 1481
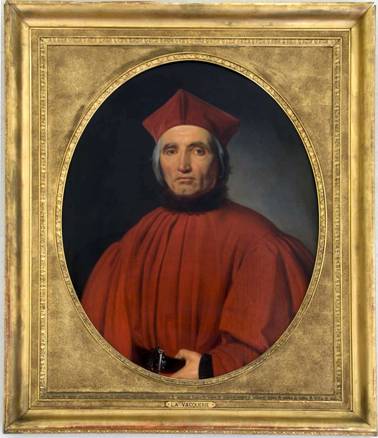
Portrait par Théophile-Auguste Vachelet (1802-1873),
conservé
à la Cour de Cassation, quai de l’horloge à Paris.
Le
chancelier de l’Hôpital : « Il était beaucoup plus recommandable par
sa pauvreté que Rolin, chancelier du duc de Bourgogne, par ses
richesses ».
Notice historique de M. J. Barbier, publiée
dans la Revue des études historiques - 1848 (15)
Son
nom n'apparaît pas dans l'histoire avant 1477 ; elle est muette sur sa
naissance, sur la première partie de sa vie ; elle permet seulement de
conjecturer que, citoyen de la ville d'Arras, il appartenait à cette haute
bourgeoisie qui fut plus tard le tiers-état.
Charles
le Téméraire venait de mourir. Louis, qui avait témoigné de cette mort une joie
indécente, convoitait l'héritage de Marie, fille du duc de Bourgogne. Après
avoir rendu odieux à la nation flamande les deux principaux
conseillers de la princesse, Hugonet et d'Jmbereourt, qui, malgré les
supplications de cette dernière, furent massacrés sous ses yeux, le roi de
France formula nettement, ses prétentions sur les villes de la Somme et sur
l'Artois. Il investit la ville d'Arras et chargea des députés de demander aux
habitants leur soumission au roi, comme à leur seul maitre légitime.
Jean
de La Vacquerie était alors le pensionnaire ou syndic de la ville
d'Arras, et l'événement prouva combien la fidélité des Artésiens à leur
jeune souveraine était périlleuse. Sans consulter le danger, La Vacquerie,
chargé de porter la parole pour la ville, répondit aux députés du roi, dont la
demande ne paraissait pas souffrir de refus : "Que cette comté d'Artois
appartenoit à mademoiselle de Bourgogne, fille du duc Charles, et lui venoit de
vraye ligne, â cause de la comtesse Marguerite de
Flandres, femme du duc Philippe de Bourgogne le 1er, et
qu'on supplioit le roi qu'il lui plu d entretenir la trève qui estoit entre lui
et le feu duc Charles".
Son
exemple encouragea un grand nombre de bourgeois d'Arras à soutenir les droits
de la princesse, mais il leur devint funeste. Plusieurs d'entre eux eurent la
tête tranchée, d'autres furent chassés de leur ville, dont le roi essaya même d'abolir
le nom, et dispersés dans le royaume.
Jean
de La Vacquerie devait s'attendre au sort le plus rigoureux; il n'en fut rien.
Louis XI, qui se connaissait en hommes, frappé de la fermeté de ce magistrat municipal,
ne lui fit pas seulement grâce ; il l'appela à Paris, et bientôt, en 1481, il
lui conféra la première présidence du parlement [1].
Sur ce nouveau théâtre, le noble caractère de La
Vacquerie devait briller d'un plus vif éclat. Principal organe de la justice,
il se dévouait à cet office comme à un véritable sacerdoce, et il se rendait
toujours l'interprète de ce qu'il considérait comme l'expression du
droit, alors même qu'il rencontrait en face du droit la volonté royale. On
se tromperait fort cependant en lui supposant les tendances et l'esprit
d'un factieux : sa fidélité au trône ne fut jamais suspectée ; mais son inébranlable
sentiment du devoir lui commandait, à l'occasion, et dans les termes de
la légalité, des avertissements à l'autorité royale, à ses risques et périls.
Louis en profita plus d'une fois, et il le fit surtout dans une circonstance
remarquable, qui suffirait à sauver de l'oubli la mémoire de La Vacquerie.
Il
s'agissait d'édits bursaux qui
allaient augmenter les charges du peuple, et le roi, en les envoyant au
parlement, pour qu'ils y fussent vérifiés, n'avait pas manqué d'y
joindre les menaces dont il était prodigue. Jean Bodin raconte ainsi ce trait
historique. Louis XI avoit usé de menaces
grièves envers la cour de parlement, qui refusait publier et vérifier quelques
édits qui estoyent iniques; le
président Lavacrie, accompagné de bon nombre de conseillers en robbes rouges,
alla faire ses plaintes et remontrances pour les menaces qu'on faisait à la
cour : le roi, voyant la gravité, le port, la dignité de ces personnages, qui
se vouloyent démettre de leur charge plustost que de vérifier les édits qu'on
leur avoit envoyés, s'estonna, et, redoutant l'authorité du parlement, fit
casser les édicts en leur présence les priant de continuer à faire justice, et
leur jura qu'il n'envoyeroit plus édict qui ne fust juste et raisonnable. Cet
acte fut de bien grande importance pour maintenir le roi en l'obeissance de la
raison.
C'était la seconde fois que La Vacquerie tentait la
colère du roi qui fut peut-être le plus impérieux entre tous. On ne supposera
pas qu'une première indulgence pût lui faire raisonnablement espérer devoir son
courage impuni. La constance de ce courage fit sans doute une vive impression
sur Louis XI. D'ailleurs, ce monarque, qui consacra toutes les forces de son
intelligence à fonder l'unité du pouvoir et la grandeur de la royauté sur les
ruines des plus puissants vassaux, voyait peut-être un auxiliaire utile à la
royauté même, pendant un intervalle de temps donné, dans cette autorité des
parlements, élément nouveau d'où se dégagea plus tard le principe de la
représentation nationale. Quoi qu'il en soit, il ne tint pas La Vacquerie en
moins grande estime à la suite de cette résistance légale, et il lui conserva
toute sa faveur jusqu'à la fin de ses jours.
Sous
le règne suivant, La Vacquerie montra que, s'il savait avertir le roi, il savait
aussi contenir les grandes ambitions qui s'agitent autour du trône. La minorité
de Charles VIII, la tutelle de sa sœur Anne de Beaujeu, qui soutint avec tant
de fermeté les droits qu'elle puisait dans le testament du feu roi, avaient
jeté le duc d'Orléans, qui fut depuis Louis XII, dans des intrigues que secondaient
surtout et le comte de Dunois et le duc de Bretagne. Justement inquiétée par
les projets des princes, la régente avait fait brusquement quitter au jeune roi
le séjour de Vincennes et s'était retirée avec lui dans la ville de. Montargis.
Le 17 janvier 1484, le duc d'Orléans se présente dans le sein du Parlement,
auquel il fait exposer ses prétendus griefs par son chancelier, Denis
Lemercier. A travers toutes les précautions oratoires de cette harangue, on
distinguait clairement le but du prince : il provoquait en sa faveur et contre l'autorité
de madame de Beaujeu l'intervention du corps parlementaire. Rien n'est
plus digne que la réponse du premier président La Vacquerie, et la leçon donnée
par lui au premier prince du sang, qui devait à tous l'exemple de la soumission
aux lois. Voici celte réponse textuelle, empruntée aux registres du parlement :
"Par M. le premier
président a été dit : que le bien du
royaume consiste en la paix du roi et de son peuple, qui ne peut être sans
l'union des membres, dont les grands princes sont les principaux. Par quoi, et non pas pour réponse,
mais par exhortation, a dit à M. d'Orléans
qu'il doit bien penser à ce qu'il a fait dire et proposer, et aviser que la
maison de France soit par lui maintenue et entretenue sans division, et ne doit
ajouter foi aux rapports qui lui pourraient être faits. Et quant à la cour (de
parlement), elle est instituée par le roi pour administrer justice, et n’ont
point ceux de la cour d'administration de guerre, de finances, ni du fait et
gouvernement du roi ni des grands princes. Et sont Messieurs de la cour de
parlement gens clercs et lettrés pour vaquer et entendre au fait de la justice
; et quand il plairait au roi leur commander plus avant, la cour lui obéirait;
car elle a seulement l'œil et le regard au roi qui en est le chef, et sous
lequel elle est ; aussi, venir faire ces remontrances à la cour, et néanmoins
passer plus avant.et faire autres exploits sans le bon plaisir et exprès
consentement du roi, ne se doit pas faire."
Comme
on le voit, en échange de ses remontrances, le duc en reçut une qui aurait dû
lui profiter et l'empêcher d'aller échouer une fois de plus contre la sage
indifférence de l'Université, qu'il essaya, après le Parlement, d'intéresser à sa cause.
Sans
doute, le roi de France, qui sut si bien oublier les injures faites au duc
d'Orléans, ne se fût souvenu de l'abstention de La Vacquerie que pour le
récompenser de la fermeté de sa conduite, s'il l'eût encore trouvé à la tête de
la magistrature lorsqu'il parvint au trône et gouverna le royaume qu'il avait longtemps
troublé par ses factions. Ce dernier triomphe, ce dernier tribut de justice
payé à la dignité du caractère, n'était pas réservé à La Vacquerie. Son existence
se termina peu de temps avant la fin du règne de Charles VIII. Il mourut en
1497, léguant à sa compagnie et à la France entière des exemples, précieux,
surtout dans les temps où il vivait, de vrai courage et d'inaltérable intégrité.
Maint
parallèle avec des personnages revêtus comme lui de hautes dignités pouvait
alors relever sa valeur. Ainsi, l'on a gardé le souvenir des exactions d'un
certain Rollin, chancelier du duc de Bourgogne, connu pas ses immenses richesses.
Dans une de ses harangues, le chancelier de L'Hôpital, ce grand
homme et ruie magistrat, comme l'appelle Brantôme, opposant l'insolente opulence
de Rollin à l'honorable pauvreté de La Vacquerie, rendit un public hommage aux
vertus de ce dernier. Un tel éloge dans une telle bouche n'est pas le moindre
titre de gloire de l'homme sur lequel j'ai un instant appelé vos souvenirs.
Grandeur d'âme, civisme éclairé, intelligence et idées supérieures à celles de
son siècle, voilà les qualités qui le recommandent au respect public, et toute
sa vie peut se résumer en ces mots : II sut être à la fois et en toute occasion
fidèle aux intérêts de son roi et à ceux de son pays.
Une biographie écrite par M. Sorbier se termine
ainsi : "Si recommandable
comme homme public, la Vacquerie ne l'était pas moins par ses qualités privées. On a dit qu'il n'est pas de belles vies en détail, et que les
grands hommes ne le sont
qu’en gros. La Vacquerie fit
mentir cet axiome. C'est ce que
prouvent divers traits qu'il serait trop long de raconter. Sa vie fut pleine jusqu'à sa dernière heure (il mourut âgé de plus de 80 ans). Au moment où
il rendit le dernier soupir, il dictait à son greffier du
parlement, assis à côté de son lit, l'enregistrement
d'un édit qui allégeait les charges du peuple."
Une statue en pierre, pour la façade de
l’Hôtel de ville de Paris, fut détruite dans l’incendie de l’édifice par la
Commune de 1871.
Lire le livre : Jean de La Vacquerie,
conseiller pensionnaire d'Arras et premier président au Parlement de Paris, par
Louis Cavrois.
Lien
de parenté :
--------------------------------------------------------------------------------------------
Père de Marie, mère de Mery , mère Rouvroy de
Saint-Simon, père d’Antoinette, mère d’Antoine de Canonville, père de Jehanne,
mère de Gabriel d’Amphernet de Pontbellanger, père de René III, père de Gabriel
II, père d’Antoine-Michel, père de Charles-Félix, père de Michel-Adrien, père
de Marthe épouse de Maurice O’Mahony.
