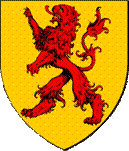|
Fiche N° 0054 |
Auteur D. Barbier |
10/11/2008 |
||
|
Savary de MAULEON |
Ascendant ¤ Allié ¡ |
|||
Guerrier célèbre et troubadour
fameux,
sénéchal du Poitou et prince de
Talmont,
fondateur des Sables-d’Olonne en
1218
Les
Mauléon du Poitou et ceux de Gascogne portaient les mêmes armes,
mais d'émaux
contraires,
c'est-à-dire pour
ceux-là: d'or, au lion de gueules.
Grand seigneur poitevin né dans la
deuxième moitié du XIIe siècle, Savary de Mauléon participe à toutes les
révoltes des seigneurs poitevins qui secouent l’empire plantagenêt d’Henri II
puis de Richard Cœur-de-Lion. Grand seigneur, guerrier célèbre et troubadour
fameux, alternativement au service des Plantagenêt ou des Capétiens suivant ou
précédant les événements politiques et militaires qui émaillent la première
moitié du XIIIe siècle, c’est une grande figure de l’histoire du Poitou,
emblématique de son époque.
Savary III de Mauléon était issu d'une famille de chevaliers
connue en Poitou depuis l'an 1090, qui tenait les seigneuries de Mauléon,
Talmond, Fontenay, l'Ile de Ré, Benon, Bouhet etc. Cette famille faisait
remonter ses ancêtres jusqu’à Arnold, frère d’Ebles, comte de Poitou et duc
d’Aquitaine, qui eut la vicomté de Thouars et fit bâtir le château de Mauléon
dont sa postérité prit le nom.
Sa date de naissance, assez incertaine, peut être située
avant 1180.
En 1202, Savary prit les armes pour la première fois contre
l'Angleterre. Ayant participé au siège de Mirebeau dans lequel la reine Aliénor
s'était réfugiée, l'affaire tourna mal et il fut envoyé prisonnier en
Angleterre, au château de Corff. Ayant réussi à se rendre maître de ce château,
il passa au service du roi d'Angleterre.
En 1205, il s'empara pour le compte de ce dernier de la ville
de Niort, grâce à une ruse. En récompense de sa bravoure, Savary de Mauléon
obtint la garde de plusieurs châteaux et fut chargé de défendre les
sénéchaussées de Poitou et de Gascogne.
En 1209, Savary, à la sollicitation de son oncle Guillaume de
Mauléon, avait abandonné le parti de Jean-sans-Terre pour épouser celui de
Philippe-Auguste. L’accord qu’il avait fait avec le roi de France renfermait
des clauses très avantageuses pour lui. Outre qu’il obtenait une forte solde
pour lui et pour sa compagnie, Benon, La Rochelle et Cognac devaient lui être
cédées, si ces villes étaient prises, et les succès de Philippe-Auguste
donnaient lieu de l’espérer. Mais Jean
avait besoin des services de Savary ; il savait déjà que ce capitaine se
vendait au plus offrant, déjà il l’avait acheté en 1204 ; et en servant le
meurtrier d’Arthur de Bretagne, son ancien chef, en servant un prince qui
l’avait pendant deux ans retenu lui-même dans une étroite prison, Savary avait
prouvé qu’il était digne de Jean-sans-Terre. Aussi le roi anglais le ramena
bientôt sous ses drapeaux. Mais à quel prix acheta-t-il cette défection ?
Le caractère ambitieux et égoïste de Savary ne permet pas de croire qu’il ait
abandonné l’alliance de Philippe-Auguste, d’un roi vainqueur, sans recevoir
d’énormes compensations de la part d’un roi vaincu qu’il avait déjà trahi. Et
au nombre de ces compensations fut probablement le droit de battre monnaie,
qu’il reçut sans doute avec le titre de sénéchal d’Aquitaine sous lequel il est
désigné en 1211, alors qu’à la tête de deux mille Basques envoyés, par
Jean-sans-Terre, au secours de Raymond VI, comte de Toulouse, il défendait les
Albigeois, contre lesquels il devait plus tard se croiser avec le roi de France.
Il se signala par des hauts faits qui lui méritèrent le titre flatteur de maître des braves.
Philippe-Auguste s’était obligé à lui céder Benon, si cette
place pouvait être prise. Jean-sans-Terre la lui donna avec d’autres domaines.
Cette jouissance immédiate, au lieu d’une possession éventuelle, dut être
d’autant plus agréable à Savary, qu’il n’était pas encore propriétaire des
domaines qu’avait eus Raoul de Mauléon, son père. La famille de Mauléon, alliée
à celle de Thouars, suivait dans ses successions, l’ordre établi dans la
vicomté de Thouars [1].
En 1213, Savary se soumettait à Philippe Auguste qui songeait
à la conquête de la Flandre. Cette guerre fut entreprise et conduite avec une
férocité dont l’histoire de cette époque laisse elle-même peu d’exemples.
L’armée et la flotte étaient prêtes ; elles attaquèrent simultanément un
pays qui était loin de s’attendre à pareille invasion. Savary de Mauléon, à la
tête de l’armée navale, s’empara de Dam où toute la flotte se mit à l’ancre, ce
qui se termina en véritable catastrophe : les renforts anglais, arrivés en
vue de la flotte française engagèrent aussitôt le combat et lui enlevèrent
quatre cents vaisseaux ; Philippe-Auguste ayant alors quitté le siège de
Gand pour venir au secours de la ville, mit le feu à ses propres vaisseaux,
malgré sa victoire, pour empêcher leur prise par les Anglais. Ainsi fut
entièrement consumé ce qui restait encore de cette redoutable flotte avec
laquelle il avait cru conquérir l’Angleterre.
On voit ainsi que Savary, vers 1213, s’était séparé de
nouveau des Anglais, et le 22 août de cette année, Jean-sans-Terre fit de
nouvelles propositions à son vassal révolté, qui ne les écouta qu’en 1214. La
fortune semblait alors sourire au roi d’Angleterre, débarqué en Aquitaine, qui
lui donna tous les biens paternels et maternels de Geoffroy de Magneville,
comte d’Essex, les seigneuries de Petrefield, Mapldurham, etc., dans le comté
de Southampton.
Il avait en effet combattu longuement sur le territoire
anglais, auprès du souverain britannique contre lequel les barons anglais
étaient alors révoltés. Il commandait alors les Poitevins venus soutenir le Roi
qui n’avait pour sa cause, pour ainsi dire, que des hommes nés hors de
l’Angleterre et surtout des Poitevins, devenus plus propres à faire des courtisans
que les normands d’origine, et qui supplantèrent ceux-ci. En 1215,
Jean-sans-Terre, ayant pris Rochester, voulait passer toute la garnison au fil
de l’épée et Savary de Mauléon n’eut pas peu de peine à faire sentir à ce roi
insensé que cette cruauté inutile en ferait commettre d’autres à ses ennemis
alors plus puissants que lui. Sire,
dit-il au prince, la guerre n’est pas
finie, et les armes sont journalières. Si vous faites pendre des gens de
qualité, nous éprouverons aussi un sort aussi honteux lorsque nous tomberons
aux mains de vos ennemis. A ce prix vous ne trouverez personne qui veuille
suivre vos étendards.
Ensuite par des lettres patentes du 25 mai 1215, adressées
aux barons de La Rochelle, d’Angoulême, de Limoges, de Niort et de Saint-Jean-d’Angély,
il ordonna que la monnaie de Savary de Mauléon et de ses descendants aurait
cours dans tout le Poitou et dans le duché d’Aquitaine.
Le roi Jean étant mort l’année suivante, Henri III son fils
ne fut pas moins bienfaisant envers ce poète, puisqu’il le nomma en 1222
sénéchal du Poitou et de la Gascogne.
En 1215, le pape Honorius III
lança l'idée d'une cinquième croisade lors du concile de Latran. Elle fut
dirigée par Jean de Brienne, roi de Jérusalem et Léopold VI, duc d'Autriche. Le
siège de Damiette, en Égypte avait commencé le 24 août 1218, et l'armée de Jean
de Brienne réclamait du secours. Savary de Mauléon "ratissa" alors
l'ensemble de ses domaines pour réunir la somme nécessaire à son départ en
croisade. Bien que le pape lui ait accordé le vingtième des revenus
ecclésiastiques du diocèse de Poitiers, ce ne fut pas suffisant. Il fut
contraint d'emprunter 3027 livres tournoi à Geoffroy de Neuville, chambellan du
nouveau roi d'Angleterre Henri III. En échange, il lui remit en gage ses
seigneuries de Bouhet, Ile de Ré, Benon et Châtelaillon.
Savary de Mauléon arriva à Rome en juin 1219. Toujours à cours d'argent, il
emprunta encore 1200 marcs d'argent. Enfin réunis, les croisés partirent de
Gênes le 23 juillet 1219, sur dix galères génoises, dont trois appartenaient
personnellement à Savary de Mauléon et débarquèrent devant Damiette. La cité
fut prise d'assaut le 5 novembre 1219 et le succès lui est en partie attribué. La
ville ne sera évacuée définitivement qu'en septembre 1221.
Savary put ensuite rentrer
sans encombre en Poitou où il continua à guerroyer. Cependant, ses emprunts ne
furent jamais complètement remboursés. Geoffroy de Neuville ne rendit jamais
leur argent aux bourgeois rochelais, qui écrivirent en 1222 une lettre au roi
d'Angleterre pour qu'il pallie à leur détresse !
Savary commandait en chef l’armée anglaise en Poitou en 1224 ;
assiégé dans Niort par Louis VIII, il fut contraint de capituler, et put, en
vertu de la capitulation, se retirer à La Rochelle. Bientôt Louis VIII parait
devant cette nouvelle place, Savary, qui en est le gouverneur, s’y défend
vaillamment et, peut-être les efforts français eussent-ils été longtemps
inutiles sans la mésintelligence qui régnait entre les Anglais et les
habitants. Ceux-ci, considérant qu’ils ne pouvaient recevoir de secours
d’aucune part, rendirent la ville au Roi
et lui jurèrent tous fidélité. On prétend que le gouverneur, ayant demandé du
secours d’argent à la Cour d’Angleterre, on lui avait envoyé, au lieu d’argent,
un coffre plein de ferraille ; une négligence si condamnable pour la
conservation d’une place qui piqua tellement le gouverneur qu’il se rendit en
peu de jours. Quoiqu’il en soit, Savary
se retira avec les Anglais et fit voile vers l’Angleterre. Irrités de leurs
revers, les Anglais soupçonnèrent le sire de Mauléon de les avoir trahis et
voulurent se saisir du vaisseau qui le transportait dans leur île. Savary en
est instruit, leur échappe, vient débarquer en France, se jette au pied du Roi,
qui l’admet à l’hommage le jour de Noël 1224.
Il avait craint de trouver dans le Roi un ennemi irrité , qui
vengerait par la confiscation de ses possessions ses anciennes perfidies ;
il avait voulu se mettre à couvert de cette vengeance méritée, et, avant de
faire sa soumission au Roi, il s’était, à l’exemple de Jean-sans-Terre, déclaré
feudataire du Saint-Siège, avait soumis ses possessions à une redevance envers
Saint-Pierre, et avait demandé au pape la confirmation de toutes les cessions
de territoire et des droits que lui avait accordés les rois d’Angleterre.
Honorius III le reçut comme censitaire et lui accorda la confirmation qu’il
demandait. Les princes de Mauléon, tributaires du Saint-Siège, mirent alors de
nom de Jésus sur leurs monnaies pour
annoncer qu’ils tenaient du souverain pontife le droit de les battre.
Après la mort de Louis VIII, en 1226, un soulèvement
s’organisa contre la régence de Blanche de Castille. Les principaux ligueurs
étaient les comtes de Bretagne, de la Marche et de Champagne, tous liés par
sang à la famille royale. Henri III, roi d’Angleterre, soutenait le comte de la
Marche, son beau-père ; le duc de Guyenne, Richard, prince anglais,
offrait l’appui de ses troupes aux comtes de Champagne et de Bretagne ;
elles étaient commandées par Savary de Mauléon, réconcilié avec les Anglais,
qui passa la Garonne, vint insulter la Rochelle, et souleva la noblesse du
Poitou contre le Roi. Les coalitions sont par nature lentes à se former et à
concerter leurs plans : la Reine ne
laissa point aux rebelles le temps de s’entendre et de se fortifier : elle
marcha contre eux si rapidement qu’elle les déconcerta. Thibaut de Champagne
fut vaincu sans combattre, ayant vu son amour ranimé au cours d’une entrevue
accordée par la Reine. Le autres rebelles vinrent à Vendôme et se soumirent au
Roi. Il ne restait plus d’ennemis à combattre que les Anglais. Savary, leur
chef, fut défait et forcé de se retirer en Gascogne.
Savary qui continua de commettre toutes sortes de
déprédations sur terre et sur mer, vivait encore au mois de mai 1233. Il
confirma à cette époque, en faveur de l’abbaye de Luçon, le don de l’île de
Choupeaux. C’est le dernier titre que l’on connaisse de lui et il ne dut pas
survivre longtemps à la confection de cette charte. Il parait s’être retiré en
Angleterre dans les dernières années de sa vie, et il y mourut le 22 juillet
1233 [2].
Il avait créé en 1218 les Sables d’Olonne pour remplacer le
port de Talmont condamné par l’envasement.
Bien qu’il ne reste que peu de poésie de
ce noble troubadour, il est cité parmi les meilleurs poètes du XIIe siècle. On
disait aussi qu’on pourrait composer un gros livre de ses belles actions. Mais
ses succès en galanterie sont plus connus que ceux qu’il obtint en littérature
et dans la guerre. Plusieurs manuscrits du XIIIe siècle ont conservé les
aventures amoureuses de ce chevalier. Hugues de Saint-Cyr, son biographe, lui
donne pour maîtresse une noble dame de Gascogne, Guillemette de Benavias, femme
de Pierre de Gavaret. Abusé par sa dame, il tourna ses affections sur la
comtesse Mahaut de Montagnac, puis sur la belle Guillemette de Benanguises.

Château-fort de Mauléon (XIIe
siècle)
D’après
une charte de 1227, Savary III de Mauléon épousa Amielle de Ré en l’église de
la Tranche. D’autres textes disent que cette Amielle de Ré était sa mère !
Il avait épousé Belle-Assez de Pareds
(ou de Chantemerle), dame de Pouzauges, comme l’indique une charte du 28 juin
1212 par laquelle Savary, du consentement de sa femme, abandonnait une rente
féodale à l’abbaye d’Absie-en-Gatine.
Après la mort
de Belle-Assez, sa femme, vers octobre 1222, il contracta avec Amabilie de Bois une union
jugée irrégulière, puisque leur fils, nommé
Raoul, fut légitimé par l’évêque de Bordeaux sur ordre du pape puis par le roi
d’Angleterre par lettres patentes du 10 mai 1232.
La fille de Savary, Alix, dont nous
descendons, épousa Guy, vicomte de Thouars. Elle eut en dot l’île de Ré, Benon,
Châtelaillon et Mauléon.
Sources :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
http://pagesperso-orange.fr/milleansabouhet/html/f-croisade01.htm
Revue
Anglo-française tome second
Essais
historiques sur les Bardes, les Jongleurs et les trouvères normands et
anglo-normands, par l’abbé de la Rue, tome troisième
Œuvres
complètes de M. le comte de Ségur, tome cinquième, page 42
Pour en savoir plus :
---------------------------------------------------------------------------------------
Savary de Mauléon par Bésilaire Ledain
Lien de
parenté : ------------------------------------------------------------------------------------------
Père d’Alix, mère d’Aimeri VIII de THOUARS, père de Guy II, père de Marguerite, mère de Guy de PARTHENAY-SOUBISE, père de Jeanne, mère de Louis CHAUDRIER, père de Jean, père de Jeanne, mère de Jacques JOUSSEAUME, père de René, père de Jeanne, mère de Jacqueline GILLIER, mère de René LEVESQUE, mère de Jeanne de HAUTEMER, mère de Claude d’ETAMPES, mère
de Michel-Clériade du FAUR de PIBRAC, père
de Marguerite, mère de Bénigne BERBIS de RANCY, mère de
Marie CHIFFLET d’ORCHAMPS,
mère de Victoire BOQUET de COURBOUZON,
mère d’Adèle LE BAS de GIRANGY, mère de Marie-Eugénie GARNIER de FALLETANS, mère de Maurice O’MAHONY.