|
Fiche
N° 0031 |
Auteur D. Barbier |
20/09/2008 |
||
|
Jean DE LANGLE |
Ascendant ¤
Allié ¡ |
|||
Conseiller au parlement de Bretagne, auteur
de l’Otium Semestre en 1577
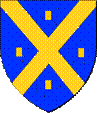
Jean
de Langle (1510-1590) joua un rôle important au parlement de Bretagne, dans la
période difficile de la lutte entre catholiques et huguenots. Il tint le parti
des premiers, alors que son beau-frère Charles de Montauban devint un des chefs
du parti royaliste et huguenot. Jean de Langle passait la moitié de l’année à
Montluc [1],
afin de s’y occuper de ses terres et de se livrer à des travaux intellectuels,
entre autres à l’écriture d’un énorme livre en latin, publié en 1577 sous le
titre Otium semestre, avec ses souvenirs et ses réflexions sur la
justice. C’est à Montluc que naquit en 1587 son fils Prigent, issu de sa
troisième épouse. De Langle avait alors 77 ans et mourut en 1590.
_______
Extraits d’un article de M. Ropartz
paru dans le Bulletin archéologique de l'Association bretonne de 1877.
Le Parlement de Bretagne a produit trois
écrivains contemporains de d'Argentré [2]. Le plus célèbre des
trois et le seul resté célèbre, Noël Dutail, est aujourd'hui l'objet des
études les plus approfondies et j'allais dire des études passionnées de M. de
la Borderie. Je veux étudier, à mon tour, Jean de Langle, et en manière
d'épisode, Guillaume de Lesrat, pour faire connaitre les deux autres figures de
ce groupe parlementaire, qui tient sa place, non sans honneur, à côté de
d'Argentré, de Duaren et d'Eguiner Baron, dans l'histoire trop peu étudiée de
la Bretagne littéraire au XVIe siècle.
Jean de Langle fit imprimer en l'année 1577, un
très-respectable volume in-folio, sous le titre d'Otium semestre, qu'on
peut traduire par : Mes vacances. Ce qu'il y a d'érudition de toute
sorte dans cet énorme bouquin, écrit dans le latin le plus solennel dont
faisaient parade les lettrés du XVIe siècle, est prodigieux. Prosateurs,
poètes de l'antiquité et de la Renaissance, tout y trouve place ; de
Langle a lu tout ce qui avait été imprimé de son temps : sa bibliothèque
devait égaler celle de d'Argentré dont le curieux et instructif
catalogue écrit proprio manu, est conservé à la Bibliothèque de
Rennes.
Jean de Langle, comme l'écrit Guy de Lesrat,
fils de Guillaume Lesrat, qui avait hérité de l'amitié de de Langle pour son
père, était digne «du vieux sénat romain, et par la noblesse de sa naissance,
et par l'importance de son patrimoine. » Les de Langle, sieurs dudit lieu,
tiraient leur origine de la paroisse
du Moustoir-Radenac, au diocèse de Vannes. Leurs armes sont d'azur, au sautoir
d'or, accompagné de quatre billettes du même.
Jean de Langle, d'après les productions faites
pour la réformation de 1668, descendait de Pierre, juveigneur d’Olivier de
Langle, fils de Jehan et de Marguerite de Cléguennec (1479-1511). Il acheta, en
1529, la terre de Kerlevenez, bien patrimonial, qui n'avait été donné à son
père qu'en viager. Sa petite-fille, Catherine, épousa, en secondes
noces, Louis de Langle, son cousin, fils puiné de Julien et de Jehanne de
Bullion, et en eut un fils unique, Hiérosme, lequel, encore enfant, en 1584,
hérita de René de Langle, son cousin, tué par Guillaume de Chesnays, et devint
ainsi chef de nom et d'armes de la maison de Langle, du vivant de son bisaïeul.
La généalogie des de Langle remonte au XIVe siècle.
Jean de Langle fut destiné, dès l'enfance, à la
magistrature. Il commença ses études fort jeune, à Poitiers, et les alla
terminer à Bourges, sous le célèbre Alciat. Il y eut, entre autres, pour condisciples,
Denis Riant, futur président au Parlement de Paris, qui vint le visiter à
Nantes, et Nicolas Alixant d'Orléans, devenu président à la première chambre
des enquêtes, en Bretagne, et qui a écrit une des épitres liminaires de l’Otium
semestre.
Après avoir terminé ses études, de fortes
études, comme le prouve son livre, de Langle vint faire ses débuts d'avocat,
probablement au barreau de Nantes, ce qu'il ne dit expressément nulle part.
L'âge exigé pour les débuts au barreau était
fort controversé au XVIe siècle. En usage, on n'exigeait que seize ans.
C'était peu. Quand de Langle débuta, le diplôme de licencié en droit était
exigé, et les Bretons étaient obligés de l'aller chercher hors de la province,
l'Université de Nantes étant en pleine décadence. Avant lui, la magistrature
bretonne faisait subir aux praticiens un examen spécial, analogue à celui qui
fut toujours en usage pour la magistrature elle-même. Cet examen fut maintenu,
même après l'exigence du diplôme. On pouvait être pourvu par la Faculté
de tous les diplômes, et ne pas savoir par quel bout prendre le plus
élémentaire des dossiers. Après l'examen, l'avocat prêtait le serment
professionnel, qu'il renouvelait chaque fois que le juge l'exigeait.
De Langle entra dans la magistrature, probablement
dès qu'il eut atteint l'âge légal. A la page 562 de l’Otium semestre, il
raconte une histoire, qu'il date, si sa mémoire est fidèle, du mois de mai
1539. Il faut peut-être rectifier et dire 1538 ; car, lors de l'anecdote, il
était prévôt de Nantes, et nous voyons par le procès-verbal de la Réformation
de la Coutume, du 2 octobre 1539 et jours suivants, qu'il comparaît devant les
commissaires en qualité de lieutenant de Nantes. Me Ollivier de Lescouet,
docteur aux droits, était alors prévôt. Serait-ce dans l'intervalle de mai à
octobre que de Langle aurait changé et monté de grade dans la sénéchaussée de
Nantes ? Quoiqu'il en soit, ce procès-verbal apprend qu'il n'avait que le titre
de licencié aux lois; tandis que Christophe Brexel, sénéchal, Ollivier de
Lescouet, prévôt, et Guillaume Laurans, procureur du Roi, à Nantes, à la même
époque, étaient docteurs en droit.
A propos de la justice sommaire en cas de
flagrant délit, de Langle raconte que, plusieurs fois, pendant qu'il exerçait
les fonctions de prévôt (ou juge d’instruction) de Nantes, il eut à juger des
voleurs qui coupaient des bourses dans l'audience même. Séance tenante, il
faisait entendre les témoins, et, sans autre forme de procès, condamnait le
délinquant à la marque ou au carcan.
Au mois de mars 1551, (vieux style,—nous
dirions aujourd'hui 1552 [3],)— furent créés les
présidiaux en Bretagne. De Langle garda son titre de lieutenant au nouveau
présidial de Nantes. C'est dans ce poste que le trouva le Parlement de
Bretagne, créé deux ans plus tard.
Le Parlement de Bretagne fut créé «à l'instar
de celui de Paris », par un édit de Henri II, daté de Fontainebleau, au mois de
mars 1553 (vieux style). Jusque-là la Bretagne n'avait eu qu'un Parlement
transitoire et ambulant, qui ne tenait audience qu'une fois l'an, pendant le
mois de septembre et les cinq premiers jours du mois d'octobre. Ce Parlement,
qu'on nomma les GrandsJours, ne jugeait les affaires civiles que sauf
appel au Parlement de Paris ; les affaires criminelles étaient jugées en
appel par une cour spéciale, nommée le Conseil de Bretagne.
Le nouveau Parlement comprenait quatre
présidents et trente-huit conseillers. Les quatre présidents devaient être
étrangers à la Bretagne ; les conseillers étaient divisés par moitié en
conseillers originaires, c'est-à-dire nés en Bretagne et y demeurant, et en
conseillers français ou non originaires. Le parquet se composait de deux
avocats du Roi et d'un procureur-général. Les trente-deux conseillers et les
présidents étaient répartis en deux séances : l'une siégeant à Rennes pendant
les mois d'août, septembre et octobre, et l'autre, siégeant à Nantes
pendant les mois de février, mars et avril.
Un des conseillers, reçus à Nantes, au mois de
février 1554 (V. S.), lors de la première réunion du Parlement sédentaire dans
cette ville, Me Nicolle de Colledo , l'un des doyens parmi les originaires ,
avait bientôt cessé de paraître aux audiences ; le 20 ou le 21 avril , il était
mort. Le 22 avril, « les gens du Roy sont advertis de nommer quelques
personnages capables et suffisants de ce pays, pour tenir et avoir la place
déconseiller que tenoit feu Me Nicolle Colledo , mort et décédé, conseiller en
la cour, afin que la cour y délibère pour en avertir le Roy; mesme de venir
demain requérir ce qu'ils verront bon estre. » — Le lendemain,
23 avril «les gens du Roy, entrés en la cour,
ont nommé Me Jean de Langle, lieutenant de Nantes, Jean de Musillac, lieutenant
criminel de Vannes, Jean Jozel, sénéchal des Réguaires de Nantes , et Mathieu
André, avocat en la cour, et chacun, pour estre, l'un d'eux, moyennant
le bon plaisir du Roy, pourvu de l'estat et office de conseiller en ladite
cour, au lieu de feu Me Nicolle de Colledo, naguères mort et décédé, conseiller
en icelle. » La cour, chambres assemblées, c'est-à-dire tout le semestre réuni,
sanctionna les trois premières présentations des gens du Roi, et pour se
conformer au règlement qui n'en voulait que trois, radia la dernière.
Pendant les vacations, les conseillers
originaires de Bretagne devaient tenir la chambre criminelle. Des lettres ayant
été délivrées par le Roi, à la date du 16 mai 1555, en faveur de Jean de Langle,
la chambre criminelle de Nantes se l'adjoignit, sans autre formalité. Cela
choqua fort les conseillers étrangers, et la cour exigea une réception plus solennelle
en dehors des vacations. De Langle dut donc se présenter à Rennes, à l'audience
du 12 août 1555. De Langle fut installé sans avoir été soumis à la formalité de
l’examen, qui déjà était de règle et d'usage. Sa qualité d'ancien magistrat
breton, présenté par la cour elle-même, l'en dispensa.
De Langle faisait partie de la séance de
Nantes, où il vint siéger le 1er février 1555 (V. S.) et fut désigné
pour faire partie de la Grand'Chambre, avec le premier président, René Baillet.
Dans le même temps et quelques mois après,
survint un édit du Roi, supprimant la séance de Rennes et établissant tout le
Parlement à Nantes. Les gens tenant la chambre criminelle à Nantes, et par
conséquent notre de Langle, nantais de séjour et d'habitudes, s'empressèrent d'enregistrer
cet édit de translation. Le Parlement de Rennes protesta énergiquement, dès le
9 août. Ce qu'il, y a de piquant, c'est que Jean de Langle avait dû siéger, à
Rennes, pendant ce trimestre, pour remplacer les absents et les morts , et
qu'il assista ainsi à la protestation faite contre l'édit qui transférait le
Parlement à Nantes. Le Roi répondit à cette
protestation, en maintenant son édit de juin. La séance d'août 1558 se
tint effectivement à Nantes. Nantes vit encore le Parlement siéger pendant toute
l'année 1559; cela paraissait définitif, si bien que le 26 février de cette
année, la cour manda la communauté de ville, pour la sommer de lui faire élever
un palais.
Pendant que les Nantais délibéraient, les
habitants de Rennes agissaient, et, appuyés
par le duc d'Etampes, ils enlevaient la place à leur tour. Le 4 août 1561 le
Parlement rentrait définitivement à Rennes.
Jean de Langle, était réputé depuis
longtemps l'un des plus érudits des conseillers du Parlement de Bretagne : on
admirait, dans ses rapports et dans les délibérés, la connaissance approfondie
qu'il avait des ouvrages anciens et modernes, et la sagacité avec laquelle il
les discutait et les citait pour formuler une opinion. On regrettait que
quelqu'un n'eût pas pris des notes, et l'on suppliait de Langle lui-même
d'écrire sur le droit. Tel serait même l'origine première de son livre.
Les registres secrets du Parlement constatent,
en effet, que de Langle fut très-souvent rapporteur d'affaires des plus
délicates et des plus difficiles. — Je veux relever ici quelques traits sur les
faits principaux de sa vie parlementaire, depuis l'époque où le Parlement fut
définitivement établi à Rennes.
Les troubles qui ensanglantaient tout le
royaume, avaient à peine un écho en Bretagne. La guerre civile ne commença dans
la province qu'en 1589. La Saint-Barthélemy fut apprise chez nous presque comme
une légende. En 1568, le président Callon répondant au gouverneur Sébastien de
Luxembourg, qui exhortait le Parlement à maintenir en Bretagne le calme et l'union,
pouvait dire : « Monsieur, vous pouvez être nommé le plus heureux prince et
gouverneur de l'Europe; car cette province a été conservée par votre prudence
et vaillance, comme une chose mise au milieu d'un grand feu et flamme, sans
aucunement s'en ressentir. »
Cette harmonie fut un instant troublée par
l'application des édits de septembre 1568, qui interdisaient dans tout le
royaume toute autre religion que la religion catholique, et qui prononçaient la
destitution des fonctionnaires prétendus réformés. Tous les membres du
Parlement, dont de Langle était momentanément absent, durent prêter, à partir
du 2 février 1569, le serment spécial qui fut imposé à tous les magistrats et
les gens de justice du ressort :
« Nous soussignez présidents, maistres
des requestes, conseillers, advocats et procureurs généraux , jurons ,
promettons et confessons devant Dieu et en la court, ès mains de vous, M. le
Président, tenir la foy et religion telle que l'Eglise catholique, apostolique
et romaine tient, et ont tenu les Roys de France très-chrétiens, et tient le
Roy notre souverain Seigneur, qui règne à présent : et en l'obeissance
d'icelle, vivre et mourir. »
Avant que cette formule fut jurée et signée, le président Pierre Brulon dit à
la cour : « Messieurs, c'est peu de chose de jurer de
vivre catholiquement et signer, si hors la court chascun ne se montre tel par
effect que ses serment et seing l'obligent. Fault oultre cela que en la famille
fasse devoir envers sa femme, ses enfants, serviteurs, servantes et aultres sur
lesquels il a puissance, leur enseignant tenir mesme foy et mesme religion; et
pour ce, Messieurs, vous exhorte et admoneste chacun de vous observer
perpétuellement et à jamais, garder la profession qu'estes prests de faire,
non-seulement au palais , en agissant ou aultrement faisant vostre office, mais
partout ailleurs, tant ès lieux publics que privez et domestiques. »
Tous les conseillers et officiers subalternes
du semestre de février présents prêtèrent ce serment sans hésiter. De Langle
qui, pour des causes inconnues, était absent et excusé, le prêta à son tour, le
6 février 1570. Le Parlement de Paris avait envoyé l'un de ses membres, Jérôme
Anroux, qui avait été conseiller jadis en Bretagne, pour assurer
l'exécution des édits contre les protestants. Cette
intervention fut vue avec défiance, et occasionna des tracasseries à plusieurs
des conseillers ; mais, en somme, le président Callon, qui eut pour
successeur au titre de second président, Pierre Brulon, Antoine Fumée,
président aux enquêtes, qui donna sa démission et fut remplacé par Jean
Foucault, et quatorze autres conseillers qui refusèrent le serment, furent
seuls exclus du Parlement, et destitués par lettres du Roy, de janvier 1570.
Cette destitution, pour plusieurs, ne fut que
temporaire, et la plupart des exclus rentrèrent presque immédiatement après
l'édit de pacification. De telle sorte, néanmoins, que, dans l'avenir, le
Parlement de Rennes put se glorifier de n'avoir jamais compté aucun de ses
membres, ayant publiquement professé une religion autre que la religion
catholique.
En l'année 1570, des troupes nombreuses furent
massées en Bretagne, comme je l'ai dit à propos de Sainte-Marthe et de ses
relations avec de Langle. Pendant que les deux savants causaient à Nantes, on
occupait la maison que de Langle avait retenue, probablement
à titre de location, à Rennes. Le fait était
dénoncé à la cour, le 3 février 1571. — « La
cour advertie qu'aucuns des logis des conseillers, entre autres de Me Jean de
Langle et Jacques Le Maistre, estoient occupés par les gens d'armes de la
compagnie de M. de Montpensier, gouverneur et lieutenant général en ce pays, a
député Me Guillaume Gaudin , greffier civil d'icelle, et Jean Fescan, greffier
criminel, pour se transporter vers le séneschal de Rennes, affin de l'advertir de pourvoir
qu'aucun des logis desofficiers de la dicte court ne soit occupé, et faire
vuider ceux qui les empêchent. »
Noël Dufail entra à la cour le 21 février 1572,
sur la résignation de Jean Turpin, l'un des conseillers de la séance d'août,
qui avaient refusé le serment.
Le 14 avril de la même année, de Langle fut
commis pour présider la chambre des enquêtes, dont les présidents avaient été
récusés ; au mois de février 1573, il devenait doyen des conseillers de ce
semestre.
Après l'avènement d’Henri III, l'horizon sur
les marches même de la Bretagne, s'assombrit singulièrement.
Au mois de février 1575, le conseiller, Jean de
Marbeuf, se rendant à la séance de la cour, fut enlevé par un parti de cinq
gentilshommes, qui couraient la campagne , et séquestré à l'île de Rhé jusqu'à
ce qu'il eut payé 8,000 livres de rançon. Un brigand, du nom de Guillaume de
Lestang, rançonnait la banlieue de Rennes même. Il fut arrêté ; ce fut
l'occasion d'un conflit entre les juges de Montfort et le présidial de Rennes,
qui prétendait que le prisonnier lui appartenait. D'Argentré, depuis longtemps
sénéchal de Rennes, fut mandé à la barre du Parlement, qui prenait parti pour
les juges de Montfort.
Il répondit avec fermeté. Il lui fut expliqué «
que la cour avoit vériffié comme lui les
édicts concernant le pouvoir et juridiction des sièges présidiaux; qu'elle les
vouloit maintenir, pourvu qu'ils se continssent ès bornes et limites des dits
édits ; mais qu'elle devoit aussy avoir l'oeil qu'ils ne les outrepassassent et
entreprissent la connoissance de ce qui ne leur appartient; que la douceur avec
laquelle la cour avoit cy-devant usé en leur endroit, les avoit rendus
insolents et si téméraires qu'ils avoient bien osé s'attaquer à la dicte cour, et quasi contendre de parité avec elle.
»
Le 2 mai 1575, un des premiers actes de Henri
III fut d'exiger la prolongation des deux semestres pendant quatre mois consécutifs,
au lieu de trois mois qui avaient été habituellement la durée des séances, le
quatrième mois, d'après l'édit de création, étant facultatif.
Plus tard survint, comme je l'ai dit, la
création de la chambre des Tournelles, qui entraînait la nomination de deux
présidents en plus, et qui fut, sinon la cause, du moins l'occasion de la
création d'un certain nombre de charges de conseillers.
Les années 1576, 1577 et 1578 s'écoulèrent sans
que rien d'important se produisit à la séance de février, à laquelle de Langle
resta toujours attaché. Des bandes armées couraient parfois le pays et
s'emparèrent par surprise, mais pour quelques heures seulement, de la ville de
Dol, dont elles chassèrent la petite garnison royaliste.
Deux des conseillers du Parlement, envoyés en
mission de Rennes à Nantes, furent, au retour, arrêtés et pillés. Le Parlement,
effrayé du nombre de gentilshommes étrangers qui affluaient à Rennes, sous
prétexte de suivre leurs procès , suspendit tout jugement des affaires où
étaient mêlés des gens obligés au service des armes, ordonnant aux prétendus
plaideurs de regagner les cantons où ils étaient soumis au ban et à l'arrière
ban.
Dans les derniers mois de l'année 1578, de
Langle, atteint d'une ophtalmie, comme nous l'apprend Guy de Lesrat,
résigna sa charge à Louis Collobel, qui présenta ses lettres à l'audience du 7
février 1579, et fut reçu, après avoir passé son examen et prêté serment,
le 18 février suivant.
L’Otium semestre avait paru en 1577,
imprimé à Rennes, par Julien du Clos, aux frais de Pierre Le Bret, libraire à
la Porte-Saint-Michel. C'est certainement un des plus remarquables monuments de
la typographie bretonne au XVIe siècle.
Le privilège donné à Pierre Le Bret est du 3 juin 1576. La dédicace de
Jean de Langle est datée de Rennes, aux calendes d'avril 1577. Cette
dédicace est suivie d'une épître de Nicolas Alixant, datée de Rennes, le
7 des calendes de mai 1574, — de l'épitre et des vers de Guy de Lesrat; de deux
petits poèmes du conseiller Jean Huby, qui y indique son origine vannetaise ;
d'un autre poème de Jules Guersent, aussi conseiller; d'un poème, encore, de
Guy Le Meneust, alors avocat à la cour et procureur de la Reine
Catherine de Médicis, le même qui succéda à Bertrand d'Argentré comme
sénéchal de Rennes, et s'acquit une réputation en dirigeant le mouvement
qui maintint la ville de Rennes sous l'obéissance du Roi.
Viennent ensuite des vers de Guillaume Brenezay
, l'un des substituts des gens du Roi ; et de Jan Ygier, avocat. Ces petits
poèmes, dont le meilleur ne vaut pas grand'chose et qui se ressemblent
tous, sont suivis d'une longue épître
adressée au Parlement de Bretagne pour faire, à grands renforts
d'érudition grecque et latine, l'éloge de Jean de Langle, par Jean
Morin, premier président de la cour des Comptes, et dont Joachim
Descartes, le père de René , épousa la fille en secondes noces. Jean Morin,
comme Guy de Lesrat, ne se contente pas de la prose, et y joint des vers; ils
sont imités par Jacques Gourreau, avocat général au Parlement, qui, pour
remplir la dernière page des liminaires, écrit une petite épître et seulement
quatre vers. Cela fait neuf comptes-rendus hyperboliquement élogieux. Pour
compléter la décade, il faut y joindre l'épître de Jean Baudoin, datée de 1573
, en tête du XIIIe livre de l’Otium.
M. Baron du Thaya croit pouvoir signaler deux
ou trois éditions subséquentes de l'Otium semestre, avec des
observations de Bernard Automne. Paris, 1611, 1616 et peut-être 1700, in
4°. Ces éditions sont indiquées par Lipenius et Schott, dans la Bibliothèque
de jurisprudence. Je n'ai trouvé aucune de ces éditions, et M. du
Thaya ne dit pas les avoir vues. On sait que les catalogues, même les meilleurs,
ne sont pas parole d'évangile, et que, de tout temps, les libraires changèrent
simplement le titre d'un livre et sa date, pour faire croire à une
réimpression.
Pendant qu'on imprimait l'Otium semestre , ou,
pour mieux dire, à la veille du jour où allait commencer l'impression, Jean de
Langle fut nommé par le Roi membre de la commission chargée de présider à la
réformation de la Coutume de Bretagne. L'ordonnance du Roi est du 12 mai 1575,
et nomme : le premier président, René de Bourgneuf ; le second président,
Pierre Brulon ; Bertrand Glé ; Jean de Langle, sieur dudit lieu ; Jacques
Foucault, et Pierre Couturier, auxquels fut joint l'année suivante, Nicolas
Alixant ; le procureur général, le sénéchal de Nantes et le sénéchal de Rennes,
qui était alors Bertrand d'Argentré.
Jean de Langle n'assista pas aux premières
réunions, qui se tinrent à Rennes, en août et septembre 1575 ; mais il était
présent à celles qui se tinrent en mars et avril 1576. Il ne se rendit pas à
Vannes, où la commission s'ajournait pour le 15 mars 1577; en 1580, ayant,
comme nous l'avons vu, cédé sa charge au Parlement, il ne vint ni à
Rennes, ni à Ploërmel, où les Nouvelles coutumes furent
définitivement arrêtées.
Son nom n'apparaît même pas au procès-verbal de
clôture, qui fut signé à Rennes le dernier jour de janvier 1581, et où figurent
seulement René de Bourgneuf, Pierre Brulon, Glé, Alixant et d'Argentré.
Jean de Langle s'étant retiré de la cour,
semblait s'être retiré du monde, et n'était le petit traité sur les
conseillers honoraires, publié en 1581, il ne donna plus signe de vie. J'ai dit
comment Guy de Lesrat signalait le grand âge, les yeux chassieux et la vue
affaiblie du vieux conseiller; M. du Thaya écrit qu'il perdit sa femme: tous
ces motifs réunis lui dictaient une retraite absolue, dont on le voit tout à
coup sortir en 1590.
L'assassinat des Guise aux Etats de Blois, à la
fin de 1588, triste revanche de la Saint-Barthélemy, avait été le signal fatal
de la guerre civile en Bretagne. Mercoeur, chef obligé de la Ligue, s'était vu,
en 1589, fermer les portes de Rennes , et l'immense majorité du Parlement
s'était nettement prononcée pour le Roi. La Ligue obtint des lettres patentes
du duc de Mayenne, àla date du 19 juillet 1589, par lesquelles le Parlement
était enlevé à Rennes, ville rebelle, pour être établi dans telle autre ville
qu'il plairait à Mercœur indiquer. Mercœur indiqua Nantes; et, le lundi 8
janvier 1590, dans la chapelle des Cordeliers, on vit assister à la messe du
Saint-Esprit, Messire Loys Dodieu, président; Pierre Carpentier, autre
président, qui fut l'âme de ce Parlement de la Ligue, et neuf
conseillers, tous membres ou anciens membres du Parlement de Bretagne. En tête
et comme doyen, figurait notre Jean de Langle, démissionnaire depuis onze ans;
à côté d'Aradon, ayant aussi cédé sa charge de Rennes, et qui allait bientôt
céder de nouveau celle de Nantes, pour devenir évêque de Vannes.
De Langle, très-fervent catholique, mais plus
qu'octogénaire, et entraîné plutôt à une manifestation qu'à la reprise sérieuse
de ces fonctions de magistrat, qu'il avait jadis si longuement et si
honorablement remplies, ne parut absolument qu'à cette première séance
du 8 janvier. Huit jours après, il était mort, et, le17 janvier, le
procès-verbal, au Registre secret du Parlement de la Ligue, porte
cette simple mention : « La cour s'est
levée pour aller à l'enterrement de Mc Jean de Langle, conseiller. »
Quand le Parlement de Rennes condamnait les
membres du Parlement de Nantes, et très-nommément Jean de Langle, à être pendu,
celui-ci était donc parfaitement à couvert de cette condamnation, puisqu'il
était inhumé depuis plusieurs semaines.
Lien de parenté :
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Père de Jeanne, mère de Georges de Muzillac, père de Jacques,
père de Marguerite, mère de Marie-Haude du Chastel, mère de Jeanne-Charlotte
Huchet de la Bédoyère, mère de Charles-François du Bot du Grégo, père de
Louise, mère de Charles-Félix d’Amphernet de Pontbellanger, père de
Michel-Adrien, père de Marthe, mère d’Yvonne O’Mahony, mère de Monique
Bougrain, mère de Dominique Barbier.
