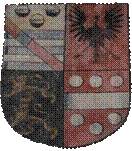|
Fiche N° 0044 |
Auteur D. Barbier |
18/10/2008 |
||
|
Jean CHAUDRIER |
Ascendant ¤ Allié ¡ |
|||
Maire de la Rochelle, célèbre
pour avoir libéré la ville de l’occupation anglaise en 1372
|
|
Sur ce blason, peint à fresque sur un mur du manoir de
la Possonière, où naquit Pierre de Ronsard [1], on peut voir au 1 les armes
Chaudrier (d’azur à deux fasces d’argent au chef d’argent chargé de trois
chaudières avec leurs anses de sable posées deux et une) accompagné de
Parthenay (au baston composé d’argent et de gueules chargé en chef d’un quartier miparti d’or
et de gueules brochant sur le tout). |
Le 8 janvier 1373 Jean Chaudrier,
bourgeois de la Rochelle, reçut du roi
Charles V une lettre de confirmation [2] du don de la terre de Dompierre-sur-mer
fait en récompense de ses services et aussi parce qu'il y avait des droits à
cause de sa femme, Jeanne de Parthenay, fille de Guy Larchevêque, seigneur de
Taillebourg, à laquelle elle avait été assignée comme dot par son père.
Jean
Chaudrier ou Chauderier ou Coudorier (1323-1381), fut l'un des personnages les
plus marquants de l'histoire de la Rochelle, dans la seconde moitie du
XIVe siècle, maire de cette ville, en 1359, 62, 66, 70 et 73, coélu du maire en
61, 72, et 77, qui a tant contribué à rendre à la Rochelle sa nationalité
française, « et à lui créer l’heureuse situation dont elle profita pour obtenir du
roi Charles V ces importants privilèges qui assurèrent son indépendance en
l’exemptant à l’avenir de garnison, de citadelle et de gouverneur militaire,
élevèrent au droit de noblesse les maires et échevins de la commune, et la
gratifièrent de franchises commerciales qui devinrent la source de sa grande
prospérité [3]. »
Jean
Chaudrier était, en effet, maire de la Rochelle en 1359, lorsque Jean, roi de
France, consentit à comprendre cette ville dans sa rançon. C'est lui qui reçut
les premières lettres par lesquelles ce pauvre monarque invitait les Français à
livrer leur pays pour délivrer leur roi. Il refusa d'y obéir. L'année suivante,
il fut un des cinq députés que la Rochelle, après des sommations réitérées,
envoya à Calais pour recevoir les ordres des deux rois de France et
d'Angleterre, mais aussi pour poser les conditions de son obéissance. Ils
eurent beau remontrer que la Rochelle,
par sa position et son commerce, était trop utile à l'État pour qu'on
pût songer à l'aliéner, leurs
instances furent vaines. Il fallut obéir à la dure nécessité [4]. S'ils
ne purent l'empêcher de passer sous la domination de l'Angleterre, du moins ils
obtinrent des deux princes la ratification de ses privilèges, et même quelques
avantages nouveaux.
Anobli
par acte du régent Charles [et
non pas par le roi Edouard III comme on le lit souvent], daté de Paris, juillet
1359, les considérants de ses lettres de noblesse lui font le plus grand honneur. Il y est dit qu'il avait
rendu au roi des services éminents, spécialement à la reprise des villes et forteresses de Rochefort, de
Salles, de Fourras et autres,
dont les Anglais s'étaient
emparés, reprise à laquelle il avait participé et assisté en
personne, étant capitaine de gens d'armes et de pied de la ville de la
Rochelle et du pays voisin [5]. L'année suivante, au mois d'octobre, le régent lui accorda, à Boulogne-sur-Mer, de nouvelles lettres qui lui conféraient l'ordre de chevalerie, à lui et à sa postérité mâle,
par ordre de primogéniture [6]. Depuis son anoblissement il se
qualifiait chevalier, seigneur de Dompierre en Aunis.
On
ne trouve pas le nom de Jean Chaudrier sur la liste des habitants qui prêtèrent
serment au prince de Galles, le
6 décembre 1360, lors de la remise de cette ville au commissaire anglais,
Bertrand de Montferrand [suite au traité de Brétigny].
Il
était sans doute encore absent à ce moment. Ses sentiments patriotiques du
reste ne se démentirent pas, comme on le voit ici, et s'il revint habiter son
pays sous la domination anglaise, ce fut avec l'intention bien arrêtée de
saisir toutes les occasions de servir la cause française.
Dans
la liste des hommages rendus à la Rochelle, en 1364, au prince de Galles, il
figure, sous le nom de Jean Chaudéray, pour son château de Dumol en Saintonge
(Dès cette époque les noms français sont souvent altérés dans les documents
anglais).
Ce
fut grâce à un stratagème qu'il imagina de concert avec le maire de la ville,
Pierre Boudré, que la Rochelle fut reprise de vive force sur les Anglais, le 8
septembre 1372, par ses propres habitants qu'ils avaient fait armer, feignant
d'en avoir reçu l'ordre directement du roi d'Angleterre, dans le but de les opposer
à l'armée de Du Guesclin [7].
Chaudrier
avait su que le gouverneur était sorti du château avec une partie de la
garnison, en laissant la garde à son lieutenant [Philip Mansel], homme brave,
mais peu malicieux. Il avait songé à tirer parti de la simplicité de l’Anglais.
Sur son conseil, le maire feint d’avoir reçu du roi d’Angleterre des dépêches
importantes ; il se hâte de faire prévenir le lieutenant que c’est chez
lui, le verre à la main, qu’il les ouvrira. Joyeux compagnon, celui-ci se hâte
d’aller au rendez-vous. On dine, l’Anglais s’échauffe, grâce à d’assez
fréquentes libations. On l’engage à lire, mais il l’ignore, ainsi que ceux qui
l’ont accompagné. Le maire en donne lecture. Cette missive [au sceau du roi
d’Angleterre] ordonne une grande revue. Pressé de se rendre aux ordres de son
souverain dès le lendemain, le lieutenant fait sortir sa garnison. Mais les
douze cents bourgeois se tenant embusqués, ils s’élancent et bientôt sont maîtres
du fort et des quelques soldats qu’on y avait laissés. La ville était libre et
elle était à jamais française [8].
Froissart
a immortalisé le stratagème audacieux, mais le chroniqueur, qui probablement ne
savait pas que la Rochelle changeait de maire tous les ans, l’a désigné comme
maire dans un temps où il ne l’était plus.
Ce
fut Jean Chaudrier qui dut recevoir les troupes que Robert Knowles amenait au
secours du prince Noir et faire fête à leur chef ; mais il n’était plus
maire lorsque la flotte du comte de Pembrock fut vaincue, devant la Rochelle,
par la flotte de Henri de Castille. C’est au maire Chaudrier que le sénéchal
Jean de Harpedane s’adressa en 1371 pour le presser d’envoyer les siens au
secours de Pembrock, pendant cette lutte acharnée qui dura deux jours. Il s’y
refusa obstinément, répondant que ce n’était pas l’affaire des Rochelais que de
combattre, surtout sur mer et surtout contre des navires aussi forts que ceux
des espagnols et qu’ils avaient bien assez de garder leur ville.
Dans
l'inventaires des pièces qui étaient conservées aux archives de la commune, on
en trouve une qui mentionne, sous la date de 1375 [9], un prêt de cinq mille livres d'or fait
par Chaudrier au connétable Duguesclin, pour le paiement de ses troupes
occupées au siège de Cognac. Le prêt fut remboursé plus de vingt ans après la
mort des deux contractants.
Le
10 juillet 1376, Jean Chaudrier, chevalier, alors gouverneur de la
Rochelle, et son lieutenant Jean Maignen, étaient en procès au Parlement de
Paris contre le grand prieur d'Aquitaine et le commandeur de Bourgneuf, au
sujet du marché créé dans la ville de Dompierre, dont il lui est fait don par
les lettres que nous publions ici [10].
Ce
marché avait été institué par lettres patentes de mai 1375 [11]. Notre personnage était encore ajourné,
le 23juillet 1378, au Parlement avec Pierre Joubert et un autre, par le sire de
Parthenay, appelant d'une sentence rendue sur incident par le gouverneur de la
Rochelle. La cour annula l'appel
et renvoya les parties devant ledit gouverneur, pour juger au principal[12].
Jean
Chaudrier avait épousé, comme
on le voit dans la seconde partie des présentes lettres, Jeanne Larchevêque, alors défunte.
Elle.était
fille de Guy Larchevêque, sire de Taillebourg et avait laissé à son mari cinq
enfants mineurs : Hélie, Louis, Jeanne,
Catherine et Marguerite.
Le 14 octobre 1369,
était mort sans enfants Guyard de Thouars, dont les biens devaient revenir à
part égale à ses trois cousins germains, Louis vicomte de Thouars, Jean
de
Thouars et Guy de
Taillebourg. La part de ce dernier fut retenue indûment par le vicomte de
Thouars et par sa fille Pernelle. Ainsi lésé dans les intérêts de sa femme et
de ses enfants, Chaudrier intenta un procès à l'héritière de Thouars et à son
mari devant la juridiction anglaise. Un mandement d'Édouard III à Thomas de Felton,
sénéchal de Guyenne, du 18 février 1372, lui ordonnant de juger le
procès de Jean Chaudrier contre Amaury de Craon, vicomte de Thouars, au
sujet de la succession de Guy de Thouars, seigneur de Mauléon, a été publié
dans le tome II, p. 289, des Archives
historiques du Poitou.
Puis,
après le retour du Poitou à la couronne de France, le Parlement fut saisi de
cette contestation. Dès le mardi 24 mai 1373, la cause était appelée devant la cour.
Le vicomte de Thouars opposa alors à Chaudrier des lettres d'état qu'il avait
obtenues en faisant valoir que « les guerres et forteresses d'esnemis estoient
encores en sa terre, en quoy il li convenoit estre grandement occupé. » Le 22
juin, la cour renvoya l'affaire aux jours de Poitou du prochain Parlement. Elle
ne fut plaidée que le 22 juin 1377. Pernelle de Thouars était alors remariée à
Tristan Rouaut. Chaudrier exposa « sa demande et généalogie et conclut que les
mariez soient condamnez et contrains à lui bailler et delivrer la tierce partie
des terres de feu messire Guyard avec les fruiz qui en ont esté levés. » La
cour commit Jean Oujart et Jean de Folleville pour faire une enquête, le 23
décembre 1378, et ce fut seulement le 3 août 1381 que l'arrêt définitif fut
rendu, condamnant le vicomte et la vicomtesse de Thouars à restituer les biens
de ladite succession et les revenus qu'ils en avaient perçus indûment depuis le
14 octobre 1369 [13].
Jean
Chaudrier était mort au commencement de l'année précédente, et ses enfants
encore mineurs étaient alors sous la tutelle de Jean du Puys ou du Poys, bourgeois
de la Rochelle.
Il
avait donné son nom à la rue où se trouvait sa maison, qu’il avait réunie à l’hôtel
de Baillac et que l’on croit avoir été remplacée par la Maison de Henri II.
En
1380, il avait perdu contre Raimond de Mareuil un procès relatif à la terre que
le sire de Faye avait possédé à Dompierre en Aunis et qui avait été donnée à
tous deux par don royal. Les choses s’arrangèrent sous une forme ou une autre,
car son fils aîné, Hélie, est qualifié sieur de Dompierre dans un acte de 1392.

Château de Nieul-lès-Saintes
Ce château fort fut construit à la fin
du XIVème siècle, vers 1370, par Jean CHAUDRIER,
époux de Jeanne de PARTHENAY-L'ARCHEVEQUE,
héritière de la terre de Nieul.
Sources :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Recueil des documents concernant le
Poitou contenus dans les registres de la Chancellerie de France, publiés dans
les Archives historiques du Poitou - 1888 (19)
Article de L. Delayant paru dans la
Revue de l’Aunis – 1863 (1)
Lien
de parenté : --------------------------------------------------------------------------------------------
Père de Louis, père de Jean, père de
Jeanne, mère de Jacques JOUSSEAUME, père de René, père de Jeanne, mère de
Jacqueline GILLIER, mère de René LEVESQUE, mère de Jeanne de HAUTEMER,
mère de Claude d’ETAMPES, mère de Michel-Clériade du FAUR de PIBRAC, père de Marguerite, mère de Bénigne BERBIS de RANCY, mère de Marie CHIFFLET d’ORCHAMPS, mère de Victoire BOQUET de COURBOUZON, mère d’Adèle LE BAS de GIRANGY, mère
de Marie-Eugénie GARNIER de FALLETANS,
mère de Maurice O’MAHONY.