|
Fiche N° 0050 |
Auteur D. Barbier |
23/10/2008 |
||
|
LE CID |
Ascendant ¤ Allié ¡ |
|||
Gouverneur de Valence, il épouse
Chimène le 12 juillet 1074
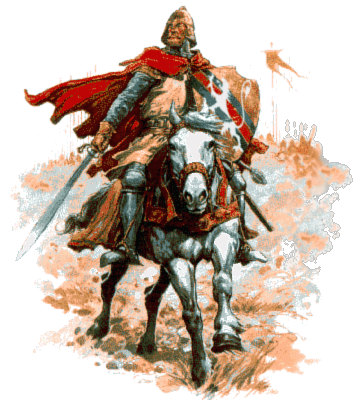
C’est peu dire que la vie du Cid tient de la légende : depuis le XIIe
siècle, avec El Cantar de moi Cid, jusqu’à Pierre Corneille, Rodrigo de Diaz de
Bivar est apparu comme l’idéal chevaleresque, le pourfendeur des Arabes, le
champion de la "Reconquista".
Mais si c’est bien à force de combats, de victoires que Rodrigo de Diaz
a acquis son surnom du Cid –de l’arabe « sidi » qui signifie seigneur- et de
Campeador, « le champion », c’est également en se mettant au service du plus
offrant qu’il a fait sa fortune. Eh oui, le Cid, celui qui ne transigeait pas
avec l’honneur, le héros de Corneille n’était rien d’autre qu’un mercenaire. Un
mercenaire doué, certes, mais un mercenaire tout de même.
De Sanche II de Castille à Alphonse VI, deux frères ennemis qu’il servira
tour à tour ; des Espagnols aux Almoravides ; des chrétiens aux musulmans : le
Cid mettra son épée au service de tous les camps, de tous les partis, sans
distinction aucune, l’offre la plus alléchante l’emportant toujours. Un talent
militaire qu’il monnayait sans pour autant vendre sa loyauté… laquelle n’était
qu’au service de ses propres ambitions. C’est ainsi qu’il s’empara de Valence,
après l’avoir acquise de haute lutte pour le compte de l’émir de Taïfa, et
qu’il s’en proclama roi. Rien à voir, donc, avec la légende qui fera sa
réputation.
Pourtant, on aurait tort de ne voir en lui qu’un traître à l’Espagne.
Certes, la péninsule était alors en pleine Reconquista, mais une reconquête où
chaque petit souverain, où chaque nobliau jouait sa partie, indépendamment de
toutes considérations idéalistes. L’Espagne catholique était encore loin d’être
unifiée, raison pour laquelle la reconquête prit tant d’années. On est loin du
« choc des civilisations » que l’on connaîtra à Lépante, par exemple. De fait,
le Cid n’agira pas autrement que les seigneurs français ou anglais dans les
luttes de souverains, le mot « nation » n’ayant alors pas la moindre
signification.
Toujours est-il que l’histoire oublia bien vite les errements du Cid, ne
retenant que son courage et son habileté guerrière. Devenu une véritable
légende, Rodrigue et Chimène, son épouse, seront enterrés au cœur de la
cathédrale de Burgos où leur tombeau fait, encore, l’objet d’une véritable
dévotion.
Le Cid Campeador (le « seigneur qui
gagne les batailles ») est le surnom sous lequel s'est immortalisé Rodrigo
Diaz de Bivar. Il appartient à l'histoire, mais la légende très tôt s'en est emparée.
Confronter la geste épique aux documents
qui nous restent sur son héros, en comparer les différentes versions, suivre sa
postérité dans la littérature des temps modernes, tel est le vaste champ qui
s'ouvre à l'érudit ou au lecteur curieux. Par-delà le personnage de Corneille,
c'est le modèle, bien plus, c'est le type éternel qu'il faut rechercher.
Le personnage historique Rodrigo Diaz
naquit en 1043 à Bivar, un village près de Burgos dont son père était le
seigneur.
A 15 ans, il
a déjà combattu plusieurs fois aux côtés de son père, lorsque celui-ci meurt
brutalement.
À vingt ans, il prend part à la bataille
de Graus (1063) où Fernando 1er, roi de Castille et de León, son suzerain,
vainc Ramire 1er, roi d'Aragon.
En 1065, à la
mort du roi Fernando 1er, il devient l'Alférez (porte étendard) du jeune roi Sanche II. A ce titre,
pour l'honneur de la Castille et au nom de Dieu, il affronte en combat
singulier le redoutable gouverneur de Navarre.
Il le désarçonne d'un coup sur le heaume, et lui coupe le chef. Vainqueur
incontesté, il est appelé dès lors "Campéador" (excellent) par les Espagnols, "Mio Cid" par les
musulmans qui le redoutent et l'admirent, persuadés qu'Allah leur a envoyé un
tel fléau pour éprouver leur foi attiédie
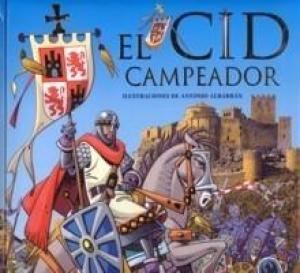
Le jeune roi de Castille Sanche II
lui confie alors le commandement de ses troupes, qui écrasent celles
d'Alphonse VI, son frère cadet, roi de León. Il a vingt-deux ans.
Sanche le
Castillan est un chef de guerre dont l’armée est agressive, insoucieuse des
intérêts de la communauté au contraire d’Alphonse le Léonais qui se veut
exploiter “raisonnablement” les vassaux de ses terres, dont la prospérité lui
importe. Alphonse perd sa couronne, est exilé à Tolède auprès du roi musulman,
et Sanche règne en Castille et en León, sauf à Zamora où domine leur sœur
Urraca. Sanche, avec Rodrigo Diaz de Bivar, assiège Zamora. Il est assassiné en
1072.
Le roi Alphonse
VI revient et prend les deux couronnes pour n’en former plus qu’une (Castilla y
Leon) et charge Rodrigo de recouvrer pour lui les parias (tribut) dues par le
roi de Séville. En récompense il lui donne en mariage sa nièce Ximena (Chimène),
fille du comte d’Oviedo.
Mais Rodrigo
exige de lui le serment de Sainte-Agathe par quoi Alphonse assure la troupe
castillane de sa totale innocence. De cette exigence nait l’inimitié qui va
opposer Alphonse, devenu empereur de
toutes les Espagnes, au vassal et maître d’armes, le Campeador. L'incursion
des Maures sur le château de Gormaz incite Rodrigo à intervenir de sa propre
initiative.
Le roi
furieux lui retire sa protection et le bannit de ses terres. Avec quelques
vassaux et compagnons, il forme une troupe, dont il monnaie les services auprès
du roi musulman de Saragosse, alors harcelé par les troupes du roi d’Aragon et
du comte de Barcelone.
L’intolérance
religieuse, les ambitions territoriales et les exigences financières d’Alphonse
rendaient la situation intenable aux princes espagnols musulmans qui tenaient
le sud et l’est du pays. Ils font appel aux Almoravides, venus des confins
sahariens du Maroc. Alphonse est vaincu en 1086 à Sagrajas.
Le Cid
parvient à rétablir l’autorité de l’empereur dans la région de Valence et
participe, avec ostentation, à une campagne royale sous les murs de Grenade. Le
roi, jaloux, le bannit à nouveau.
En
1094 Rodrigo parvient à s’emparer du royaume de Valence alors sous la
domination musulmane. Il en restera le gouverneur jusqu’à sa mort, en 1099. Le
royaume résistera contre les Almoravides
jusqu’en 1102, puis retombera sous la domination maure. Rodrigo étend ses
conquêtes, installe la religion chrétienne au cœur de la ville.
Il marie ses
filles, l’une dans la maison royale de Navarre, l’autre dans la maison comtale
de Catalogne.
Jamais
vaincu, une fois blessé, il meurt tranquillement dans son lit le dimanche 10
Juillet 1099.
Chimène tient
la ville jusqu’en 1102. Les Castillans, abandonnés à eux-mêmes, succombent
enfin aux assauts des Africains. Quand ils se retirent, ils emportent avec eux
le cadavre du Cid. Le Cid et Chimène reposent au sein de la cathédrale de
Burgos.


Monastère de San Pedro de Cardeña
(Burgos)
Fréquemment séparés
dans la vie, Chimène et Rodrigue reposent ensemble pour l'Eternité. Cependant,
au fil des neuf siècles écoulés depuis leur trépas, leurs tombeaux respectifs
ont souvent changé de place. Chimène a d'abord rejoint son époux dans une niche
pratiquée sur le côté droit du grand autel du monastère de San Pedro de
Cardeña, les cercueils contenant les corps embaumés étant encadrés de chaque
côté par un écusson et un étendard.
La promesse faite par
Alphonse VI à sa cousine de tombeaux plus dignes pour elle et son époux ne
s'est réalisée qu'en 1272, sous le règne d'Alphonse X le Sage, date à laquelle
Chimène et Rodrigue ont quitté leur niche pour un emplacement proche du Grand
Autel, côté Evangile. Mais alors que le Cid a droit à un tombeau de pierre, et
que des vers composés par le Campeador à sa propre gloire y sont gravés,
Chimène repose dans une sépulture en bois située plus bas que celle de son
mari, et celle qui a assumé seule le gouvernement de Valence ne bénéficie
d'aucune épitaphe en son honneur !
Ingratitude à l'égard
d'une femme dont on espère que la pourriture exercera son oeuvre implacable sur
le corps et le cercueil ? Mais le temps a oublié, semble t'il de jouer son
rôle d'anéantissement , et la main de l'homme n'a pas réussi à séparer les deux
époux. En 1447, suite à la destruction de la vieille église romane, les deux
corps sont transférés en face de la sacristie, celui de Chimène étant placé
plus bas que celui du Cid. Il faut attendre le règne de Charles Quint, pour que
l'Empereur rende justice à Chimène, dont la tombe est réunie à celle de son
époux en 1541 au milieu de la Chapelle centrale.
Le Siècle des Lumières
reconnaît au Cid et à son épouse des mérites équivalents, puisque en 1735,
leurs tombeaux rejoignent une chapelle, dédiée nominalement à Rodrigue, et
implicitement à Chimène. L'ensemble architectural est grandiose, conformément à
l'esthétique baroque. Une inscription laudative réunit les deux époux :
"Comment, même les meilleurs, sont tombés au cours de la bataille".
26 écussons rendent hommage à des membres de la famille et de la mesnie du Cid,
dont les ossements sont inhumés dans cette chapelle. Parmi eux figurent les
ascendants et descendants du couple, et leurs collatéraux.
Cette apothéose s'avère
malheureusement éphémère. L'invasion napoléonienne de 1808 se traduit par la
profanation des tombes et la dispersion des moines et même la mutilation de la
statue équestre du Cid, située au dessus de l'entrée du monastère. Outré par
ces déprédations, le Général Thiébault, gouverneur militaire de Castille, fait
rassembler les restes de Chimène et du Cid pour les transporter solennellement à
Burgos, où les accueille un tombeau provisoire situé sur la Promenade bien
connue de l'Espolón.
Lors de la période de
la Restauration, les Religieux réintègrent le monastère de Cardeña et
revendiquent la récupération des ossements de Chimène et de son époux, qui
rejoignent leur lieu d'origine en 1826. Mais La modification du cours des
événements entraîne un nouveau voyage des restes de Rodrigue et de Chimène.
L'abolition des droits de Main Morte, pour les nobles comme pour les clercs,
permet à la ville de Burgos de récupérer les sépultures du Cid et de son épouse
en 1842. Après avoir été conservés dans une petite chapelle de l'Hôtel de Ville
de Burgos, leurs ossements sont transférés dans la cathédrale lors de la
période franquiste, où ils reposent encore aujourd'hui. Mais le public garde la
nostalgie de la sépulture conventuelle, et préfère aller admirer les
sarcophages vides mais plus évocateurs de la Chapelle de San Pedro de Cardeña ,
où sont associés, à travers une inscription qui a défié les siècles, les noms
des parentèles du Cid et de Chimène. La postérité de Rodrigue Díaz de Bivar et
de son épouse est immense, et leur rôle dans l'Histoire et la Littérature tout
aussi capital. (Chimène après Chimène, de Marie-France Schmidt)

Vivant Denon remettant
dans leurs tombeaux les restes du Cid et de Chimène
Adolphe Roehn – Musée
du Louvre
La scène se
déroule dans une chapelle du monastère du San Pedro de Cardena, près de Burgos,
abritant un tombeau dont la face visible comporte une inscription : D. JIMENA
DIAZ, MUGER DEL CID, NIETA DEL REY D. ALONSO, EL. V. DE LEON. (Dame Ximena
Diaz, femme du Cid, nièce du roi de Léon, le seigneur Alonso, cinquième de ce
nom). Penché sur le sarcophage ouvert, Vivant Denon s'apprête à y déposer un
crâne. Son compagnon de voyage, le peintre strasbourgeois Benjamin Zix,
agenouillé derrière lui, tend une poignée d'ossements Le tableau de Roehn déforme la réalité
historique. En effet, lorsque Denon séjourna en Espagne en compagnie de Zix, au
cours de l'hiver 1808-1809, les restes du Cid et de Chimène ne se trouvaient
plus à San Pedro de Cardena La sépulture venait d'être violée par des soldats
français et le général Thiébault avait fait édifier à Burgos même un nouveau
tombeau. On y avait déposé les illustres ossements, dont seul Denon put
recueillir quelques fragments, qu'il conserva avec des reliques d'autres héros
de l'Histoire auxquels il portait un grand intérêt
Les
mariages de leurs filles Cristina et María avec les héritiers de Navarre et de
Catalogne constituent les noyaux d'illustres lignées. De l'union de Cristina,
l'aînée, avec l'Infant de Navarre Ramiro Sánchez naissent un fils, García
Ramírez puis une fille Elvira. Après avoir assumé des fonctions de gouverneur
dans des forteresses de son pays, Ramiro Sánchez succède en 1134 à Alphonse Ier
le Batailleur sur le trône de Navarre. Le petit fils du Cid, García Ramírez,
épouse en premières noces Marguerite du Perchais [de l’Aigle] qui lui donne un
fils, le futur Sanche VI de Navarre et deux filles, Blanche et Marguerite. Blanche
de Navarre contracte mariage avec le roi de Castille Sanche III et donne le
jour au futur Alphonse VIII. Deux royaumes de la Péninsule sont donc détenus
par des descendants du Cid et de Chimène dés la fin du XIIème Siècle. Ceux-ci
continuent à essaimer dans les familles royales de France, Portugal, Léon et
Aragon. En effet Blanche de Castille, une des filles d'Alphonse VIII, épouse
Louis VIII de France et donne naissance au futur Saint Louis. Sa sœur,
Bérengère devient reine de Léon par son union avec Alphonse IX. Quant à
l'Infante Urraca, elle épouse le souverain de Portugal Alphonse II. Enfin, la
quatrième fille d'Alphonse VIII épouse Jacques Ier d'Aragon.

Statue du Cid à Burgos
Sources :
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Encyclopédie Universalis
-
Divers sites internet
Lien
de parenté : --------------------------------------------------------------------------------------------
Père de Christina, mère de Garcia V
Ramirez (roi de Navarre 1134-1150), père de Blanche de Navarre, mère de Alfonso
VIII (roi de Castille 1155-1214), père de Blanche (reine de France 1223-1226),
mère de Saint-Louis (roi de France 1214-1270), père de Philippe le Hardi (roi
de France 1266-1265), père de Philippe le Bel (roi de France et de Navarre
1285-1314), père de Philippe le Long (roi de France et de Navarre 1316-1322),
père de Marguerite, mère de Louis II (comte de Flandre 1346-1384), père de
Marguerite, mère de Jean sans peur (duc de Bourgogne 1404-1419), père de
Philipotte (fille naturelle avec la dame de Gyac morte le 24 avril 1461), mère
de Jeanne de la Roche-Baron, mère de François d’Anglure, père de Jacques, père
de Catherine, mère d’Adrien de Trestondans, père de Claude, mère de
Marie-Gabrielle mère de Marie-Françoise de Poutiers, mère d’Elisabeth de
Scoraille (1702-1762), mère de Marie-Marthe Berbis de Rancy (1728-1782), mère
de Marie Chifflet d’Orchamps (1751-1807), mère de Victoire Boquet de Courbouzon
(1774-1866), mère d’Adèle Le Bas de Girangy (1796-1857), mère de Marie-Eugénie
Garnier de Falletans (1823-1906), mère de Maurice O’Mahony (1849-1920) …
