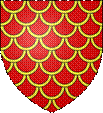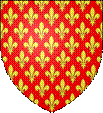|
Fiche N° 0175 |
Auteur D. Barbier |
11/02/2009 |
|
Geoffroy IV de CHÂTEAUBRIANT |
Ascendant ¤ Allié ¡ |
Chevalier croisé en
1248
|
|
Armes anciennes |
Armes accordées par Saint-Louis vers 1250 |
|
Le plus célèbre des barons de
Châteaubriant au XIIIe siècle fut sans contredit Geoffroy IV, également
baron de Candé et châtelain de Vioreau (seigneurie d’Abbaretz). Il était neveu
de Geoffroy III, fils de son frère, nommé également Geoffroy. Né en 1216,
suivant le Cartulaire de Béré, il se trouva à,
l'âge de dix-sept ans à la tête d'une des plus importantes seigneuries de
Bretagne, et il ne tarda pas à se montrer à la hauteur de sa position.
Plusieurs fois caution pour le nouveau
duc de Bretagne, Jean Ier dit le Roux, notamment à Pontoise, en 1238, et
deux ans plus tard, lorsque ce prince prêta le serment ordinaire au roi de
France, Geoffroy IV vit de bonne heure augmenter sa fortune déjà
considérable, par un héritage de la maison de La Guerche, issue des sires de
Châteaubriant. En effet, Isabeau de Châteaubriant, dite de la Guerche, fille du
fondateur de la Primaudière, avait épousé Guillaume de Thouars, seigneur de
Candé ; mais n'ayant point d'enfants, ces deux époux laissèrent à leur
cousin, le seigneur de Châteaubriant, leurs terres de Candé, le Lyon d'Angers,
Chalain et Chanseaux.
Cependant les croisades enflammaient de
nouveau les cœurs. Pierre Mauclerc, redevenu simple chevalier, de duc qu'il
avait été, était à peine de retour d'une première expédition en Palestine
(1239-1240) que le roi Saint-Louis entreprit lui-même un voyage en
Terre-Sainte. Autour de ce grand roi se pressèrent naturellement bon nombre de
gentilshommes ; et tout ce que la France contenait de plus distingué dans
la noblesse comme dans le clergé voulut prendre la croix, à l'exemple de Louis IX.
Parmi les grands vassaux de la
couronne, on remarquait Jean Ier, duc de Bretagne, et Pierre Mauclerc, son
père ; et au nombre des hauts barons bretons, on distinguait le seigneur
de Châteaubriant. Geoffroy IV s'embarqua donc avec le roi et Pierre
Mauclerc en 1248, mais le duc Jean ne put partir avec eux. On sait quel fut le
sort de cette funeste expédition d'Égypte, mais on admire encore aujourd'hui,
après six siècles écoulés, l'intrépidité que déploya l'armée française à la
Massoure. Parmi les guerriers qui s'y distinguèrent au milieu de tant de héros,
notons avec un légitime orgueil notre ancien duc Pierre Mauclerc, expiant dans
les guerres saintes les déplorables fautes de sa politique passée, et notre
baron Geoffroy IV, dont le nom demeure glorieusement attaché aux plus
beaux souvenirs des croisades.
Cependant la nouvelle de la ruine de
l'armée française à la Massoure était parvenue jusqu'en Bretagne ; on ne
tarda pas à y connaître la mort de Pierre Mauclerc et celle du baron de Vitré.
Le bruit se répandit également que Geoffroy de Châteaubriand avait succombé,
ainsi que beaucoup d'autres chevaliers croisés. Sibylle [dame de Pordic], que notre jeune seigneur avait épousée avant de
prendre la croix, revêtit alors ses vêtements de deuil et pleura son mari.
Trompée ainsi par des bruits mensongers, elle était encore dans les larmes
lorsque Geoffroy IV remit le pied en Bretagne. Tout joyeux, le brave baron
accourut vers Châteaubriant, et, dans son empressement d'embrasser une épouse
chérie « estant tout prêt de son
chasteau, il le fit savoir à sa femme. » Quelle ne fut pas alors
l'agréable surprise de Sibylle ? « Remplie d'allégresse à la nouvelle d'un événement si inattendu, »
la dame de Châteaubriant accourt au devant de Geoffroy, mais, hélas !
« à la rencontre et accollade,
ajoute naïvement du Paz, ceste bonne dame
trépassa de joie entre ses bras ; témoignage de la parfaite amitié qu'elle
portait à son seigneur, mari et époux. » Ainsi se changea subitement
en deuil le joyeux retour du baron de Châteaubriant (1250). Cette mort
extraordinaire de Sibylle est confirmée par plusieurs historiens.
Geoffroy IV avait vu par lui-même
en Orient les bienfaits qu'y répandait l'Ordre des Pères de la Sainte-Trinité,
fondé pour le rachat des captifs chrétiens, et il savait par sa propre
expérience quelle était la misère des prisonniers chez les Musulmans. Aussi, de
retour dans son château, s'empressa-t-l de fonder un monastère pour les
religieux de cet ordre. Ce fut sur le chemin qui conduit de la ville de
Châteaubriant au prieuré de Béré que le pieux croisé construisit ce nouveau
couvent. Geoffroy assigna aux Pères de la Sainte-Trinité la somme de deux cents
livres de rente sur ses forges des forêts de Juigné et de Teillay (août
1252).
La tradition rapporte que le seigneur
de Châteaubriant fit inhumer le corps de sa femme Sibylle dans l'église
conventuelle du prieuré ou hôpital de la Trinité ; il fit ensuite
représenter sur les vitraux de cette église toutes les circonstances de la mort
singulière de sa fidèle épouse ; le P. du Paz étant à Châteaubriant
en 1602 y vit encore ces verrières historiques, comme il l'affirme dans son
histoire.
Geoffroy IV épousa, quelque temps
après, Aumur ou Amaurye de Thouars, fille du vicomte de Thouars, seigneur de
Talmont et d'Agnès de Laval.
Désormais ce seigneur ne figure plus
dans l'histoire que par ses testaments. Étant un jour dans son château de
Vioreau, situé dans la forêt de ce nom, non loin de Châteaubriant, Geoffroy fit
un premier testament, à une époque indéterminée.
Mais au mois de septembre 1262, il en
fit un second, sans annuler le premier. Ce dernier testament est un des titres
les plus curieux de l'histoire du temps ; qu'on me permette donc d'en
faire l'analyse.
Le seigneur de Châteaubriant commence
par obliger ses exécuteurs testamentaires à payer ses dettes et à réparer les
dommages qu'il a pu faire à autrui ; il leur laisse à cet effet deux cents
livres de rentes sur ses forêts de Juigné et de Teillay, et mille livres à
prendre sur ses meubles et sur son bois de Vioreau, réservant toutefois une
partie de ce bois pour l'entretien de son manoir du même nom.
S'occupant ensuite de pieuses
fondations, il confirme et augmente les rentes du monastère de la
Trinité ; lui concède plusieurs beaux droits, et fonde, dans l'église de
ce prieuré, une chapellenie pour le repos de l'âme de sa première femme,
Sibylle.
Puis, il lègue de fortes sommes à
l'abbaye de Saint-Nicolas d'Angers, à la fabrique de Saint-Pierre de Rennes, à
d'autres abbayes d'Anjou, et à de nombreux couvents de dominicains. Au prieuré
de la Primaudière, il laisse 10 livres de rente sur sa terre de Chalain ;
à l'abbaye de Melleray, il assigne 21 livres de rente, afin qu'à l'avenir, les
religieux de ce monastère puissent manger du pain de froment ; à Saint-Martin
de Teillay, il laisse 50 livres de rente, et aux Templiers un cheval du même
prix de 50 livres, somme considérable à cette époque. Il nomme dom Sauvage,
prieur de Béré, l'un de ses exécuteurs testamentaires, et veut que l'église de
Notre-Dame de Châteaubriant soit achevée à ses dépens.
Geoffroy s'occupe ensuite de sa
famille. A sa femme Amaurye de Thouars il lègue 500 livres de rente pour sa
part de mobilier, outre sa dot et sa terre patrimoniale. Selon les lois du
pays, il laisse sa baronnie de Châteaubriant toute entière à son fils aîné
Geoffroy, mais il donne à ses autres enfants, d'une façon générale, ses terres
de Chalain, Candé et le Lyon d'Angers. Il fait de plus quelques donations
particulières à plusieurs d'entre eux ; ainsi son fils Brient, nommé son
exécuteur testamentaire, reçoit les revenus des deux forges de Juigné et de
Teillay et sa fille Guyote a 50 livres et deux charretées de vin.
Notre baron n'oublie point ses
vassaux : il répète encore qu'il veut qu'après sa mort justice soit faite
à tous ; si son père a causé quelques dommages, notamment dans les
paroisses de Joué et de Saint-Aubin, il ordonne qu'on les répare immédiatement. Quant aux tailles, c'est-à-dire aux impôts levés sur ses sujets,
il défend qu'on les augmente, et ordonne même qu'on les réduise, comme elles
étaient sous son prédécesseur, s'il lui est arrivé d'en augmenter
quelques-unes ; il renonce même à certains impôts qu'il prélevait dans la
paroisse de Bain, et abandonne à tous ses vassaux ses droits dits de blé sur
les cours d'eau de sa seigneurie.
Ce remarquable testament de
Geoffroy IV, scellé de dix-huit sceaux, fut spécialement confié aux soins
du grand-maître des Templiers d'Aquitaine. On voit dans cet acte tout un côté
du moyen-âge se révélant à nous. Le seigneur de Châteaubriant s'y montre, non
comme un de ces farouches tyrans rêvés par nos romanciers modernes, mais, au
contraire, comme un pieu chrétien, un bon père de famille, un seigneur soucieux
du bonheur de ses vassaux. On n'y trouve ni trace d'une dévotion pusillanime,
ni apparence d'une trop grande rigueur dans l'exercice du droit d'aînesse, ni
preuve des vexations imaginaires employées, dit-on, par les hauts barons à
l'égard de leurs sujets. Aussi cette page de l'histoire de Châteaubriant
m'a-t-elle paru si intéressante, que j'ai cru devoir la publier dans tout son
développement.
Geoffroy IV mourut peu de temps
après avoir fait son testament, le 29 mars 1263, suivant le Cartulaire de la Primaudière ; son corps fut déposé
dans l'église priorale de la Trinité, qu'il avait fondée, auprès de sa première
femme Sibylle. En 1663, on voyait encore, dans « l'enclos du balustre du maître-autel, un monument enfoncé dans le mur,
à la hauteur de quatre pieds et demy de terre, du costé de l'épistre.... ce
monument soustient la figure d'un homme, au côté duquel est un bouclier chargé
des armes de Chasteaubriant, et nous a dit un des religieux de la Trinité
présent, qu'audessous dudit monument, il y avait une cave ou charnier où repose
le corps qui est représenté par ladite figure. » Nous croyons
volontiers que le tombeau de ce chevalier inhumé près du maître-autel était
celui du fondateur de la Trinité.
Les armoiries représentées sur le
tombeau de Geoffroy IV nous amènent naturellement à parler du blason des
sires de Châteaubriant. Les premiers seigneurs de notre ville portèrent dans
leurs armes un papelloné ou plutôt des plumes de paon sans nombre, comme le témoignent les
sceaux de Geoffroy II, en 1199, et de Geoffroy III, en 1214 et en
1217, publiés par D. Morice. Le P. du Paz prétend toutefois que le
même Geoffroy III portait de gueules à des pommes de
pin sans nombre, et qu'un sceau ainsi blasonné était attaché à l'acte de
fondation de la Primaudière (1207). Il se peut que ce savant généalogiste
ait pris pour des pommes de pin le papelloné dont les bénédictins nous ont
conservé la figure dans trois sceaux différents ; il se peut aussi que
Geoffroy III ait changé de sceau, comme D. Lobineau avoue que le
faisaient parfois les seigneurs de cette époque. Quoi qu'il en soit des premières
armoiries de Châteaubriant, Geoffroy IV reçut de Saint-Louis, en
récompense de sa valeur et de sa fidélité, le plus glorieux blason. Ce roi lui
accorda, ainsi qu'à ses descendants, la permission de porter les armes royales
de France, les fleurs de lys alors sans nombre,
sauf le champ qu'il fit de
gueules. Et faisant allusion à cette couleur rouge qui, dans le fond de
l'écusson, remplaçait l'azur du blason royal, les seigneurs de Châteaubriant
prirent pour devise cette magnifique parole : « notre sang teint les bannières de France, »
constant témoignage de la reconnaissance et du dévouement de nos barons à
l'égard de leurs rois.
Joinville raconte que lors de la
bataille de Mansourah en 1250, Chotard [très vraisemblablement Geoffroy] sauva
le roi Saint-Louis et rependit son sang sur les armes du monarque qui, pour
l’en remercier l’autorisa à transformer ses armes comme nous l’avons vu.
Geoffroy IV avait eu six enfants
de ses deux mariages, sans que nous sachions de quel lit sortît chacun d'eux,
sauf l'aîné qui naquit certainement de Sibylle. Ces enfants étaient :
1° Geoffroy V, qui lui succéda ; - 2° Brient,
chevalier, mentionné dans le testament de son père ; - 3° Jean,
chevalier, qui vivait en 1286 ; - 4° Sibylle, mariée à Maurice
de Belleville, seigneur de la Garnache et de Montaigu ;
- 5° Marquise ou Marguerite[1], épouse d’Yvon de la
Jaille, dont nous descendons ; - 6° Enfin, Guyote dont on ignore
l'alliance probablement peu fortunée, comme l'insinue le testament de
Geoffroy IV, qui ordonne à cette dame de rejoindre son mari.
La veuve du baron de Châteaubriant,
Amaurye de Thouars, se remaria avec un chevalier nommé Olivier de l'Isle, et
Geoffroy V ajouta à son douaire, en 1266, cent livres de rente quil avait
coutume de prendre « en la borse de monseigneur le roy de Sicile »,
et trente livres de rente sur « sa châtellenie de la Flèche. »

Le château fut édifié en 1015 par
Briant, qui donna son nom à la ville de Châteaubriant.
Jean de Laval,
devenu gouverneur de Bretagne en 1531, modifia le château médiéval et ajouta un
bâtiment renaissance, le « bâtiment des gardes. »
L’ensemble, acquis
par le Conseil général de Loire-Atlantique en 1853, deviendra cité
administrative.
Sources principales : ===========================================
Site
d’Amaury de la Pinsonnais
Lien de parenté :
=============================================
|
Geoffroy IV de Châteaubriant Geoffroy V de Châteaubriant Jean de Châteaubriant Geoffroy Brideau de Châteaubriant Marguerite de Châteaubriant Guillemette Foucher Etienne d’Escoubleau Jean d’Escoubleau François d’Escoubleau Catherine d’Escoubleau Isabelle de Clermont Françoise de Beauvau Jean-Armand de Vouer de Paulmy Céleste de Voyer de Paulmy Agathe de la Rivière Yvonnette de Rivié de Riquebourg Monique de Gouy d’Arsy Arsène O’Mahony Maurice O’Mahony Yvonne O’Mahony Monique Bougrain Dominique Barbier |
|