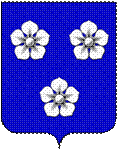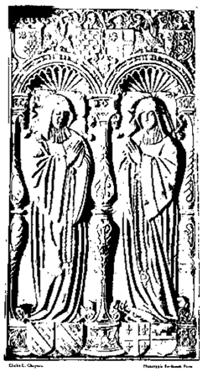|
Fiche N° 0141 |
Auteur D. Barbier |
9/12/2008 |
||
|
Antoine de BAISSEY |
Ascendant ¤ Allié ¡ |
|||
Conseiller et chambellan du Roi,
fait bailli de Dijon en 1477
« nostre amé et
féal Conseillier et chambellan le bailli de Dijon »
|
A |
la voûte d’une salle haute, dans un bâtiment
du XVe siècle, seul vestige de l’ancien et important château de Til-Chatel [1],
canton d’Is-sur-Till, Côte-d’Or, se voient encore les armes de cette famille
ancienne et considérable qui a donné un archevêque de Besançon, et un des abbés
généraux de Citeaux. Les archives de la Côte-d’Or possèdent de nombreux
documents sur cette famille bourguignonne, originaire de Hollande. Guillaume,
fils d’Hosterdam, vint s’établir en Bourgogne et reprit en 1229 le fief de
Bessey-les-Citeaux dont il prit le nom. Les membres de cette famille remplirent
d’importantes fonctions sous les ducs de Bourgogne et le plus illustre fut
Antoine.
Antoine de Baissey, baron de Til-Châtel,
seigneur de Longecourt, de Brazey, de Chaume, de Précy-le-Grand et de
Saint-Jean-de-Losne, comte d’Arena et de Stilo en Calabre, avait d’abord été écuyer
de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne.
Fils de Jean, tué à la bataille de Morat
le 22 juin 1476, il oublia le sang paternel versé pour la cause de ce prince,
et s’attacha corps et âme à Louis XI qui le combla de richesses et d’honneurs,
le faisant son conseiller et son chambellan et, le 28 juillet 1477 [2] le nommant bailli de Dijon. C’est sous
ce titre qu’Antoine de Baissey est nommé dans la plupart des récits de
l’époque.
Capitaine d’une compagnie de gendarmerie
des ordonnances, il fut également colonel des Suisses et lansquenets.
Parlant couramment allemand, il fut
envoyé plusieurs fois en ambassade en Suisse. Il connaissait bien ce pays et débaucheur d’hommes, redoutable et sans
scrupules, il enrôla des Suisses, à plusieurs occasions dès 1495. C’est à
la tête de ses 20.000 Suisses qu’il servit Charles VIII dans l’expédition de
Naples et prit part à la bataille de Fornoue. Il fut nommé à
diverses reprises ambassadeur extraordinaire auprès des Ligues helvétiques, et
on lui doit le traité de Lyon, conclu avec les Valaisans, en 1500.
Vers 1480 [3]
L’affaire du mariage
d’Antoine de Baissey
Antoine de
Baissey était un homme plein d'énergie. Son mariage avait été arrêté en 1475 au
siège de Nuz [4], en
Allemagne, où il servait Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, en qualité de
capitaine des Écoutes. Sa fiancée, Ide, fille de Guillaume de Saint-Seine,
n'avait que dix ans ; elle perdit son père, et fut alors confiée à la tutelle
d'un de ses parents, le sire de Dammartin. Mais, au moment où il se disposait à
accomplir les dernières volontés de Guillaume, en donnant à Antoine de Baissey
la jeune fille qui lui avait été promise, Girard de Roussillon, seigneur de
Clomot, près d'Arnay-le- Duc, l'enleva et la maria clandestinement à Simon de
Quingey. Le tuteur veut un procès. Antoine de Baissey, seigneur de Longecour,
devenu bailli de Dijon, déclare qu'il n'épousera pas une fille déshonorée. Il
assemble des seigneurs, entre autres Rothlein et Baudricourt, et dit en leur
présence au sire de Roussillon qu'il le tient pour un lâche ; et il lui jette
son gant. Girard de Roussillon ne le relève pas : « Lâche! répète le bailli, tu
recules ; mais je te poursuivrai partout, car tu as carognement besogné.
Et tu te vantes de t'être battu avec la hache ! Félon, tu en as menti ! » Girard
se retire, prend quinze hommes, épie son ennemi et l'attaque près
d'Arnay-le-Duc. Le bailli tire l'épée et la brise dans la lutte. Son adversaire
se jette sur lui avec plus de rage ; mais Antoine prend son poignard, tue
Roussillon, quitte Arnay et court au Mesnil se mettre sous la protection de
Louis XL « Tu t'es virilement défendu, lui dit le Roi ; je te prends sous ma
garde. »
Quelque temps
après, Baudricourt, le gouverneur de Bourgogne, donna sa nièce en mariage au
bailli de Dijon ; elle s'appelait Jeanne de Lenoncourt. Ce Dijonnais, seigneur
de Longecour, chambellan et conseiller, favori de Louis XI, premier bailli de
la province, neveu du gouverneur, était donc un homme considérable, qui portait
l'épée haute et qui avait une grande influence. Anne de Beaujeu, régente du
royaume, ne le négligea pas : « Pour
plusieurs grands et recommandables services qu'il a faictz à nostre feu
seigneur, dit-elle, pour ceux qu'il nous faitz à présent, et que espérons que
plus face cy après, nous voulons qu'il joysse, malgré l'édit, de la seigneurie
de Faucogney. »
1483
La compagnie Antoine de
Baissey
Une trêve de dix-huit
mois ayant été conclue le 28 mai 1444 avec les Anglais, Charles VII profita de
ce répit pour réorganiser son armée. Il conçut le projet de réduire sa
cavalerie à quinze compagnies ayant à leur tête autant de capitaines et
entretenues en temps de paix comme en temps de guerre, et de congédier tout le
reste. Chaque compagnie se composait de cent lances garnies ; chaque lance
garnie comprenait six personnes : un homme d’armes avec trois chevaux, un
page et un coutilier, deux archers avec trois chevaux et un varlet, soit 600
hommes par compagnie. Outre le capitaine, il y avait sous ses ordres dans
chaque compagnie, un lieutenant qui commandait en l’absence du capitaine, un
guidon, un enseigne et un maréchal des logis.
Le 18 mai 1483 Antoine
de Baissey fut nommé capitaine d’une compagnie de gendarmerie, qu’il conserva
jusqu’au 20 mars 1499.
1484
Tentatives de Maximilien
d’Autriche pour soulever la Bourgogne après le traité d’Arras
Le traité d’Arras fut conclu en 1482.
Il donnait la Bourgogne et la Picardie à la France, l’empereur Maximilien
conservant les Pays-Bas. Beaune, Auxonne et Dijon, où Louis XI avait construit
des forteresses, étaient au pouvoir d'hommes expérimentés (...) Dijon n'avait
rien à craindre ; Guillaume de Mailloche commandait dans la nouvelle forteresse
et ne négligeait rien pour l'agrandir et l'armer. D'ailleurs, le bailli de
cette ville, Antoine de Baissey, n'avait-il pas toutes ses racines en France,
peut-être même avant la chute de Charles-le-Hardi ? Louis XI avait bien
récompensé ses services ; et sa fille [Anne de Beaujeu, régente] était plus
disposée à augmenter qu'à diminuer les avantages qu'il en avait reçus. Cet
homme d'action, qui avait pour lieutenant son frère Jean de Baissey, gruier et
grand louvetier de Bourgogne, devait servir le nouveau régime avec fidélité, Il
avait épousé la nièce de Baudricourt, gouverneur de la province; il avait en
Bourgogne de vastes seigneuries ; la question du meurtre de Girard de
Roussillon, qu'il avait tué près d'Arnay, était encore pendante : la veuve et
la fille en appelaient sans cesse à la justice du roi. Le bailli était donc
attaché par trop de liens à la cause française pour sacrifier le présent, qui
était pour lui sûr et beau, à des chimères qui pouvaient aboutir, sinon à la
mort, à un dépouillement et à des humiliations (...) Le 30 décembre 1484, on
apprit au Conseil royal, disent ses procès-verbaux, que de grandes entreprises
avaient été faites en Bourgogne contre le roi ; qu'on avait voulu suborner les
gens du pays, les retirer de l'obéissance due au roi de France, pour les
soumettre au duc d'Autriche ; que Baudricourt, Antoine de Baissey et le maieur
de Dijon avaient besongné vertueusement; que le procès des coupables
était instruit …
1488
Bataille de Saint-Aubin
entre le roi de France et le duc de Bretagne et ses alliés
Les
deux armées avaient pris
position devant Saint-Aubin-du-Cormier, que les Bretons voulaient
prendre et les Français garder. Ceux-ci formaient une masse compacte,
sous la main d'un homme habile, La Trémouille, devant lequel le duc d'Orléans
avait une fois déjà posé les armes. L'armée ennemie [bretonne] était
composée d'éléments hétérogènes, d'Espagnols, d’Allemands, d'Anglais,
des compagnies de Bretagne et des réfugiés français. Les premiers
étaient environ 35.000, et peut être avaient-ils l'hésitation d'émigrés
qui marchent contre leur pays. L'armée de France n'était pas plus nombreuse,
mais elle était plus forte en cavalerie et surtout plus résolue. Son
chef avait la fougue de la jeunesse et des traditions de famille qui
l'obligeaient. Le gouverneur de la Bourgogne, Jean de Baudricourt, était
au centre, avec l'expérience d'un vieux capitaine et un dévouement
sans bornes. En tète se trouvait Antoine de Baissey, ce fier bailli qui
avait tué Girard de Roussillon et été en Bourgogne l'un des plus
solides instruments de Louis XI. L'avant-garde ne pouvait pas avoir un
homme plus ferme et commandant de meilleurs soldats : c'étaient des
Suisses qu'il était allé chercher lui-même dans leurs montagnes.
L'action
s'engagea le 28 juillet 1488. Le duc d'Orléans, le prince d'Orange et
les autres chefs émigrés, dont les Bretons n'étaient pas sûrs, s'étaient mis à
pied et aux premiers rangs pour écarter toute idée de désertion. Ils
attaquèrent avec vigueur, en se jetant sur le bailli avec le comte de Scale et
ses Anglais. Le bailli devait être écrasé sous ces masses ou mis en déroute : il
resta inébranlable ; il opposa à cette multitude son courage et ses Suisses
qu’il était allé chercher lui-même dans leurs montagnes : « Il les tint en si
bon ordre de bataille, dit son secrétaire, et combattit si virilement avec eux,
qu'il soutint sans branler cet assaut, » et donna le temps au condottiere
Galeotto de se jeter sur le flanc des Bretons avec 500 hommes d'armes, 400
chevaux et les 2.000 arbalétriers. Il y perdit la vie; mais l'armée ennemie fut
ouverte et coupée en deux. « En avant! » s'écria en même temps le bailli de
Dijon, Il y eut alors un effroyable carnage au milieu des Bretons, placés entre
deux feux, frappés en tète par de Baissey, par Galeotto en queue, Il y eut
là 1.400 hommes pris ou massacrés. Le reste de l'armée ennemie tourna le dos; la
gendarmerie française se mit à sa poursuite, « et, dit le secrétaire,
partie les saccagea et mit à perdition. » Les Français eurent 1.500 hommes tués
dans cette rencontre; mais leurs adversaires en laissèrent 4.500 sur le champ
de bataille.
On le
voit, cette brillante affaire, dont les historiens nous ont laissé dos récits
confus, est d'une extrême simplicité ; la gloire en revient presque tout
entière à l'avant-garde : ni le centre ni l'arrière-garde n'y prirent part.
Aussi,
le secrétaire du bailli de Dijon nous révèle-t-il un fait jusqu'ici inconnu
: ce fut lui, Antoine de Baissey, qui fit prisonniers et le duc d'Orléans
qui était aux premières lignes, et le prince d'Orange qui se cachait sous des
cadavres, et le comte de Scale qui était à la tète des Anglais, et
plusieurs autres capitaines. « Il
recueillit un grand butin, ajoute le biographe, ce qui lui put être d'environ 100.000 francs de profit. »

Bataille
de Saint-Aubin du Cormier, par Paul Lehuguer, XIXe siècle
L'histoire
générale, qui ne voit guère que les sommités, a laissé dans l'ombre le bailli
de Dijon et mis en relief La Trémouille, le général en chef. Cependant Antoine
de Baissey n'avait pas seulement pris le futur roi de France, il l'avait sauvé.
Il donna cette riche proie à ses Suisses, en leur faisant promettre de ne
livrer au roi le prince rebelle et pris les armes à la main que comme
prisonnier de guerre et pour une rançon de 50,000 écus. « Par ce moyen, dit
le secrétaire, on ne put procéder à jugement contre lui, comme voulait
faire Mme de Beaujeu. » Elle pouvait le perdre : il avait fait alliance avec
les ennemis de la France et marché contre le roi. Ce service ne fut pas oublié
; il explique les faveurs signalées dont le bailli de Dijon sera l'objet sous
le règne de Louis XII ; mais Louis d'Orléans, même prisonnier de guerre et
rançonné, ne put éviter la tour de Bourges : il eut le temps d'y méditer sur
ses droits et ses devoirs.
La
Trémouille cependant profita de la victoire de Saint-Aubin : Dinan lui ouvrit
ses portes ; la garnison de Saint-Malo posa les armes et sortit avec des bâtons
à la main ; d'autres places furent soumises. Le duc de Bretagne, épouvanté,
voulait se réfugier en Angleterre; mais sou grand âge et ses infirmités
l'arrêtèrent ; il s'enferma à Nantes et demanda la paix (…) Un traité fut signé
à Sablé le 20 août, quelques jours après la bataille.
1494-1497
Expédition d’Italie par
laquelle Charles VIII veut conquérir le royaume de Naples.
A la mort du roi Ferdinand 1er,
Charles VIII se proclame Roi de Naples et de Jérusalem, et pénètre en Italie. Les
débuts du voyage furent brillants. Arrivé le 9 septembre 1494 à Asti, le roi
entendait dire que ses vaisseaux avaient été détruits et ses troupes de terre,
commandées par son cousin Louis d’Orléans, battues à Rapallo ; mais
« cela n’était pas vray ; avec
le duc d’Orléans il y avait force artillerie, et le bailli de Dijon avec ses
allemands. » Le journal officiel de cette expédition dit que Jean de
la Grange et Antoine de Baissey se signalèrent dans cette bataille qui fit « trembler toute la mer jusqu’à
Naples. »
Florence ouvrit ses portes le 17
novembre ; Charles VIII y entrait monté sur un cheval couvert de drap
d’or ; et près de lui se faisait distinguer le bailli de Dijon, à la tête
de ses Suisses. Le 31 décembre, le roi entra à Rome (…)
Charles VIII entra à Naples le 22
février 1495, mais il fallut prendre de force la citadelle; « la puissance de la grosse artillerie du
bailli d'Auxonne fut telle que tout alloit par terre en pièces et en lopins.
» Les assiégés demandèrent à parlementer; on leur envoya le comte de Nevers et
le bailli de Dijon, qui conférèrent en allemand ; quelques jours après, la
conquête du royaume de Naples était faite (…)
Le 28 juin il participe à la victoire de
Seminara.
Le 6 juillet, le vallon de Fornoue [5] était le théâtre d'une bataille
sanglante. L'ennemi avait de 20 à 30.000 hommes, au milieu desquels le roi, qui
n'en avait que 7.000, devait s'ouvrir un passage. Son armée fut divisée en
trois corps : le premier, commandé par le maréchal de Gié, se composait surtout
de l'artillerie du bailli d'Auxonne et des 3.000 Suisses du bailli de Dijon (…)
Un moment après l'artillerie se fit entendre ; le corps de bataille, où se trouvait
le bailli de Dijon à pied avec ses montagnards, fut attaqué ; mais l'action se
concentra sur l'arrière-garde (…)

Bataille de Fornoue
Avec une armée dans état de délabrement
certain, le roi arriva bientôt à Asti où il avait laissé le duc d'Orléans,
après l'affaire de Rapallo ; mais ce prince, au lieu d'attendre l'armée
de Naples, pour l'aider à passer, avait pénétré dans le Milanais et pris Novare
(…) Cependant le duc était bloqué dans Novare, et le bailli de Dijon était
allé, après la bataille de Fornoue, demander 10,000 hommes aux Suisses. Quel ne
fut pas l'étonnement, quand on en vit 20,000 descendre des Alpes, désireux de
partager la gloire de l'armée française, plus désireux sans doute de s'enrichir
des dépouilles de la Lombardie. Le duc d'Orléans aurait désiré continuer la
guerre avec ces troupes fraîches, et marcher sur Milan ; elles ne servirent
qu'à faire la paix : « La nouvelle de la descente en Lombardie d'une
véritable horde de Suisses terrifiait Ludovic et le rendait accessible à toutes
les propositions de paix. L'argent français, en effet, avait fait des miracles
au nord des Alpes, et tout ce qui pouvait porter une hallebarde avait pris la route
du Milanais : Le bailli de Dijon, Antoine de Bessey, avait si bien su distribuer
ses florins que dans les ligues on ne jurait plus que par le roi de France. Ses
partisans l'avaient baptisé den reichen Aeili, le riche compère, et
Maximilien den mageren rbmischen Kbnig, le maigre roi des Romains. »
La paix fut signée le 10 octobre 1495 à Verceil. Le même jour, Antoine de
Baissey fit la revue de ses troupes, plia bagage et repassa bientôt les Alpes.
Sans attendre d’être entré dans Naples,
Charles VIII avait nommé M. de Montpensier vice-roi de la capitale et prit les
mesures administratives pour organiser la conquête et d’abord sur le partage du
butin, charges, biens, titres, domaines, dont il convenait de dépouiller les
vaincus. Les grandes charges et les places importantes revinrent, comme il
était juste, aux chefs de l’armée ou aux conseillers qui avaient pris la
meilleure part aux opérations de la conquête. C’est ainsi qu’Antoine de
Baissey, bailli de Dijon, avait reçu le 16 mars 1495 les terres d’Arena et de
Stilo, en Calabre, avec le titre de comte, et le 17 la charge de capitaine et
châtelain de Reggio.
|
|
Tombe de Jeanne de Saulx et
Jeanne de Lenoncourt, mère et épouse d’Antoine de Baissey. Sous
cette tombe gisent les corps de nobles dames Jehanne de Saulx, en son vivant
femme de Messire Jehan de Baissey, Sr de Lenoncourt, et Jehanne de
Lenoncourt, femme de Messire Anthoine de Baissey, en son vivant Sr de
Lenoncourt et baron de Tilchastel, chambellan ordinaire du Roy notre sire et
son bailly de Dijon, lesquelles trespassèrent assr lad. de Saulx
le premier jour de mars, l’an mil quatre cent quatre vingt et dix et lad.
dame de Lenoncourt le V jour de janvier mil Ve et XXII. Dieu ait leurs âmes. Cette tombe est dans l’église paroissiale de
Longecourt, à côté de l’autel du côté de l’évangile, laquelle tombe qui est
de bas-relief en marbre blanc et l’inscription d’une pierre noire, était
autrefois élevée d’environ deux pieds de haut, est à présent à terre à cause
qu’elle empêchait d’aller au lieu où l’on retire le Saint-Sacrement. Les huit écussons sont ceux de Baissey/Saulx,
Bauffremont, Badoncourt, Chauvirey, Baissey/Lenoncour, Beauvau, Espinal,
Tour-Landry. |
Antoine de Baissey avait épousé Jeanne de Lenoncourt, fille de
Philippe, chambellan du Roi et grand écuyer de René, roi de Sicile, et nièce de
Jean de Baudricourt [6],
maréchal de France (1486), gouverneur de Bourgogne et de Champagne, ambassadeur
auprès des cantons suisses. Le couple eut au moins sept enfants, dont notre
ancêtre Engilbert ou Gilbert, gentilhomme de la Chambre du roi François 1er.

Château
de Longecourt
Le château de Longecourt-en-Plaine est situé dans le
département de la Côte-d'Or, en Bourgogne, au milieu du village, dans un joli
parc de 40 hectares aux arbres tricentenaires, à proximité de l'Oucherotte. Il
est entouré de douves que franchissent trois ponts dormants. La famille de Baissey
(notamment Jean puis Antoine de Baissey), héritière de Jean de Fribourg (décédé
en 1459), entreprend la reconstruction en briques du château ; elle est
achevée en 1539. Le plan général de l'édifice, les douves et la chapelle sont
de cette époque. Brûlée en 1636 par les Impériaux de Gallas, la terre passe ensuite à François
puis à Alexandre de Varennez-Nagu. Ce dernier la revend en 1680 à Jacques
Berbis.qui transforme la propriété en demeure de
plaisance.
Sources :
==================================================
-Histoire de Bourgogne : Charles VIII par
M. Rossignol, « VII.- Les Bourguignons à la bataille de
Saint-Aubin-du-Cormier », publié dans les Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de
Dijon - 1858 (27)
-Compte rendu des travaux de la commission des antiquités
(Mémoires de la Commission des antiquités du département de la Côte-d'Or - 1921
(17)
-Dictionnaire de l'état-major
français au XVIe siècle / Fleury Vindry - Partie 1 : Gendarmerie, page 30
-Mémoires de l'Académie des sciences,
arts et belles-lettres de Dijon - 1856 (25) p 139
Lien de parenté :
=============================================
|
Antoine de Baissey (+1509)) Engilbert de Baissey Jean de Baissey Bénigne de Baissey Marie de Baissey Odette Ocquidem Pierre Berbis Bénigne Berbis (+1721) Bénigne Berbis de Rancy (+1774) Marie Marthe Berbis de Rancy (1728-1782) Marie Chifflet d’Orchamps (1751-1807) Victoire Boquet de Courbouzon (1774-1856) Adèle Le Bas de Girany (1796-1857) Marie-Eugénie Garnier de Falletans (1823-1906) Maurice O’Mahony (1849-1920) |
|