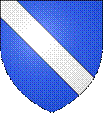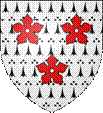|
Fiche
N° 0177 |
Auteur D. Barbier |
20/02/2009 |
||
|
Tiphaine ARNOUL |
Ascendant ¤
Allié ¡ |
|||
Aïeule d’Ambroise de Loré [1] en 1393
Blasons de Prez et de Loré
Texte de l’abbé A. Angot [2]
Ce n'est
qu'après d'assez longues hésitations que je me suis décidé à donner le récit suivant,
malgré l'intérêt qu'il présente, et je ne l'aurais pas du tout publié si,
toutes réflexions faites, je ne m'étais convaincu qu'il n'entache en rien la
réputation de l'illustre capitaine qui, avec André de Lohéac, fut la gloire de
notre pays pendant la grande guerre anglaise. J'eus laissé à d'autres le
plaisir d'utiliser un document [3] qui ne peut manquer de tomber dans le domaine public, s'il devait
jeter quelque ombre sur un nom à jamais glorieux. Mais Ambroise de Loré est ce
qu'il est par lui-même, par sa bravoure, par son épée, par les services qu'il a
rendus à son pays, par les exemples qu'il a donnés, exemples qui relevèrent le
courage de ses contemporains, et qui sont faits pour inspirer toujours de
nobles sentiments. Voici donc racontée sobrement et en toute sincérité l'histoire
de la grand'mère du futur prévôt de Paris.
Vers le
milieu du XIVe siècle, la châtellenie de Pré-en-Pail appartenait à un riche et puissant
seigneur nommé Guillaume de Prez. Il possédait cette terre à titre d'héritage. Ses
ancêtres en portaient le nom depuis au moins deux siècles. Quelle fut la femme légitime
qu'il épousa et dont il eut pour héritier de son nom et de sa fortune messire Olivier
de Prez, que nous retrouverons dans ce récit ? Je ne saurais le dire [4].
Veuf, il ne fut pas
insensible aux charmes d’une jeune chambrière de son manoir, nommée Tiphaine ARNOUL qui, disent les
pièces authentiques, par aucun temps
demeura avec lui. Vers 1360, il
advint de ce commerce irrégulier une fille qu’on nomma Marie et qui fut chèrement élevée par sa mère, car
l'ambitieuse Thiphaine fondait sur elle tous ses projets de grandeur future.
N’ayant pu être pour
sa part qu’une intrigante peu scrupuleuse, Tiphaine voulut que sa fille eût d’autres
titres à la considération des hommes et elle ne désespéra pas d’y arriver par
la protection du noble chevalier qui avait eu
pour elle plus de condescendance que n'en autorise la vertu. Laissons la continuer son manège de ruses et de services intéressés auprès du vieux seigneur de
Prez, nourrir ses rêves ambitieux et passons de suite, sans y insister
davantage, à vingt ans plus tard.
Guillaume de Prez était bien avancé sur son
déclin, et nous sommes arrivés approximativement à l’année 1380. Thiphaine qui
avait conservé de l'empire sur le vieillard, le décida sans trop de peine,
ayant préparé de longue main son siège, à établir sa fille bâtarde d'une
manière digne de lui. On peut croire qu'elle avait elle-même pris toutes les
mesures et que c'est elle qui jeta son dévolu, pour l'établissement de sa
fille, sur l'héritier d'une famille d'assez bonne et ancienne noblesse au Maine,
mais sans grande fortune ni grand renom jusqu'alors. Quand Guillaume de Prez
parut disposé à marier la jeune fille qu'il n'avait point perdue de vue, grâce
aux bons soins de sa mère, on lui proposa comme parti convenable Ambroise, fils
aîné de Robert de Loré, seigneur dudit lieu, en Oisseau. Il n'eut qu'à doter la
fiancée de quelqu'une de ses terres, ce qu'il pouvait faire sans porter
préjudice à la riche succession qu'il laissait à Olivier, son fils, et le
mariage se fit.
Ce mariage fut heureux. La fille de Tiphaine
Arnoul donna à son mari trois fils et une fille. Ambroise de Loré, deuxième du
nom, le héros des guerres anglaises, [compagnon d’armes de Jeanne d’Arc,
chambellan du roi Charles VII et Prévôt de Paris de 1436 à 1436], était l’aîné.
L’aïeule n’abandonna pas plus ses petits-enfants qu’elle ne l’avait fait pour
sa propre fille, et s’enhardissant avec le succès, elle voulut, par un coup
hardi, élever l’aîné de ses petits-fils au rang des plus riches familles de la
province.
Pour cela elle projeta une alliance avec la
Maison des Courceriers, représentée alors par messire Guillaume, époux de Jeanne
d'Avaugour, qui joua un grand rôle à la cour du duc d'Anjou, pendant que sa
femme, elle aussi, y occupait un rang très honorable près de la duchesse. Outre
la seigneurie de Courceriers et d'autres grands biens dans le Maine, Guillaume
et Jeanne possédaient en Anjou le château féodal et la châtellenie de La
Ferrière. L'une des filles de ce noble et riche chevalier parut à Thiphaine
Arnoul un bon parti pour son petit-fils. Sa fille, qui était veuve d'Ambroise I
de Loré, se prêta aux projets de sa mère pour procurer l'établissement de son
aîné.
Mais
l'entreprise était hérissée de difficultés et elle entraîna les deux femmes
dans une série d'intrigues très osées et périlleuses. Nous sommes en l'année 1409,
Ambroise II de Loré avait quinze ou seize ans. Des émissaires bien stylés
allèrent d'abord trouver le seigneur de Courceriers et lui dirent qu'un
mariage seroit bien séant d'une sienne fille à Ambroise, seigneur de Loré,
jeune escuier, fils de ladite Marie.
La
proposition fut loin d'être agréée de prime-abord. Messire Guillaume répondit
que le jeune escuier n'avoit pas terre ne lignée avenant ne pareille à soy
et que point n'y entendroit. A cette réponse qui était prévue, on répliqua
en exposant mystérieusement d'abord, puis d'une manière circonstanciée et très
affirmative, que la mère du jeune écuyer était sœur légitime ou légitimée de
messire Olivier de Prez, l'un des plus riches seigneurs de la contrée ;
qu'il y avait bons témoins pour le prouver, et qu'ainsi Ambroise de Loré
pourrait partager l'héritage de son aïeul, devenir même seigneur de Prez quand
on serait appuyé d'une puissante influence pour entreprendre et soutenir le
procès en revendication contre le détenteur actuel.
Guillaume
de Courceriers était déjà ébranlé, il demanda des preuves que la mère et la
fille se hâtèrent de lui apporter, telles qu'elles les avaient fabriquées à
loisir. Elles confirmèrent les dires des entremetteurs, jurant qu'il y avait eu
mariage entre le défunt seigneur de Prez et Thiphaine, et qu'en signe de la
reconnaissance de leur enfant et pour sa légitimation, la jeune Marie avait été
placée sous le poêle dont c'était l'usage alors de recouvrir les mariés pendant
la bénédiction nuptiale. Les deux femmes ajoutaient que jusqu'à ce temps, à
cause de la grande puissance du seigneur Olivier et de ses amis et parents,
elles n'avaient osé prendre le nom qui leur appartenait et réclamer
judiciairement leurs droits, mais qu'elles le feraient dès qu'elles auraient un
appui. Ces affirmations circonstanciées, jointes aux attestations déjà données
ou promises, convainquirent le seigneur de Courceriers qui consentit à un
mariage entre sa fille Marguerite et Ambroise de Loré. On s’empressa de le
conclure.
Les
deux mères auraient mieux fait prudemment de s'en tenir là. Mais elles
n'étaient plus libres de le faire. Le beau-père entendait que sa fille jouît
des biens qu'on lui avait fait entrevoir ; il semble bien qu'il le voulût
encore, même après que les phases du procès engagé lui eurent fait voir que les
droits prétendus n'étaient rien moins que certains. La partie était donc
engagée sur un terrain plus dangereux que jamais. Il ne s'agissait plus
seulement d'illusionner un père en faisant mirouetter (sic) à ses yeux la
perspective d'un riche héritage pour sa fille, mais bien d'arracher cet
héritage à celui qui le possédait ; il fallait déjouer, en soutenant ce
rôle, les investigations de la justice qui nécessairement allait intervenir.
Thiphaine
Arnoul ne s'arrêta pas aux scrupules et elle prit résolument les moyens que la
situation commandait. Sa fille lui prêta son concours, sans qu'il soit possible
de supposer la bonne foi de sa part, car le roman du mariage et de la
reconnaissance se serait passé, même à les en croire, dans un temps où la fille
bâtarde avait dépassé de beaucoup l'âge de raison.
Les
deux intrigantes s'occupèrent donc activement de chercher et de recruter des
témoins qui pussent, par des dépositions complaisantes et moyennant finances,
faire de la supercherie matrimoniale un bel et bon mariage, quoique dépourvu,
peut-être, de quelques-unes des formalités accessoires. La cérémonie remontait
à une quarantaine d'années ; ce long laps de temps donnait quelques
chances de plus d'en faire admettre la possibilité et devait rendre moins, exigeant
sur la nature des preuves à fournir. Thiphaine d'ailleurs sut y mettre le prix
et n'hésita pas à solliciter pour cet office inavouable un noble écuyer, Jean,
seigneur de Bellée, auquel elle promit et versa la somme considérable de cent
francs. Cet écuyer, mi-manceau, mi-normand, ne trouva pas le marché trop
étrange et il en accepta les conditions.
Ainsi
fit Juliotte Duplessis pour trente écus, ainsi un nommé Jouchet qui eut une
robe de rousset, ainsi plusieurs autres jusqu'au nombre de neuf.
Après
ces précautions préliminaires, Thiphaine et sa fille prirent résolument
l'offensive et commencèrent procès par devant le bailly de Touraine et des
ressors d'Anjou et du Maine à l'encontre de messire Olivier, seigneur de Prez.
La mère lui réclamait son douaire, et la fille, sa part dans la succession de
Guillaume de Prez. Ainsi attaqué, Olivier de Prez fit évoquer l'affaire devant
les gens tenant les requêtes du roi en son palais à Paris.
L'intervention
de Guillaume de Courceriers devenait très utile à la cause scabreuse où étaient
engagées les deux femmes. Pour l'y disposer, un des témoins gagnés par elles,
Colin Bodin, qui se nommait aussi Lornerreux, vient dire au noble chevalier, en
présence de Thiphaine, de Marie et même d'Ambroise de Loré, qu'il savait trop
bien le fait de la mère de son gendre, qu'il avait assisté aux épousailles et
avait vu mettre sous le poêle le jeune enfant.
Le
sire de Courceriers se garda bien de lâcher celui qui s'offrait ainsi à lui,
envoyé du ciel ou d'ailleurs.
Le
métier de faux témoin n'allait pas en ce temps-là sans de graves inconvénients.
Ceux qui en faisaient profession ordinaire ou accidentelle devaient être prêts
à supporter certaines épreuves qui auraient effrayé des courages vulgaires.
Quand
on nous dit que les plaideurs intéressés à tirer parti de sa déposition
voulurent faire examiner à mémoire perpétuel, Colin Bodin, dit Lornerreux, nous
ne croyons point qu'il s'agît d'un interrogatoire purement verbal. On verra
tout à l'heure que les autres témoins de dame Thiphaine avaient, eux aussi, été
quelque peu géhennés et pilorisés. Colin Robin aima mieux se dédire que de
pousser plus loin l'expérience et il protesta avant la question que pour
néant serait-il examiné, car il ne savait rien. Ceux qu'il frustrait ainsi
dans leur espoir, crurent ou dirent qu'il agissait de la sorte parce qu'il
avait subi d'autres influences et firent rechercher divers particuliers devant
lesquels il aurait tenu ses premiers propos.
Juliotte
Duplessis était du nombre et vint déposer à son tour ; quoique femme, elle
fut plus tenace. Il est vrai que le seigneur de Courceriers la protégeait
ouvertement. Elle était grosse d'enfant, ce qui rend son témoignage
assez suspect quand elle affirme qu'elle avait assisté au mariage prétendu de
Thiphaine et du seigneur de Prez, quarante ans auparavant. Comme elle se
trouvait fort malade au point qu'on craignait pour sa vie, Guillaume de
Courceriers lui fit remettre une queue de petit vin, d'une valeur de trois
francs, et six boisseaux de blé, puis pour empêcher qu'elle ne tombât entre les
mains d'Olivier de Prez qui la faisait chercher, on l'envoya en un hostel
fort, nommé La Ferrière, en Anjou, qui appartenait au sire de Courceriers,
où elle fut reçue par Jeanne d'Avaugour. Elle fit là ses relevailles, servit
quelque temps la dame du lieu et en reçut de menus cadeaux en vêtements, comme une
vieille cotte ou houppelande.
Olivier
de Prez, on le pense bien, ne s'endormait pas. Il obtint des lettres du roi en
vertu desquelles maître Andrieu Marchant, conseiller du roi, et Guillaume de
Buymont, huissier du Parlement, firent saisir et jeter en prison à Sillé tous
les témoins de l'intrigante Thiphaine. Ils étaient neuf et, parmi eux, la
malheureuse Juliotte qui fit mander à son protecteur qu'elle mourait de faim et
que, pour Dieu, on lui envoyast quelque chose pour vivre. Elle n'obtint
cette fois que quatre ou cinq sols tournois.
L'affaire
allait mal pour Thiphaine, pour sa fille et pour leurs associés. Tout ce
monde-là fut transféré aux prisons du Châtelet de Paris, et le seigneur de
Courceriers lui-même, ajourné d'abord pour comparaître en Parlement, n'évita
pas la prison. Il ne désespérait pourtant pas encore de la partie
engagée ; de la Conciergerie, où il était détenu, il trouva moyen de faire
parvenir aux témoins prisonniers des encouragements pour qu'ils se tinssent
bien en leur première déposition et que si aucune chose avoient dit au
contraire, qu'ils dissent en sortant du Chastelet que ce avoit esté par force
de gehaine.
Sans
doute ces conseils difficiles à tenir ne furent pas suivis, ou les juges
éclairés par d'autres témoins adverses ne se laissèrent pas convaincre.
Toujours est-il que l'aïeule, la mère et le beau-père d'Ambroise de Loré virent
que la situation était mauvaise, désespérée, et qu'il fallait s'en tirer à tout
prix. Chacun de son côté s'adressa à la clémence du roi. Guillaume de
Courceriers qui était chevalier, de noble génération, en fut quitte par
lettre du 26 mai 1410, pour une amende de 500 livres envers Olivier de Prez.
Thiphaine et Marie, qui n'avaient jamais eu aucun autre villain blasme,
eurent, elles aussi, à faire valoir des arguments dignes de considération, et
des promesses qui se trouvèrent prophétiques [5]. Laissant prudemment dans l'ombre le
nom et la personne de la trop habile Thiphaine, l'avocat rappela que Marie était
veuve d'Ambroise I de Loré, dont le père était chevalier, et que tous ceux de
cette maison avaient noblement et féalement servi la couronne de France, et,
ajoutait-il, elle avait belle génération, c'est assavoir trois fils et une
fille, et ont aussi lesdits trois fils bonne volonté de servir à la guerre.
Jamais
promesse ne fut mieux tenue, et la mère d'un héros comme Ambroise de Loré partagera
toujours plus la gloire de son fils que les démérites d'une mère trop peu scrupuleuse
dans son ambition.
Lien de parenté :
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Tiphaine Arnoul Marie de Prez Ambroise de Loré Marie d’Estouteville Anne de Châteauvillain Anne de la Baume Guillaume de Hautemer (1536-1613) Jeanne de Hautemer Claude d’Etampes Michel Clériade du Faur de Pibrac Marguerite du Faur de Pibrac Bénigne Berbis de Rancy Marie Marthe Berbis de Rancy (1728-1782) Marie Jeanne Chifflet d’Orchamps (1751-1807) Victoire Bouquet de Courbouzon (1771-1866) Adèle Le Bas de Girangy (1796-1857) Marie Eugénie Garnier de Falletans (1823-1906) Maurice O’Mahony (1849-1929) Yvonne O’Mahony (1885-1965) Monique Bougrain (1912-1968) Dominique Barbier. |
|